parti libéral

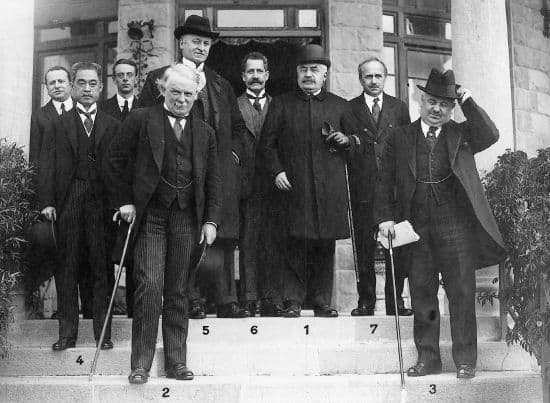
Parti politique britannique, considéré généralement comme le successeur du parti whig.
1. Heures de gloire et destin d'un grand parti
Il se constitue de 1830 à 1850 par la réunion des whigs, des radicaux et des tories dissidents disciples de Robert Peel, acquis au libre-échange, tous partisans du libéralisme économique. Dominé à partir de 1865 par la personnalité de Gladstone, le parti libéral évolue progressivement vers la gauche, et son long passage au pouvoir (1868-1874, 1880-1885 et 1886) lui permet de réaliser un certain nombre de réformes (généralisation de l'enseignement primaire, 1870 ; reconnaissance légale des syndicats, 1871 ; réforme judiciaire, 1873 ; réforme électorale, 1884). Attachés à la démocratisation de la vie politique et à la promotion des classes moyennes, les libéraux se divisent sur le problème de l'indépendance de l'Irlande, et le projet de Home Rule provoque la scission du parti et la création d'un parti libéral unioniste (1886). Après son grand succès électoral de 1906, sous l'impulsion de Herbert Asquith et surtout David Lloyd George, le parti libéral parvient à réaliser d'importantes réformes sociales (premiers systèmes de retraite, d'assurance-chômage et de santé, limitation des horaires de travail et salaire minimum dans les mines) et mène l'effort de guerre. Mais, à partir de 1922, son influence s'amenuise au profit des travaillistes (qu'il a d'abord soutenus en faisant élire leurs premiers députés) et des conservateurs, au point de quasiment disparaître de la scène politique.
Pour en savoir plus, voir l'article Grande-Bretagne histoire.
2. Vers le renouveau
À partir de 1960, sa position au Parlement s'améliore, et il revient au pouvoir avec les travaillistes de 1977 à 1979. En s'alliant au parti social-démocrate, issu de l'aile droite du parti travailliste, le parti libéral se renforce lors des élections de 1983 et de 1987. En 1988, il fusionne avec certains éléments du parti social-démocrate pour donner naissance au parti des démocrates-sociaux et libéraux (SLD) qui, par rapport à l'alliance antérieure, enregistre un certain recul aux élections de 1992.
De 1992 à 1997, sous la houlette de son nouveau leader, Paddy Ashdown, la formation bénéficie, au sein de la population, du rejet croissant des conservateurs. En 1994, elle remporte ses premiers sièges au Parlement européen. Aux élections locales de 1995, elle devance les tories, contrôle davantage de localités que ces derniers, et devient le deuxième parti du pays derrière les travaillistes. C'est avec ceux-ci qu'Ashdown envisage des alliances électorales, répudiant une vieille tradition de recherche d'équilibre entre les deux grandes formations.
À l'issue de la consultation de 1997, les libéraux-démocrates obtiennent 46 sièges à Westminster, soit le plus grand nombre de sièges occupés par un tiers parti depuis 1929. Mais la très large victoire du New Labour ne leur laisse pas la possibilité de négocier des arrangements avec ce dernier, même si des convergences de points de vue, notamment en matière de décentralisation, se font jour. En 1999, Ashdown démissionne et est remplacé par Charles Kennedy. Les élections européennes de la même année font passer la délégation libérale démocrate de 2 à 10 députés. Le parti devient aussi le second parti d'Écosse, derrière les travaillistes, avec lesquels il coopère au sein de la coalition, qui préside désormais aux affaires locales.
Affichant des convictions libérales et sociales, un souci environnementaliste marqué et un profond sentiment européen, il remporte 18,3 % des voix et 52 sièges aux élections générales de 2001, progressant notamment dans les circonscriptions travaillistes, et maintenant de fortes positions au pays de Galles et en Écosse. Opposés à l'intervention britannique en Iraq, les « Lib-Dems » engrangent de nouveaux succès lors des consultations partielles, des scrutins européens et locaux de juin 2004, et notamment des élections générales de mai 2005, dont ils apparaissent comme les grands gagnants (22 % des voix, soit 4 points de plus qu'en 2001, et 10 sièges supplémentaires). Mais ils ne sont pas parvenus à faire des Communes, toujours dominées par les travaillistes, une chambre véritablement tripartite, et leur groupe n'est pas devenu la principale formation d'opposition du pays ni une force d'appoint – pivot – dans la constitution d'un gouvernement minoritaire.
En quelque sorte déçus, les « Lib-Dems » poussent vers la sortie leur leader C. Kennedy en janvier 2006, et le remplacent en mars par sir Menzies Campbell. Malgré des résultats électoraux ponctuels, cet avocat, ancien athlète de haut niveau et vieux routier de la politique, ne parvient pas à insuffler un nouveau souffle à la formation, que les intentions de vote font plafonner à 20 %, et qui, en effet, aux élections locales de mai 2007, même si elle décroche finalement 26 % des voix et fait quasiment jeu égal avec le Labour, perd quelque 250 sièges, au profit essentiellement des conservateurs.
M. Campbell est amené à démissionner à son tour en octobre 2007, et c'est un jeune député quadragénaire, Nick Clegg, qui est élu à la tête du parti en décembre. Aux élections partielles de mai 2008, profitant du discrédit dans lequel sont plongés les travaillistes au pouvoir, les libéraux démocrates, qui remportent 25 % des voix et 34 sièges supplémentaires, font figure de seconde formation politique derrière les conservateurs. De quoi nourrir à nouveau leurs espoirs de peser lors des prochaines échéances nationales et de monnayer leur possible appoint par l'obtention de la réforme électorale appelée de leurs vœux. D'autant que la très sévère récession économique qui suit la tempête financière de la fin de 2008 tend à renforcer l'attrait d'une formation qui plaide pour plus de réglementation financière, une réforme fiscale (notamment des réductions d'impôt pour la plupart des ménages) et davantage de mesures environnementales auprès de classes moyennes de plus en plus désireuses d'amorcer le changement et de tourner la page du nouveau travaillisme.
Mettant en sourdine leur européanisme, les libéraux-démocrates abordent la campagne pour les élections générales de mai 2010 en position de force : non seulement ils apparaissent en phase avec une opinion lassée des scandales à répétition qui ont marqué la vie politique du pays dans les derniers mois et particulièrement soucieuse de réforme des institutions, mais encore, comme les instituts de sondage prévoient le plus souvent qu’aucun des deux grands partis n’est en mesure d’obtenir une majorité absolue, ils peuvent espérer devenir « faiseurs de roi » et monnayer leur ralliement à l’un ou l’autre des camps, voire ravir au Labour la deuxième place qui lui est alors généralement attribuée. En outre, le premier des débats télévisés historiques qui opposent les trois principaux candidats révèle au public la personnalité de N. Clegg, qui séduit immédiatement. Pourtant, le résultat du scrutin douche dans un premier temps les espoirs des libéraux, puisqu’arrivés seulement en troisième position, ils ne gagnent qu’un point, à 23 % des voix, et ne font élire que 57 députés, soit 6 de moins que dans la précédente législature. Mais ils constituent bel et bien la force politique pivot nécessaire à la formation d’un gouvernement stable et sont de fait aussitôt courtisés par les tories comme par les travaillistes. À l’encontre, certes, de nombre de leurs propositions, mais conformément à l’engagement qu’ils avaient pris pendant la campagne de rejoindre le cas échéant la formation arrivée en tête, ils forment le 11 mai une coalition historique avec les conservateurs.
3. Au pouvoir avec les conservateurs
Obtenant nombre de postes au sein du cabinet, dont celui de vice-Premier ministre (N. Clegg), ainsi que l’engagement du chef du gouvernement à ne pas provoquer de nouvelles élections générales avant la fin de la mandature, de tempérer ses exigences vis-à-vis de Bruxelles et son tropisme atlantiste, de partager l’effort de réduction des dépenses qui s’annonce drastique, et de tenir un référendum sur une révision du mode de scrutin, pour y instiller une dose de proportionnelle, l’attelage lib-dem/tory à la tête du pays met en œuvre une série de réformes destinées à limiter la portée de l’État providence et réduire de manière draconienne le déficit public (dépassant les 12 % du PIB en 2010).
Malgré les concessions arrachées à D. Cameron (relèvement du seuil d’imposition, exonérant près d’un million de contribuables, non-remise en cause de la hausse de 40 à 50 % de la tranche supérieure prévue par G. Brown, suppression des allocations familiales pour les plus aisés), la cure de rigueur sans précédent et, notamment, l’autorisation octroyée aux universités de tripler le montant des frais d’inscription (alors que la formation centriste s’était engagée à geler le coût des études supérieures) suscitent à l’intérieur du parti comme au sein du cabinet des grincements de dent, qui, le cas échéant, se font entendre, au grand dam de leurs partenaires de gouvernement. Surtout, conjuguées à un recul trentenaire du pouvoir d’achat (-0,8 % en 2010) et des perspectives plus sombres encore pour l’année en cours, elles contribuent à la dégringolade dans les sondages des libéraux-démocrates, que les Britanniques sanctionnent lourdement lors des consultations locales de mai 2011 ; leur infligeant leur pire score (15 % des voix) pour ce type de scrutin, cette gifle électorale enterre leur projet de réforme électorale, ne reconduit pas dans leurs fonctions des centaines de leurs conseillers territoriaux, leur fait perdre leur rôle stratégique d’appoint aux nationalistes à la tête du Parlement d’Écosse et divise plus que jamais le mouvement entre son aile gauche portée vers une alliance avec les travaillistes, et les modérés et droitiers qui se sont associés, parfois non sans réticences, aux tories et à la majorité ainsi qu’au cabinet que ces derniers ont constitué.
Les consultations locales ouvrent également sur une nouvelle série de désaveux : l’orientation eurosceptique toujours plus prononcée de D. Cameron à partir de l’automne 2011, notamment le rejet qu’il oppose en décembre à toute idée de solidarité budgétaire communautaire, puis la proposition qu’il émet en novembre 2012 de consulter la population par référendum sur le maintien ou la sortie du royaume de l’UE après les élections générales de 2015, l’enterrement au cours de 2012 de la réforme des lords portée par N. Clegg, les biais favorables aux tories dans la maquette de refonte de la carte électorale présentée à l’été 2012, les revers supplémentaires de la formation aux municipales de mai 2012, l’entrée au gouvernement de membres de l’aile dure du parti conservateur lors du remaniement de septembre 2012… Réduite, l’influence des libéraux-démocrates se fait dorénavant davantage entendre à la faveur de leurs divisions, quand, par exemple, ils se joignent aux travaillistes pour mettre le gouvernement en difficulté et rejeter certains de ses plans sociaux, comme en janvier 2012, à la chambre haute ; elle s’exprime aussi dans les menaces qu’ils brandissent au nez de leurs partenaires de la majorité, quand ils en appellent, entre autres, à la hausse de l’imposition des plus riches ou qu’ils contestent le redécoupage électoral en cours…
L’intransigeance affichée par le Premier ministre à Bruxelles à la fin 2012 et au début 2013, les nouveaux coups de rabot portés aux aides sociales, la droitisation de son discours et le ciblage des immigrés ajoutent à la confusion. Si les lib-dem conservent leur siège lors d’une législative partielle au début mars 2013 dans le sud de l’Angleterre, ils ne parviennent pas à enrayer la progression fulgurante de l’UKIP qui arrive deuxième, devant les tories. Au scrutin local de mai, ils n’enregistrent pas seulement une perte sèche de 124 conseillers et leur plus mauvais score électoral, à 14 % des voix, mais encore ils se font dépasser par cette formation populiste et anti-européenne et ne terminent qu’en quatrième position. Aussi se trouve-t-il une douzaine de parlementaires du groupe pour s’abstenir ou se joindre aux travaillistes et à une partie des conservateurs et désavouer aux Communes, dans le dossier syrien, D. Cameron et son gouvernement, dont N. Clegg, et refuser à la fin août l’autorisation demandée de l’usage de la force. Et à la fin de l’année, ce sont jusqu’à des membres du gouvernement qui portent la contestation, à l’instar d’un V. Cable, ouvertement inquiet de la marginalisation du pays à Bruxelles.
Si, à la faveur de scandales privés qui écartent au début 2014 deux briscards du mouvement, N. Clegg reprend la main sur le parti et l’aligne un peu plus sur les tories, celui-ci n’enraie pas son spectaculaire déclin : aux élections européennes de mai 2014, les lib-dém n’arrivent que cinquièmes, dépassés par les Verts, et n’obtenant que moins de 7 % des voix. Les élections locales qui se tiennent en même temps enregistrent un nouveau recul historique, à 13 % des suffrages, une piètre quatrième position derrière l’UKIP, et une perte sèche de 40 % de sièges de conseillers.
Leur participation à un gouvernement, dont le chef de file choisit stratégiquement dans la dernière ligne droite avant le scrutin général de mai 2015 de droitiser un peu plus l’orientation et de l’engager dans un bras-de-fer avec l’UE, les place comme jamais en porte-à-faux avec ce qu’il leur reste de soutien dans l’électorat. Aussi le verdict des urnes tombe-t-il comme un couperet : si N. Clegg sauve son siège, tel n’est pas le cas des autres grandes figures et/ou membres du cabinet comme Charles Kennedy, Vincent Cable ou Simon Hughes. Avec seulement 7,9 % des voix et un contingent réduit à 8 députés (contre 57 sortants), le parti enregistre une déroute cinglante et se voit pratiquement rayé de l’échiquier politique. Prenant acte de la sanction, N. Clegg démissionne dans la foulée de son poste de leader du mouvement. Àl’issue d’une consultation interne, il est remplacé en juillet par l’un des rescapés du Parlement, Tim Farron. À charge pour lui de faire oublier ce qui a posteriori peut apparaître comme une aventure dramatique, et sans suite : l’épisode de la responsabilité partagée des affaires. Et de restaurer la crédibilité du parti – pour ne pas dire assurer sa survie…
Hostile au « Brexit » (le retrait du Royaume-Uni de l'UE), le parti reste dans l’opposition après le référendum de juin 2016 et obtient 12 sièges aux élections anticipées de 2017, puis porte Vince Cable à sa tête à la suite de la démission de T. Farron. Après avoir connu une percée au scrutin européen de 2019 en obtenant 19,8 % des voix derrière le Brexit Party, grand vainqueur de ces élections, il ne renouvelle pas son exploit aux élections anticipées du 12 décembre, n’obtenant que 11 sièges avec 11,4 % des voix. À peine élue à la tête du parti en juillet, Jo Swinson perd son siège écossais, ravi de justesse par la candidate du parti national écossais, et quitte ses fonctions.
Pour en savoir plus, voir l'article Grande-Bretagne : vie politique depuis 1979.




