Benjamin Henri Constant de Rebecque, dit Benjamin Constant


Écrivain et homme politique français (Lausanne 1767-Paris 1830).
Constant, blasé passionné
« À vingt-cinq ans, il était découragé de la vie ; son esprit jugeait tout d'avance, et sa sensibilité blessée ne goûtait plus les illusions du cœur. Personne ne se montrait plus que lui complaisant et dévoué pour ses amis, quand il pouvait leur rendre service ; mais rien ne lui causait un sentiment de plaisir, pas même le bien qu'il faisait : il sacrifiait sans cesse et facilement ses goûts à ceux d'autrui ; mais on ne pouvait expliquer par la générosité seule cette abnégation absolue de tout égoïsme, et l'on devait souvent l'attribuer au genre de tristesse qui ne lui permettait plus de s'intéresser à son propre sort. Les indifférents jouissaient de ce caractère, et le trouvaient plein de grâces et de charmes ; mais quand on l'aimait, on sentait qu'il s'occupait du bonheur des autres comme un homme qui n'en espérait pas lui-même, et l'on était presque affligé de ce bonheur qu'il donnait sans qu'on pût le lui rendre. ».
C'est dans Corinne (1807) que Mme de Staël, qui le connaissait si bien, fait ce portrait psychologique, sous le nom d'Oswald, de Benjamin Constant, figure exemplaire du blasé. Lui-même n'écrivait-il pas dès 1792 alors qu'il a vingt-cinq ans :« Je suis détaché de tout, sans intérêt, sans liens moraux, sans désirs, et à force de satiété et de dégoût, je suis souvent prêt à faire des bêtises. » La principale caractéristique de Constant semble avoir été, effectivement, cette inaptitude au bonheur, qui, tout à la fois, lui donnait l'esprit caustique du brillant causeur, toujours un peu à distance, qui faisait merveille dans les salons et l'amenait, dans sa vie personnelle, à tomber amoureux avec violence de femmes remarquables par leur capacité à produire du malheur. Par ce trait, typique de la première génération romantique, il est Adolphe, le héros du roman homonyme qu'il publia en 1816. Il reste aussi fermement attaché au xviiie s. de Voltaire et des libertins, et correspond bien à ce portrait qu'en trace Sainte-Beuve, citant Chênedollé (Chateaubriand et son groupe littéraire) :« C'était un grand homme, droit, bien fait, blond, un peu pâle, avec de longs cheveux tombant à boucles soyeuses sur ses oreilles et sur son cou à la manière du vainqueur d'Italie. Il avait une expression de malice et de moquerie dans le sourire et dans les yeux que je n'ai vue qu'à lui. Rien de plus piquant que sa conversation ; toujours en état d'épigrammes, il traitait les plus hautes questions de politique avec une logique claire, serrée, pressante, où le sarcasme était toujours caché au fond du raisonnement ; et quand avec une perfide et admirable adresse il avait conduit son adversaire dans le piège qu'il lui avait tendu, il le laissait là battu et terrassé sous le coup d'une épigramme dont on ne se relevait pas. ».
On remarque qu'il est là question essentiellement de politique : pour ses contemporains, Benjamin Constant fut avant tout un spécialiste de l'État, qui occupa d'ailleurs un temps de hautes fonctions, tour à tour jacobin, républicain, antibonapartiste, figure incontournable du libéralisme sous la Restauration après s'être rapproché des Bourbons (des caricatures le représentent en girouette ou en caméléon, pour fustiger ses constantes palinodies). Dans la dernière partie de sa vie, il est connu pour son Histoire des religions – qui a, en fait, occupé sa réflexion depuis sa prime jeunesse. Tout au long de son existence, il est célèbre pour ses amours innombrables, et ses duels répétés. Depuis la fin du xixe s., il est surtout connu comme l'auteur d'Adolphe, l'un des chefs-d'œuvre du roman d'analyse, et, depuis les dernières découvertes des années 1950, comme l'un des écrivains qui ont le mieux exploité les diverses possibilités de l'autobiographie, sous toutes ses formes.
Constant, peut-être parce qu'il vécut constamment entre passion et dérision, fut longtemps l'objet d'un malentendu général, aujourd'hui, seulement, en partie dissipé. Scripteur avide, il passa la meilleure partie de sa vie une plume à la main : mais, alors que la totalité de ses œuvres, si on la republiait aujourd'hui, couvrirait près de quarante volumes, la postérité ne se rappelle que d'un unique livre, Adolphe. Porteur de masques innombrables, vivant dans un dédoublement permanent, Constant se regarde s'agiter. Une métaphore empruntée à l'Arioste lui est si chère qu'elle revient six fois dans son œuvre :« L'Arioste raconte qu'un de ses chevaliers fut tué dans un combat, mais il avait tellement l'habitude de se battre que, tout mort qu'il était, il continuait encore. Je suis comme cela pour la littérature » (Correspondance, 1808). Il s'occupe de lui-même en se désintéressant de lui-même, entomologiste froid de sa propre personne.
Constant a exposé, peut-être mieux que Rousseau, tous les aléas de l'écriture à la première personne : il est et il n'est pas les multiples « Je » de son œuvre, et il n'est jamais autant lui-même que dans les lettres ou dans la fiction, ces deux pôles apparemment antagonistes de l'écriture, qui, chez lui, entretiennent entre eux des rapports familiers.
Adolescence cosmopolite
On se rappelle la phrase célèbre des Confessions :« Ma naissance coûta la vie à ma mère. » De même pour Constant : il naît le 25 octobre 1767 à Lausanne, et sa mère meurt le 10 novembre. Mais, si Rousseau a gardé de cette expérience initiale une culpabilité qui détermine toute sa conduite, Constant en tire une inconstance de don Juan, tombant sans cesse amoureux d'un objet nouveau et pourtant toujours plus ou moins semblable.
Son enfance se passe entre diverses parentes qui se disputent sa garde, avant qu'il ne soit confié à une jeune fille que son père projette d'épouser, puis à de nombreux précepteurs fort originaux, un tel le rouant de coups, l'étouffant ensuite de caresses, tel autre l'amenant, à huit ans, dans un mauvais lieu, un autre lui faisant recopier sans fin l'avant-propos d'un livre d'histoire rédigé par lui. Confié en 1778 à un moine défroqué, Benjamin commence un roman héroïque, les Chevaliers, qu'il achève l'année suivante, à douze ans.« Je sais que jusqu'à l'âge de quatorze ans, objet d'une grande affection de mon père, traité assez sévèrement, mais excité à la vanité la plus exaltée, j'ai vécu, remplissant tout ce qui m'entourait d'admiration pour mes facultés précoces et de défiance sur un caractère violent, querelleur et malin. On m'a cru méchant. Je n'étais que plein d'amour-propre. ».
Cette enfance se déroule entre la Suisse, Bruxelles, la Hollande, Oxford, Erlangen, Édimbourg (1783) : Constant revient en France en 1785, laissant aux Écossais mainte dette impayée. En 1786, à Lausanne, il tombe amoureux de la femme de l'ambassadeur d'Angleterre – son père l'amène à Paris. Là, au début de 1787, il rencontre Mme de Charrière, sa première égérie. En 1788, il a son premier duel, et se fiance avec Mina von Cramm (« Minette »), qu'il épouse l'année suivante, ce qui ne l'empêche pas de continuer à fréquenter Mme de Charrière. Il est déjà à cette époque d'un pessimisme convaincu : « Peut-être ai-je le malheur, écrit-il à Mme de Charrière en 1791, de sentir trop ce que tant d'écrivains ont répété, en agissant comme s'ils n'en croyaient rien, que toutes nos poursuites, tous nos efforts, tout ce que nous tentons, faisons, changeons, ne sont que des jeux de quelques moments et ne peuvent mener qu'à un anéantissement très prochain, que par conséquent nous n'avons pas plus de motif pour acquérir de la gloire, pour conquérir un empire ou pour faire un bon livre que nous n'en avons pour faire une promenade ou une partie de whist, que le temps indépendant de nous va d'un pas égal et nous entraîne également, soit que nous dormions ou veillions, agissions ou nous tenions dans une inaction totale. Cette vérité triviale et toujours oubliée est toujours présente à mon esprit, et me rend presque insensible à tout. »
Premières passions d'un dandy
Il s'intéresse pourtant à la Révolution, au jacobinisme et à une petite comédienne, Caroline, avant de rencontrer Charlotte de Marenholz, née Hardenberg. En cette même année 1794, il cherche à divorcer, rompt avec Mme de Charrière, rencontre Mme de Staël, qu'il séduit au printemps suivant. Il devient l'un des ornements permanents du salon que la fille de Necker ouvre à Paris. En ces temps de dévergondage postrévolutionnaire, il s'habille en parfait muscadin, et livre aux Nouvelles politiques de Suard une série d'articles qui le font passer pour un royaliste.
À la fin de l'année 1795, juste après avoir obtenu le divorce, il est prié de quitter la France, avec Mme de Staël. Revenu avec elle en Suisse, Constant se partage entre sa famille, à Lausanne, et la résidence de sa maîtresse, à Coppet, sur les bords du lac Léman, où se forme un cercle de beaux esprits (Schlegel, Sismondi, Barante), tous amoureux de la maîtresse de maison. Constant rédige un pamphlet qui paraît dans le Moniteur à Paris : De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier. Attaqué, en sa qualité d'étranger, par le directeur de la Feuille du jour, il provoque celui-ci en duel. En cette même année 1796, il fait la connaissance de Julie Talma, la femme de l'acteur François Joseph Talma, pour laquelle il éprouve une passion violente.
Sa nouvelle brochure, Des réactions politiques (1797), est accueillie favorablement. Il enchaîne avec Des effets de la Terreur – sujet sans risques en 1797. Mme de Staël accouche d'une fille, Albertine, fruit de sa liaison avec Benjamin, qui, plus tard, la dotera. En politique, Constant vole au secours de la victoire, en défendant le coup d'État contre le Directoire dans une nouvelle brochure, Des circonstances qui peuvent terminer la Révolution. En 1798, du fait de l'annexion, entre autres, de la Suisse par la France, il devient citoyen français. Sa réflexion politique s'approfondit (Des suites de la contre-révolution de 1660 en Angleterre, 1799). Le coup d'État du 18 Brumaire, qui voit Bonaparte devenir Premier Consul, lui paraît opportun, et à la fin de l'année, il est nommé membre du Tribunat.
Voilà ce partisan du coup d'État qui vire à l'antibonapartisme – au grand dam du nouveau dictateur, dont il combat l'idée bien peu républicaine de tribunaux spéciaux. Il continue à fréquenter Mme de Staël, qui vient de publier, avec un grand succès, Delphine, s'inquiète de Charlotte de Hardenberg, tombe amoureux d'Anna Lindsay. Il est éliminé du Tribunat en 1802, et, la même année, Mme de Staël devient veuve.
Constant rédige la première partie de son Journal, titré Amélie et Germaine. Mme de Staël, soupçonnée de sympathies antifrançaises, est expulsée, et part avec Benjamin à Weimar – où ils rencontrent Goethe et Schiller, les patrons du romantisme allemand, et Wieland, le précurseur du courant. Constant travaille activement à son ouvrage sur les religions – fil conducteur de sa vie pendant plus de trente années. Il s'occupe de Mme de Staël, dont le père vient de mourir (« Il est mort ! Que deviendra-t-elle ?… Pauvre malheureuse, mourir vaudrait mieux que ce que tu vas souffrir… »), tout en partageant sa vie entre Mme Lindsay et Julie Talma. À Paris, il revoit Charlotte de Hardenberg, devenue après un premier divorce Mme du Tertre, pour laquelle il éprouve une passion grandissante :« Journée folle – délire d'amour ! Que diable cela veut-il dire ? Il y a dix ans que je n'ai rien éprouvé de pareil. Lettre de Mme de Staël. Répondu. Mais tout est bouleversé ! Je veux Charlotte, je la veux à tout prix. Essayé de m'enivrer. Je n'en ai été que plus amoureux. » Le 30 octobre 1806, il lui écrit qu'il commence un roman qui « sera notre histoire » – et revient auprès de Mme de Staël.« Tous les volcans sont moins flamboyants qu'elle. Qu'y faire ? Lutter me fatigue. Plus de projets. Me coucher dans la barque et dormir au milieu de la tempête » (Journal, 1806).
Invention du romantisme
L'année 1807 est celle d'une grave crise à tonalité religieuse. Constant tombe sous l'influence de son cousin, le chevalier de Langalerie, chef d'une secte quiétiste (« Je n'ai pas suivi la route qu'il m'avait tracée, racontera-t-il plus tard, mais il a mis dans ma marche quelque chose de plus calme et de moins inquiet, dont je lui sais gré »). Son sentiment de la brièveté, de l'inutilité de la vie se mue en abnégation de la volonté – il s'abandonne à son destin, non plus par désenchantement, mais par une sorte de confiance en un dieu innommé. Dans la dernière partie de son Journal apparaissent souvent les lettres LvdDsf – la volonté de Dieu soit faite. Conformément à la méthode quiétiste, il se compose une religion tout intérieure, qui en aucune manière ne se soucie de rites.« Ma religion, écrit-il à Prosper de Barante, consiste en deux points : vouloir ce que Dieu veut, c'est-à-dire lui faire l'hommage de notre cœur ; ne rien nier, c'est-à-dire lui faire l'hommage de notre esprit. » À cette époque, comme l'a bien noté Georges Poulet (Benjamin Constant par lui-même, 1968), Constant abandonne la causticité du xviiie s. et devient un romantique, rejoignant Chateaubriand, Senancour – et Staël.
À Coppet, où Mme de Staël l'a ramené de force, il interprète, pour le petit théâtre privé de la baronne, le rôle de Pyrrhus dans Andromaque (« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? ») et adapte, plus qu'il ne traduit, Wallenstein, de Schiller, qu'il publie en 1809 sous le titre de Wallstein. Sans doute s'identifie-t-il au personnage du jeune Alfred, auquel il fait dire :
« Inquiet, tourmenté, je demandais au monde
Dans quel but, à quoi bon sur la terre jeté,
L'homme errait dans le trouble et dans l'obscurité. ».
Mais c'est surtout dans la Préface qu'il se fait idéologue. Il en reprendra un passage, quasi inaltéré, dans ses Mélanges de littérature et de politique – témoignant à quel point les années 1807-1808 sont des années charnière :« Une grande correspondance existe entre tous les êtres moraux et physiques. Il n'y a personne, je le pense, qui, laissant errer ses regards sur un horizon sans bornes, ou se promenant sur les rives de la mer que viennent battre les vagues, ou levant les yeux vers le firmament parsemé d'étoiles, n'ait éprouvé une sorte d'émotion qu'il lui était impossible d'analyser ou de définir. On dirait que des voix descendent du haut des cieux, s'élancent de la cime des rochers, retentissent dans les torrents ou dans les forêts agitées, sortent des profondeurs des abîmes. » On se rappelle Pascal et son angoisse (« Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie »). Le croyant du xviie s. a peur, le quasi-incroyant du xixe s. entend partout des voix, indistinctes mais significatives.
Constant, passionné blasé
Ses amours avec Charlotte connaissent des hauts et des bas – il finit par l'épouser, après son second divorce, le 5 juin 1808, tout en cachant ce mariage à Germaine de Staël. La rencontre des deux femmes, le 9 mai 1809, tourne à l'orage : Benjamin, courant de l'une à l'autre, finit par tenter de s'empoisonner. C'est sa seconde tentative de suicide, toutes deux quelque peu factices.
Mme de Staël est à nouveau frappée d'un ordre d'exil lorsque paraît De l'Allemagne, exaltation du sentiment germanique contre la raison française. Constant, désœuvré, joue, perd 20 000 francs en quelques heures, et doit vendre sa propriété des Herbages. « L'avenir, écrit-il à Prosper de Barante, il n'y en a plus » : c'est là un thème permanent de sa correspondance ; Constant vit pour l'essentiel dans le passé, ce qui ne l'empêche pas de s'agiter fort dans le présent. Au même ami, il précise encore :« J'ai appris à me regarder comme une machine souffrante, mais qui, en souffrant, se remonte. ».
Parti en Allemagne avec Charlotte, après une ultime brouille avec Germaine de Staël, il passe par Baden, ville d'eaux, ville de jeu, où il perd ses dernières ressources : il se remet à son livre sur les religions.
L'intérêt de Constant pour la religion est d'abord celui d'un athée face à la vacuité d'un monde que ne remplit aucune transcendance – un thème à proprement parler existentiel qui fait de Constant un précurseur de Camus. Un passage de son livre, qu'il reproduit, à peu de choses près, dans divers ouvrages, en témoigne particulièrement.L'homme, écrit-il, « se trouve seul sur une terre qui doit l'engloutir. Sur cette terre les générations se suivent, passagères, fortuites, isolées ; elles paraissent, elles souffrent, elles meurent ; nul lien n'existe entre elles. Aucune voix ne se prolonge des races qui ne sont plus aux races vivantes, et la voix des races vivantes doit s'abîmer bientôt dans le même silence éternel. Que fera l'homme sans souvenir, sans espoir, entre le passé qui l'abandonne et l'avenir fermé devant lui ? ».
Ce sentiment de « passage inutile » peut engendrer un recours au carpe diem hédoniste :« Ce qu'il y avait de mieux à faire, durant cette vie d'un jour, durant cette apparition bizarre, sans passé comme sans avenir, et tellement courte qu'elle paraît à peine réelle, c'était de profiter de chaque moment » (De l'esprit de conquête et d'usurpation).
C'est sans doute aussi pendant ces années 1810-1812 qu'il rédige le récit de sa vie, connu sous le nom de Cahier rouge, et qu'il entame Cécile, son second roman, qu'il achèvera presque, et dont on ne retrouvera le manuscrit qu'en 1951 – le Cahier collant aux faits, le roman étant une autre autobiographie distanciée, remaniée, lecture de Benjamin par Constant. « Ce fut alors, écrit-il dans Cécile, que pour la première fois je respirai sans douleur. Je me sentis comme débarrassé du poids de la vie. Ce qui avait été mon tourment depuis maintes années, c'était l'effort continuel que j'avais fait pour me diriger moi-même… Je me trouvais délivré de toutes ces peines et de cette fièvre qui m'avait dévoré. » Le roman, qui tire le bilan de l'expérience quiétiste, marque le deuxième temps de la vie de Constant. Et, avec sagacité, il note :« Un professeur d'ici, homme d'esprit avec lequel j'ai souvent causé, me disait que ce n'était pas moi qui faisais mon livre, que mon livre se faisait… Toutes les idées, tous les faits, je les accueille et leur laisse à produire la modification qu'il est dans leur nature de produire en moi. ».
Il est alors à Brunswick, théâtre de ses amours d'antan. Dans le style télégraphique typique de la seconde mouture de son Journal, il note :« Tristesse profonde. Que de souvenirs ! Ma première femme, Coppet, France. Débris épars d'un passé fini. » Or, cet homme « fini » va rebondir.
La campagne de Russie et une entrevue avec Bernadotte l'incitent à rentrer en politique. Le 30 janvier 1814, il publie un pamphlet violemment antinapoléonien, De l'esprit de conquête et d'usurpation. Il devient secrétaire intime de Bernadotte à Bruxelles, rentre à Paris après l'abdication de l'Empereur, rencontre Talleyrand, autre girouette qui sait prendre le vent, et publie ses Réflexions sur la constitution, puis De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, ainsi que ses Observations sur le discours de S.E. le ministre de l'Intérieur sur la liberté de la presse. Il a revu Mme de Staël, mais il ne s'intéresse plus qu'à Juliette Récamier, dernier réceptacle de cette passion ininterrompue qui, simplement, change régulièrement d'objet :« Je souffre d'avance de ce que je souffrirai », lui écrit-il. Et, pour lui-même :« J'ai pleuré la moitié de la nuit. C'est incroyable… Je n'ai aucune chance d'autre chose avec elle que de l'agitation et un tourment perpétuel. Elle ne m'aime point du tout. Elle est dans un tourbillon qui l'étourdit. Elle ne m'aimera jamais. Je m'use et m'acharne sans but et sans espoir. Il faut guérir de ceci comme d'une maladie. Voyons des filles, épuisons-nous. Tâchons de prendre la force de la fuir. ».
L'immense succès d'Adolphe

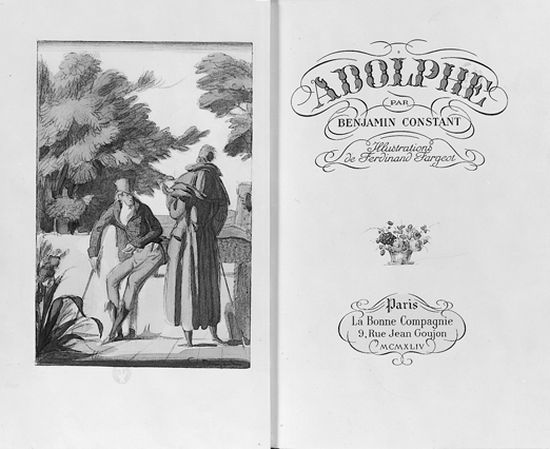
Dans les salons, cependant, il fait des lectures d'Adolphe, tirant à chaque fois des torrents de larmes de son auditoire.
Adolphe est le roman du découragement, du sentiment de l'inutilité au monde, du souvenir mortel, semblable « à ces feuilles pâles et décolorées qui par un reste de végétation funèbre, croissent languissamment sur les branches d'un arbre déraciné ». Cette image est typique de la mélancolie saisonnière et cyclothymique qui, régulièrement, saisit Benjamin Constant : l'hiver est sa saison mentale. Sans doute s'y complaît-il, sans toutefois en être dupe, riant lui-même de son « marivaudage de mélancolie ». Adolphe est aussi, et surtout, un roman d'analyse, qui, comme le Rouge et le Noir de Stendhal, ne conquiert, à sa parution, que des auditoires limités et choisis, et qui ne s'impose définitivement que vers 1880. Rarement l'amour aura été cerné avec plus d'émotion et de lucidité :« L'amour supplée aux longs souvenirs par une sorte de magie. Toutes les autres affections ont besoin du passé : l'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu, durant des années, avec un être qui naguère nous était presque étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux, et néanmoins il semble s'emparer du temps. » Le roman est l'histoire d'une rupture sans cesse différée :« Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond ! Elles deviennent à notre insu une partie si intime de notre existence ! Nous formons de loin, avec calme, la résolution de les rompre ; nous croyons attendre avec impatience l'époque de l'exécuter : mais quand ce moment arrive, il nous remplit de terreur ; et telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous quittons avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. » Rupture toutefois – dont il n'est pas exclu qu'elle soit exempte de cruauté. Après la mort d'Ellénore, le héros-narrateur conclut :« La grande question dans la vie c'est la douleur que l'on cause, et la métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l'homme qui a déchiré le cœur qui l'aimait. ».
Il rédige, à la demande de l'intéressée, les Mémoires de Mme Récamier, où, non sans perversité, il glisse une longue description de Mme de Staël – et l'on se demande parfois, à le lire, s'il parle de son ancien amour ou de lui-même :« En se préférant aux autres, elle ne pense être que juste, et elle s'estime de sa justice. Par là même, ceux qui l'entendent reçoivent sa conviction et sont dans l'impossibilité de lutter contre elle ; il faudrait pour qu'on pût lui résister qu'elle se chargeât elle-même de la contrepartie de ce qu'elle a dit. On sent qu'elle seule pourrait se répondre, et quand on l'a pour adversaire, on voudrait l'avoir pour défenseur. ».
En ce début d'année 1815, il fait paraître une nouvelle brochure, De la responsabilité des ministres. Apprenant le débarquement de l'ex-Empereur au Golfe-Juan, il publie dans la presse une vraie déclaration de guerre à Napoléon, « misérable transfuge ». Il est néanmoins reçu très cordialement par l'Empereur, de retour aux Tuileries ; il décrira par la suite (Mémoire sur les Cent-Jours) un Napoléon étrangement semblable à lui, avec « je ne sais quelle insouciance sur son avenir, quel détachement de sa propre cause, qui contrastaient singulièrement avec sa gigantesque entreprise… » Nommé au Conseil d'État, il est chargé de rédiger l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire. Il fait paraître ses Principes de politique applicables à tous les gouvernements. Après Waterloo, il fait partie d'une commission chargée de faire des propositions de paix aux Alliés. Exilé par les autorités, il est rappelé par Louis XVIII.
En 1816, le voilà à Londres – de nouvelles lectures d'Adolphe indisposent les dames de la meilleure société par excès d'émotion. Le 10 juin 1816, le roman paraît simultanément à Londres et à Paris – interprété comme un roman à clefs, ce dont Constant se défend. Il rentre à Paris à la fin de l'année, pour y faire paraître une nouvelle brochure, De la doctrine politique qui peut réunir les partis en France.
Apologie du libéralisme
Le 14 juillet 1817, Mme de Staël meurt, et Constant se charge de sa veillée funèbre. Il a repris l'ancien Mercure de France, bientôt interdit (1818), et a publié Des élections prochaines. Durant l'été 1818, il se casse la jambe, et se remet mal de l'accident et marche dès lors avec des béquilles. Candidat aux élections à la chambre des députés, il publie les Entretiens d'un électeur avec lui-même – en vain. Mais il est élu l'année suivante (1819) dans la Sarthe. Il a, entre-temps commencé la publication de son Cours de politique constitutionnelle. Dans la Minerve il s'adresse à ses nouveaux administrés par une Lettre aux habitants du département de la Sarthe, et y rédige également l'Éloge de sir Samuel Romilly.
Le gouvernement de la Restauration décide de sévir contre les libéraux, et supprime la Minerve. À Saumur, où il est allé donner une conférence électorale, Constant manque de se faire lyncher par la foule. Il publie les Mémoires sur les Cent-Jours, puis, l'année suivante (1821), Du triomphe inévitable et prochain des principes constitutionnels en Prusse.
Inculpé par le ministère Villèle de « complicité morale » dans un complot, il est condamné par les assises in absentia à 500 francs d'amende (1822). Il provoque Forbin des Essarts en duel, et, ne pouvant vraiment marcher, se bat assis. Vaincu aux élections, il continue son grand ouvrage sur les religions.
Paris le réélit en 1824 à la Chambre. En juillet paraît le tome I de De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements. Les tomes II et III sont édités dans les deux ans qui suivent. Il est réélu député du Bas-Rhin, après un voyage triomphal à Strasbourg : il est alors la figure dominante du libéralisme. Mais il est affligé de divers maux, qui l'amènent régulièrement en cure à Baden avec Charlotte, mais lui laissent toutefois le loisir d'éditer ses Mélanges de littérature et de politique (1829). La révolution de Juillet le voit prendre, avec sagacité, le parti du duc d'Orléans, qu'il accompagne en litière à l'Hôtel de Ville de Paris. Nommé président d'une section du Conseil d'État, il reçoit du nouveau roi 200 000 francs pour éponger ses dettes. Il a le temps de corriger les épreuves du tome IV de De la religion, avant de s'éteindre, le 8 décembre 1830. L'État lui fait des funérailles nationales.
À l'âge de vingt ans, et par manière de plaisanterie, Constant avait rédigé son épitaphe. Quarante ans plus tard, elle dit toujours l'essentiel sur cet homme hanté par la fuite des choses, et qui vécut sans cesse à la fois dans la conscience de la fin, et dans le divertissement, sans jamais pourtant oublier la vanité de sa fuite :
Au sein même du port j'avais prévu l'orage ;
Mais entraîné loin du rivage,
À la fureur des vents je n'ai pu résister.
J'ai prédit l'instant du naufrage,
Je l'ai prédit sans pouvoir l'écarter.









