opéra

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».























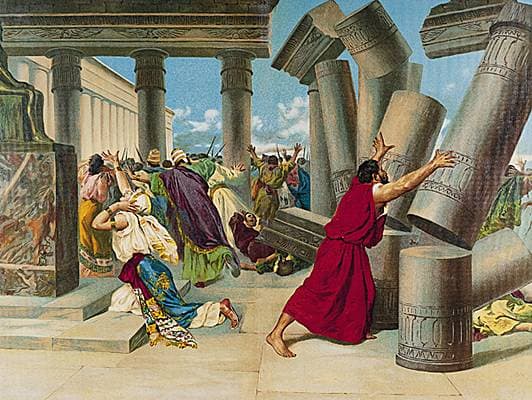












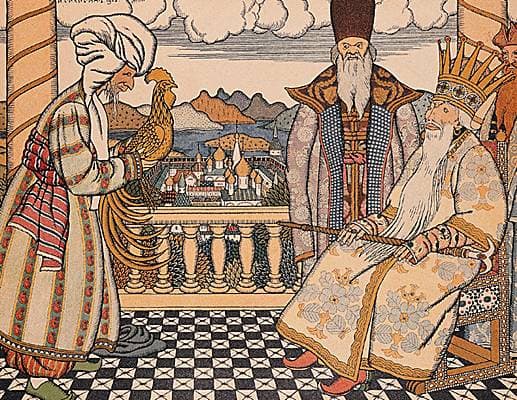



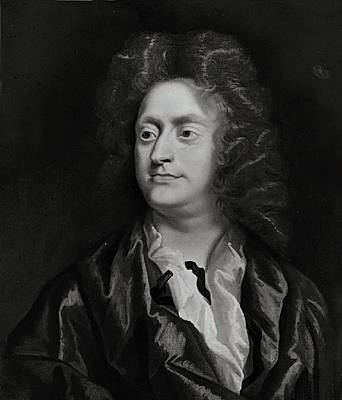

De façon générique, ce terme recouvre les divers types d'expression unissant le théâtre à la musique, comportant un texte en partie ou totalement chanté. On lui donne diverses dénominations (dont les définitions sont rappelées ici aux termes concernés) selon le caractère de l'action, le genre des structures et du livret, selon les époques, les pays, etc. Mais, ce mot, pris comme abréviation de opera in musica, peut s'appliquer au singspiel, à la tragédie lyrique, à l'opéra-comique, buffa, seria, etc., genres qui ont en commun de rassembler à une même fin des chanteurs, des instrumentistes, parfois des danseurs, des acteurs (avec de possibles interférences entre leurs disciplines réciproques), dans un espace défini dont l'ordonnance se réclame aussi des arts plastiques et du jeu théâtral.
Pour retracer l'évolution d'une forme qui comporte plus de 25 000 titres (dont près de la moitié de langue italienne), il convient de distinguer cette évolution propre de celle de l'écriture musicale. Leurs influences réciproques furent parfois déterminantes, parfois nulles. D'autre part, des compositeurs mineurs jouèrent souvent un rôle décisif dans l'histoire de l'opéra, alors que de très grands musiciens n'abordèrent pas ce genre, se satisfirent de structures traditionnelles, ou bien ne signèrent que des chefs-d'œuvre isolés, sans portée historique. Enfin, cette évolution repose sur de nombreuses querelles tendant à accorder la priorité au verbe ou au son, au rationnel ou à l'irrationnel (parfois à l'œil ou à l'oreille), ainsi que Nietzsche l'a rappelé en 1872, inscrivant ces choix dans l'antique schéma de l'antagonisme entre Apollon et Dionysos.
Des origines à la naissance de l'opéra
En dehors du drame grec, modèle souvent invoqué, on relève, du xiie au xvie siècle, diverses ébauches de ce genre, mais n'ayant pas nécessairement contribué à son éclosion ; ainsi le Jeu de Robin et Marion, au xiiie siècle, où la musique n'occupait qu'une place insignifiante, les drames liturgiques, joc partits, masks, etc. De même, dans les canti carnascialeschi florentins, les mascarades romaines et les diverses fêtes princières (cf. le Paradis d'amour en 1572 et le Ballet comique de la Reyne en 1581 en France, et en Italie la Pellegrina, en 1589), l'intérêt dramatique importait moins que le chant, le spectacle ou la machinerie. En revanche, l'Orfeo de Poliziano, donné à Mantoue en 1471 avec une musique collective, repris et mis en scène par Léonard de Vinci, puis Feba e Pitone (1486) seraient déjà plus proches du genre défini ci-dessus, mais ils ne semblent pas avoir influencé sa naissance. Celle-ci apparaît plus directement liée aux représentations sacrées, organisées par la Contre-Réforme, aux mises en scène des madrigaux dramatiques, à leurs transcriptions pour une voix soliste accompagnée et aux pastorales inspirées du Tasse. On note, dès 1573, des représentations chantées de l'Aminta, puis de divers poèmes épiques de la Jérusalem délivrée.
En 1590, le poète Guarini (1538-1612) transformait cette Aminta en tragicommedia pastorale que mettait en musique Emilio De'Cavalieri. Constituée d'une succession d'arias, elle nous semble aujourd'hui plus proche d'un opéra que la première œuvre habituellement reconnue comme telle, Dafne, composée entre 1594 et 1598 par le Florentin Jacopo Peri (1561-1633) sur un poème d'Ottavio Rinuccini (1562-1621). Rinuccini, comme les Romains De'Cavalieri et Giulio Caccini, appartenait à ces cénacles, qui, dans le bouillonnement intellectuel de la fin de la Renaissance, réunirent des humanistes, poètes, musiciens, chanteurs et scientifiques dans le but de ressusciter l'art grec ; rappelons les fameuses camerate du comte Bardi (Florence, 1576) et de Jacopo Corsi chez qui fut créée Dafne qui jouèrent un rôle décisif dans la création du genre. C'est dans cet esprit qu'on doit situer la reprise d'Œdipe roi de Sophocle au théâtre du Palladio de Vincence en 1585 avec une « musique de scène » d'Andrea Gabrieli. De même, Vincenzo Galilei (v. 1520-1591), père de l'astronome et membre de la camerata Bardi, dans son Dialogo della musica antica e della moderna (1581), traita d'acoustique et s'en prit violemment au madrigal à 5 voix, lui opposant l'art « pur » de la poésie grecque, art monodique seul capable de rendre justice à la théorie platonicienne de l'ethos. Or, une action scénique à fins morales, tendant à l'union de tous les arts (en particulier ceux de la poésie et de la musique), était désormais réalisable, le chant soliste accompagné, mieux apte à se marier au vers que la polyphonie, ayant alors atteint une perfection absolue.
C'est dans ce contexte que naquirent Dafne et, enfin, Euridice, écrite en 1600 pour les noces de Marie de Medicis et de Henri IV par Rinuccini et Peri, secondé par Caccini, qui, plus soucieux du chant que du drame, reprit entièrement à son compte le même poème en 1602. Ces œuvres, entrecoupées de danses, éliminaient presque tout aria et se fondaient essentiellement sur le recitar cantando ; leur monotonie était peut-être moins imputable au principe du « style représentatif » florentin qu'au très modeste talent de leurs premiers auteurs : Marco da Gagliano (1582-1643), qui reprit en 1608 le poème de Dafne, et composa jusqu'en 1637 des « fables en musique », alors influencées par Monteverdi et par les auteurs romains (v. infra) ; puis Giacobbi, Belli et Boschetti qui ne pouvaient prétendre rivaliser avec les derniers grands polyphonistes, de Palestrina à Gesualdo. En outre, ces spectacles de divertissement offerts au public princier des palais florentins ne répondaient plus guère à l'idéal vanté de la tragédie grecque. Avec son Orfeo (Mantoue, 1607), Monteverdi sauva le genre de l'impasse, bien que l'œuvre fût destinée au même cadre élitaire et hédonistique. On y trouve pourtant réunis tous les éléments dont se réclamera l'opéra deux siècles plus tard : le rôle expressif dévolu à l'orchestre, l'ouverture liée à l'action, une notion de timbre répondant à celle de l'éthos, une ébauche du leitmotiv, un juste équilibre entre voix et instruments, entre récitatif et aria, entre l'œil et l'oreille, et, surtout entre le verbe et le chant, celui-ci tour à tour sobre ou virtuose en fonction de l'action même. Mais le librettiste avait substitué au mythe une mythologie décorative, sans catharsis, avec un dénouement heureux. Et, excepté une timide tentative de caractérisation vocale, ce premier chef-d'œuvre de l'opéra instituait déjà cette dramaturgie abstraite, qui allait, deux siècles durant, reposer sur la voix asexuée du castrat, incarnant ici Orphée.
L'opéra en Italie au xviie siècle
On divise habituellement son évolution en trois étapes (opéra romain, opéra vénitien, puis opéra napolitain), classification commode, due au rôle prédominant joué successivement par ces trois centres, mais tenant mal compte des interférences entre leurs styles, leurs époques, et de la diffusion du genre dans diverses autres villes. Rome fut un important foyer de création de 1619 à 1643 et de 1660 à 1685, Venise de 1637 à la fin du siècle, Naples dès 1650, tandis que des salles accueillaient l'opéra à Bologne (1605), à Turin (1608), Parme (1628), Venise et Pesaro (1637), Ferrare (1638), etc. Privés ou publics, selon l'exemple fourni par Venise, ce sont plus de 40 théâtres qui s'ouvrent bientôt dans les grandes villes, une centaine dans toute l'Italie.
L'opéra romain
Rome, après avoir fourni plusieurs de ses artisans à l'école florentine, allait reprendre le flambeau, grâce à ses mécènes, et, notamment, les princes Barberini, alliés au pape Urbain VII. Or, déjà en 1600, De'Cavalieri avait mis en scène à l'oratoire della Vallicella de Rome sa Rappresentazione di Anima e Corpo, qui n'empruntait pas à la mythologie, mais comportait des personnages allégoriques (le Temps, la Fortune, le Vice, la Vertu, etc.). Avec son instrumentation étoffée, son récitatif assez richement orné, cette œuvre (dont on peut tenir l'oratorio et la cantate pour des branches rapportées), contenait en germe les principales caractéristiques du genre romain. Dès 1606, ce nouveau type de style représentatif s'épanouit dans les œuvres profanes de Paolo Quagliati (Il Carro di fedeltà d'amore), et d'Agostino Agazzari (Eumelio), et il allait inspirer Stefano Landi (v. 1590-1639), Filippo Vitali (env. 1590-1653) et Domenico Mazzocchi (1592-1665).
Véritable creuset des futurs opéras italien et français, cet opéra romain fourmilla d'inventions qu'on ne peut juger pleinement d'après les rares documents conservés, car ce furent plus de 100 œuvres qui furent exécutées dans les palais princiers, pour un public guère plus soucieux de mythe grec que de sémantique. Après quelques tentatives en dialecte, on prisa fort un genre où des personnages allégoriques côtoyaient des héros mythologiques ou historiques et ceux de la commedia dell'arte, tous confrontés à l'actualité, dans ce même esprit parodique qu'allait retrouver un Offenbach deux siècles et demi plus tard. Le comique, le sérieux et le sacré s'y mêlaient intimement, dans un luxe de costumes et de décors propre à satisfaire les goûts d'une aristocratie particulièrement dépravée. La musique ne jouait souvent qu'un rôle accessoire dans ces sortes d'opérettes à grand spectacle, dont le récitatif demeurait la base essentielle : la Morte d'Orfeo (1619), de Landi, une œuvre parodique, ne contient que 3 arias, et l'Aretusa (1620) de Vitali, un seul. En revanche, ce récit allait peu à peu tendre vers un arioso plus mélodique et inclure des passages de haute virtuosité par exemple, la Galatea (1639), œuvre du castrat L. Vittori , à moins que n'apparaisse une césure entre récitatif secco et aria, celui-ci comportant des couplets ou reprises, comme dans le Palazzo d'Atlante (1642) de Luigi Rossi (1598-1653). Le schéma de ces œuvres demeurait celui adopté par Monteverdi dans son Orfeo, en 5 actes avec chœurs et ballets, qu'il s'agisse de fable pastorale (la Catena d'Adone, 1626, de Mazzocchi), de tragicommedia (Diana schernita, 1629, de Giacinto Cornacchioli) ou du Sant'Alessio de Landi, qui, en 1632, osait porter à la scène la vie d'un personnage historique, faisant précéder l'œuvre d'un prologue allégorique où la ville de Rome s'adressait aux spectateurs. Notons encore que dans Erminia sul Giordano (1633), sorte de revue à grands tableaux, son auteur, M. A. Rossi, exécutait des solos de violon sur la scène ; dans le somptueux Palazzo d'Atlante, L. Rossi instituait cette ouverture bipartite, que copiera aussi Lully ; enfin, dans Del Male, il Bene (1653), de Marazzoli et d'Abbatini, tous les acteurs se trouvaient réunis dans les finales concertants.
Destinées aux palais princiers des Conti, des Corsini, plus tard des Colonna, etc., ces œuvres eurent bientôt pour cadre le splendide théâtre de 3 000 places bâti par les Barberini, inauguré par Sant'Alessio, avec des décors du Bernin. Mais la personnalité dominante de cette période demeure Giulio Rospigliosi, le futur Clément IX, qui, formé en Espagne, y avait puisé son goût pour ce théâtre réaliste et comique qu'il transposa sur les scènes romaines par le truchement de ses livrets, perpétuant ainsi la tradition des madrigaux de Banchieri. On trouve en effet des scènes comiques même dans les sujets religieux (cf. Sant'Alessio), où, toutefois, la part comique ne concerne que certains personnages, notamment les valets. Dès 1637, Rospigliosi écrivit une œuvre entièrement comique, il Falcone (ou Fiammetta), remaniée en 1639 sous le titre Chi soffre, speri, avec une musique de Virgilio Mazzocchi (1597-1646) et de Marco Marazzoli (1602 ou 1608-1662). Or, à Florence, cet élément burlesque dominait déjà largement dans La Flora (1626) de Gagliano, et c'est là que Jacopo Melani (1623-1676) fit jouer en 1656 une Tancia (1612), d'après Buonarotti, puis d'autres œuvres du même type sur des livrets de G. A. Moniglia. Les Barberini ayant été chassés de Rome par Innocent X, en 1644, leurs musiciens émigrèrent quelque temps à Venise ou à Paris (Mazarin avait été l'intendant de ces princes), où Luigi Rossi donna avec succès un Orfeo (1647).
La réhabilitation des Barberini, en 1653, signait la naissance d'une seconde période de l'opéra romain, désormais en étroit contact avec Venise, et dominé par le mécénat des Colonna et de Christine de Suède, fixée à Rome après sa conversion. Déjà, en 1653, Rospigliosi avait adapté de Calderón Del Male, il Bene (musique de Abbatini et de Marazzoli), une « comédie musicale », où l'alternance du récitatif secco et de l'aria s'imposait. Ce schéma n'évoluera plus sensiblement, alors qu'après la mort de Clément IX, en 1671, la papauté se montrera souvent hostile à l'existence de théâtres publics (→ ROME), une expérience tentée dès 1667. Les ouvrages comiques abondent désormais, notamment avec Alessandro Stradella (1644-1682), fixé à Rome jusqu'en 1677, et Bernardo Pasquini (1637-1710). Ce dernier, tout en restant attaché au vieux style d'écriture, insère de remarquables finales collectifs dans Tirinto (1672) et l'Alcaste (1673), et enrichit l'orchestre dans Lisimaco, dramma eroico où la virtuosité vocale se donne libre cours dans une longue suite de morceaux isolés ou pezzo chiuso (« structures fermées ») : 13 duos et 58 arias ; en effet, au type d'aria dit « romain », de forme ABB, se substitue l'aria da capo (ABA'), dont le chanteur ornemente les reprises à son gré, un usage mis en vogue par le castrat B. Ferri, protégé de la reine Christine. Stradella, novateur d'une autre trempe, s'efforça d'éviter cette césure trop brutale entre récit et aria, utilisant la forme intermédiaire de l'arioso.
En outre, dans La Forza dell'amore paterno (1678) le récit et l'aria participent également à l'action (au xviiie siècle, l'aria interrompra le récit pour exprimer un état d'âme), et 17 seulement des 49 arias adoptent la forme du da capo, une proportion qui s'inverse ensuite dans Moro per amore. Enfin, Trespolo Tutore, véritable opera buffa avant la lettre comporte une ouverture reliée à l'action, une suite de 63 arias, et confirme la typologie vocale du xviie siècle : basse, ténor, soprano, castrat y incarnant respectivement le barbon, la vieille femme, la soubrette et l'amoureux. En 1688, les théâtres de Rome excluent définitivement cantatrices et danseuses (cet interdit ne sera levé qu'en 1798), laissant ainsi se développer un opéra de pure virtuosité vocale, abandonné aux castrats, contribuant par là à éloigner de cette ville des musiciens tels que A. Scarlatti ou G. Bononcini (qui sera le rival de Haendel à Londres). Et c'est à Rome que s'ouvre en 1690 l'Académie des Arcadiens au sein de laquelle devaient se former tous les librettistes de l'opéra « moralisant » du siècle suivant.
L'opéra à Venise
C'est à Venise qu'apparut en 1571 le terme de libretto, c'est-à-dire petit livre, le spectateur pouvant ainsi suivre le texte complet de l'action chantée, intercalée dans les divertissements allégoriques donnés dans les théâtres privés. Or, lorsque le Teatro Nuovo, propriété de la famille Tron, disparut en 1629, la Sérénissime décida de le remplacer par un théâtre public et payant, innovation absolue dans l'histoire des arts. Ce Teatro San Cassiano fut inauguré en 1637 avec Andromede de Fr. Manelli (1595-1667), dont on apprécia surtout les splendeurs orchestrales et scéniques. Une dizaine de salles furent en effet ouvertes durant le siècle à un public populaire, peu soucieux de mythologie, marquant aussitôt sa préférence pour la comédie d'intrigues aux ressorts complexes, avec ses nombreux personnages, ses travestissements et sa tendance à l'exotisme facile. Comme dans l'opéra romain, les personnages du « quotidien » y côtoyaient ceux de la mythologie ou de l'histoire, en une totale imbrication de comique et de sérieux. Le vieux Monteverdi y scella néanmoins la marque de son génie, et c'est par la musique qu'il traduisit le burlesque de certains personnages du Retour d'Ulysse (1641) et du Couronnement de Poppée (1642), partition vraisemblablement collective, écrite sur l'excellent texte de Busenello, qui, à la fin morale de rigueur, substitua le triomphe du vice sur la vertu, mais maintint une constante dignité littéraire aux poèmes qu'il fournit également au successeur de Monteverdi, Fr. Cavalli (1602-1676), notamment La Didone (1641), où il osa porter à la scène un dénouement tragique.
La typologie vocale semblait, à Venise, plus abstraite qu'à Rome, le castrat incarnant indifféremment héros ou déesses. La somptuosité de décors signés Bibiena, Torelli ou Tacca, compensait la maigreur d'un orchestre utilisé essentiellement pour l'ouverture, les ballets et scènes descriptives (chasses, orages, tempêtes, etc.), mais quasi absent dans l'accompagnement de l'aria et du récitatif. Comme Monteverdi, Cavalli adopta dans ses tragédies le schéma romain avec son prologue allégorique, et maintint une certaine osmose entre un récitatif issu du style représentatif mais largement ornementé, un arioso expressif, et des arias variées et riches, excellant en particulier dans le genre du lamento. Mais, peu à peu, l'opéra vénitien tendait aussi à séparer plus nettement le récit et l'aria, une conséquence de la baisse de qualité des livrets. G. Faustini (v. 1619-1651), qui écrivit pour Cavalli les comédies L'Ormindo et La Calisto, estimait que la valeur du livret n'importait guère, et son successeur A. Aureli versa dans une certaine trivialité, de même que G. A. Cicognini, qui cultiva le grotesque dans Giasone (1649), un chef-d'œuvre que Cavalli sauva par la musique, et notamment par la scène de folie de Médée, un modèle imité durant tout le siècle. Enfin, si avec Ercole amante (Paris, 1662), Cavalli suggéra à Lully le schéma du futur opéra français, il n'eut guère à Venise de successeur à sa mesure.
Seule personnalité authentique de l'époque, Giovanni Legrenzi (1626-1690) souscrivit néanmoins à l'esthétique du spectacle en présentant sur scène des éléphants et 150 trompettes dans Totila (1677), opéra dont il sut toutefois varier à l'infini les 80 arias, faisant preuve de sa maîtrise et d'une grande sensibilité (notamment dans Il Giustino, 1683), et demeurant l'idéal de toute la génération suivante. Plus cosmopolite, Pietro (dit Marc'Antonio) Cesti (1623-1669) démontra sa facilité dans les aimables ariettes qui entrecoupent un morne récit (Orontea, 1656 et 1666, dont la musique sauve un livret ridicule), et il mit en musique pour Vienne en 1667 un fastueux Pomo d'oro, longue parodie du jugement de Pâris, dont on acclama surtout les 24 superbes décors.
On peut, en résumé, estimer qu'à Rome, comme à Venise, la variété des structures, le mélange souvent heureux des genres, la beauté d'un chant assez longtemps vierge de tout excès de virtuosité avaient su créer un opéra séduisant, qui avait sans doute manqué d'avocat très éloquent, et que sa fantaisie et sa déraison même rapprochaient de l'esthétique du baroque. L'opéra lullyste, d'une part, l'extrême rationalisation du xviiie siècle italien, de l'autre, allaient saper ce bel équilibre, qui, beaucoup plus tard, devait redevenir l'objet de bien des vœux.
L'opéra à Naples
L'analyse moderne a renoncé à définir un type « napolitain » relatif à cette époque. En fait, les compositeurs de la péninsule se retrouvèrent à Naples parce que trop d'interdits frappaient l'opéra à Rome, et qu'à Venise le genre sombrait dans la médiocrité. En outre, Naples, plus peuplée que Rome, Venise et Milan réunies, affirmait une tradition culturelle due à sa langue, ses fêtes théâtrales, et un rayonnement acquis grâce à la domination ibérique et à ses conservatoires uniques en Europe et propres à attirer compositeurs, musiciens et interprètes.
Francesco Provenzale (v. 1627-1704), longtemps considéré comme le père de l'école napolitaine, sut avant tout « associer sa parfaite connaissance du style vénitien à l'art de la villanelle », et, auteur d'une douzaine d'opéras, mit le meilleur de son talent dans ses comédies Lo Schiavo di sua moglie (1672) et Stellidaura vendicata (1678), utilisant parfois d'excellents livrets napolitains de A. Perucci. Mais la démocratisation des théâtres ne créa pas pour autant un style vraiment propre à cette ville où se côtoyaient les œuvres en dialecte, l'héritage du théâtre espagnol (jusqu'aux opéras de langue ibérique de Coppola), les spectacles de la commedia dell'arte et les drames sacrés.
Plus tard, le Sicilien A. Scarlatti, formé à Rome, imposera à Naples certains archétypes de l'opéra italien.
Naissance de l'opéra français
Dans un pays où l'esprit s'opposait « au genre le plus irrationnel qui soit », l'opéra n'apparut pas, ainsi qu'en Italie, comme un fait culturel inéluctable. Né, lui aussi, dans le cadre aristocratique de la cour, il eut, certes, pour objectif d'exalter la grandeur du règne de Louis XIV, mais il devait, en fait, consacrer les retrouvailles du vers et de la musique, qui, quelques siècles plus tôt, s'étaient séparés sur le parvis des églises, et avaient, par des voies autonomes, atteint à un même stade de perfection qui exigeait de nouvelles épousailles. On trouve donc à la base du genre naissant un certain nombre d'éléments complémentaires, juxtaposés plutôt que fondus entre eux : la tragédie de Corneille et le vers de Racine, une capacité orchestrale plus riche qu'en Italie, un goût du spectacle en soi, un vieil engouement pour le ballet, autant d'éléments susceptibles de compenser le niveau très modeste de l'école de chant française.
La France avait connu sous Louis XIII des ballets chantés solidement structurés, puis des pastorales, plus prisées par la noblesse que l'opéra italien, importé par Mazarin. Malgré un réel succès public, cette dernière tentative échoua, brisée aussi par les cabales politiques (en partie justifiées par les intrigues du castrat A. Melani, espion des Médicis). Lorsque fut créée une Académie royale de musique et de danse (plus tard Académie impériale, puis Opéra de Paris, nom que nous lui conserverons ici, quelle qu'en soit l'époque), le privilège en échut à l'abbé Perrin et à son musicien, Robert Cambert (env. 1628-1677), dont la Pastorale d'Issy (1659) avait connu un réel succès. Leur Pomone, spectacle d'inauguration de l'Opéra en 1671, malgré un galbe musical et littéraire assez faible, imposait néanmoins toutes les structures d'un genre qu'allait cultiver Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Florentin naturalisé français. C'est lui qui fixa le cadre immuable de ce que les historiens nommeront plus tard la tragédie lyrique, avec son ouverture, son prologue allégorique et ses 5 actes, faisant une large part à la danse et à l'élément visuel, et dans laquelle, malgré le support mythologique, le roi était le véritable protagoniste, soit directement présent, soit par héros interposé. Saisissant avec habileté ce qu'il convenait d'adopter ou de rejeter du modèle italien, Lully tira la leçon des représentations parisiennes d'Ercole amante de Cavalli, où ses propres intermèdes dansés avaient eu plus de succès que le style de chant, qu'il convenait donc d'adapter au goût français.
Or, si l'on critique justement le principe du récitatif arioso de Lully, il faut se souvenir qu'il n'était pas l'élément majeur de l'édifice, et qu'il devait au moins autant à l'assimilation des formules de l'opéra romain qu'à la déclamation des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Les véritables modèles du genre furent, en fait, plus que les ballets et pastorales de cour, plus que les comédies-ballets de Molière auxquelles il avait collaboré, une Andromède de Corneille et de D'Assoucy (1650) elle-même démarquée des spectacles italiens , et les opéras de Rossi, Cavalli et quelques autres qu'il avait connus. Témoins l'ouverture créée par L. Rossi rebaptisée ouverture à la française , la présence des ballets à chaque acte comme dans Sant'Alessio de Landi, le prologue allégorique et les chœurs déjà présents chez Mazzocchi, jusqu'aux effets d'écho, pris de La Vita humana de Marazzoli, et aux interventions du violon sur la scène, procédé employé par M. A. Rossi. Enfin, le merveilleux de la machinerie était l'œuvre de Torelli, et les danseurs de formation italienne. Mais alors que les opéras italiens du xviie siècle tombèrent dans l'oubli, éclipsés par l'attrait de la nouveauté, ceux de Lully subsistèrent et passèrent longtemps pour des créations originales. En outre, la pauvreté même de l'harmonie lullyste concourut à donner à son orchestre cette pompe insolite et caractéristique, partie intégrante d'un ensemble qui, moins « lyrique » que l'opéra italien, n'en était guère plus « tragique » pour autant, et cela explique que des musiciens tels que Couperin et Charpentier se soient désintéressés d'un genre qui leur parut mineur. Car si les vers de Quinault (1635-1688) sont beaux, ses tragédies, comme celles des auteurs vénitiens, empruntent à une mythologie décorative, surchargée, où, dès Alceste (1674), la trame puisée chez Euripide s'efface devant les intrigues de maints personnages secondaires. Malgré ces paradoxes, il faut s'incliner devant la rare unité de cet opéra français, sa logique et son infaillible perception d'une esthétique idoine aux buts de « l'opéra versaillais ».
La mort prématurée de Lully, qui avait régné par monopole de fait sur la scène française, causa un vide que ne comblèrent ni Lalande et Couperin, engagés sur d'autres voies, ni Marc Antoine Charpentier (v. 1636-1704), élève de Carissimi à Rome, auteur de 8 opéras, dont seule Médée fut donnée à l'Opéra (1693) et dérouta le public par ses subtilités harmoniques, mais aussi par un manque certain de ce sens architectural qu'avait possédé Lully. Deux de ses fils Jean Louis (1667-1688) et Louis (1664-1734) Lully ne purent s'affirmer, alors que les chanteurs et instrumentistes italiens, appréciés du public, étaient de retour ; et les véritables successeurs du Florentin furent d'abord son ancien collaborateur Pascal Collasse (1649-1709), auteur de 12 œuvres lyriques, son élève Henry Desmarets (1661-1741), harmoniste raffiné et auteur d'une Vénus et Adonis (1697), André Cardinal Destouches (1672-1749), l'auteur d'Omphale (1701) et de Callirhoé (1712), dont le récitatif et le chœur témoignent d'une belle ampleur, enfin François Rebel (1701-1775), qui, notamment dans Pyrame et Thisbé (1726), collabora avec François Francœur (1698-1787), un directeur de l'Opéra.
En marge de cette école, la claveciniste Élisabeth Jacquet de La Guerre et le violiste Marin Marais (1656-1728) s'intéressèrent au genre : Alcyone (1706), de ce dernier, contient une « tempête » restée célèbre. Il faut réserver une place à part à André Campra (1660-1744) et à Jean-Joseph Mouret (1682-1738), tous les deux d'origine provençale, qui furent les instigateurs d'un esprit nouveau et insérèrent même des ariettes italiennes dans leurs œuvres. Le premier a été auteur de belles tragédies (Tancrède en 1702, Idoménée d'après Danchet en 1712). Le second fut plus à l'aise dans le style léger exigé par la Régence ; tous deux furent aussi les artisans essentiels du nouvel opéra-ballet, né à la disparition de Lully, et ne différant vraiment de l'opéra français que par le renoncement à l'unité d'action (et de lieu). On doit à cet opéra-ballet de nombreux chefs-d'œuvre, de l'Europe galante (1697) et des Fêtes vénitiennes (1710) de Campra aux Fêtes de Thalie (1714) de Mouret, jusqu'aux Éléments créés aux Tuileries (1721) de Lalande et Destouches. Enfin, il faut créditer Mouret de la création de l'opéra-pastorale, et Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737) de l'introduction du thème biblique, avec une Jephté (1732) d'une puissance inattendue par la richesse de ses chœurs et de sa déclamation. L'année suivante, l'accès de Rameau à la scène lyrique allait éclipser tous ces musiciens.
L'opéra en Europe au xviie siècle
L'opéra italien ayant débordé ses frontières, précédant en cela son rival français, rares furent, ailleurs, les tentatives originales.
En Angleterre
Si la musique avait joué un large rôle dans les masks et dans les drames et comédies de Ben Jonson et de Shakespeare, le terme opéra ne fut employé que lors de la création d'un Siège de Rhodes (1656), d'après D'Avenant, dont Mathew Locke (1631-1677) assura l'essentiel de la musique. La réouverture du Duke's Theater, en 1671, après les troubles, puis les représentations françaises stimulèrent la création, en 1674, d'une sorte d'opéra tiré de la Tempête, dont Locke et G. B. Draghi écrivirent la partition sur le canevas fourni par D'Avenant et Dryden. Avec sa Vénus et Adonis (v. 1684), John Blow (1649-1708) se rapprocha davantage de l'opéra véritable, bénéficiant en outre du haut niveau de l'école de chant anglaise. Quant à Purcell (1659-1695), dont les nombreuses musiques de scène firent largement appel au chant, son Didon et Aenée (1689) répondit seul aux critères d'un opéra proprement dit. La mort de Purcell, l'implantation à Londres des premières troupes italiennes, bientôt soutenues par l'autorité d'un Haendel, allaient freiner longtemps la création d'un véritable opéra de langue anglaise.
L'opéra baroque allemand
Malgré leurs luttes religieuses, les pays de langue allemande avaient parfois perpétué un type de « spectacle éducatif », parent lointain des sacre rappresentazione ; mais, pour créer un opéra allemand digne de ce nom, il fallut que Heinrich Schütz allât étudier à Venise. Dafne (1627), composé sur une traduction du poème de Rinuccini, et Orphée et Eurydice (1638), deux partitions perdues, se référaient, l'une au modèle italien, l'autre au ballet de cours français. Jusqu'en 1680, diverses autres tentatives furent encore effectuées par Heinrich Abert, J. J. Löwe, Ph. Stolle, et surtout par Johann Philipp Krieger (1649-1725), formé en Italie comme Schütz. Mais ces auteurs se contentaient souvent de rabouter des airs de type français ou italien, sans conscience dramatique véritable. Krieger participa, néanmoins, à la première entreprise nationale, celle de « l'opéra baroque allemand », une épithète adoptée par les historiens avant que ce terme n'ait acquis les sens multiples qui lui sont donnés de nos jours. Alors que toutes les cours notamment celle de Vienne avaient adopté l'opéra italien, porté à son apogée par Steffani à Munich et Hanovre, on inaugurait à Hambourg en 1678 un Théâtre du marché aux oies avec Adam und Eve de Johann Theile (1646-1724), qui y donnait aussitôt également Orontès.
Outre ceux de Theile, Strung ou Krieger, on peut retenir les noms de J. W. Franck (v. 1644-1710 ?), auteur d'Aeneas (1680), Vespasian (1681), Diokletian (1682), etc., de Sigismond Küsser (Erindo, 1694), mais surtout celui de Keiser, qui laissa 60 opéras, dont Croesus (1711, 1730), dont s'inspira largement Haendel, et Ulysse, créé à Copenhague en 1722. Attentif aux inflexions du langage, s'inspirant de la pompe lullyste, il sut écrire de beaux finales concertants, et influença également J.-S. Bach, dont il ne faut pas oublier que certaines cantates profanes, telles que Éole pacifié (1725), Hercule à la croisée des chemins (1733), etc., sous-titrées dramma per musica, sont de véritables opéras de concert (dont il réutilisa souvent des fragments dans ses œuvres sacrées).
Haendel, dès 1705, avait écrit pour le Théâtre du marché aux oies Almira et Nero, assez pâles imitations des modèles de Keiser, cependant que l'expérience s'étendait aux villes de la Hanse, où l'on donna les œuvres créées à Hambourg, puis des créations autochtones, et jusqu'à Darmstadt (cf. Dido, de Ch. Graupner, 1707), Nuremberg et Leipzig. Enfin, en dehors même de cet opéra baroque, dont la véritable histoire prit fin avec la fermeture du théâtre hambourgeois (1738), l'attrait d'un opéra national avait séduit des musiciens d'horizons divers, comme Mattheson, qui écrivit Cleopatra en 1704, et Boris Godunov en 1710, puis Telemann, qui embrassa tous les genres, depuis le drame médiéval (Adelheid, 1724), la traduction de livrets français (Omphale, 1724), jusqu'à l'intermezzo italien (Pimpinone, 1725), et qui, suivant le modèle de certains des opéras baroques, mêla le français, l'italien et l'allemand dans Orphée (1729) ; il persévéra, même lorsque l'opéra italien eut à nouveau assuré sa suprématie dans toute l'Allemagne, jetant ainsi un pont entre ce premier effort national et la création du singspiel.
Le xviiie siècle : du baroque au rococo
L'héritage de son passé une fois surmonté, le théâtre lyrique devait refléter les préoccupations nouvelles du siècle de la raison et des lumières. Siècle libre penseur, dont l'illuminisme prescrira un théâtre moral, siècle de rationalisme, qui, en clarifiant une situation confuse, se donnera des chaînes. Siècle d'une esthétique hédonistique, dont, en son extrême fin, seul Mozart saura pressentir une recharge sacrale. Siècle, enfin, où, peu à peu, le réalisme d'un théâtre comique populaire triomphera des formules sclérosées d'une tragédie vidée de contenu humain. Et siècle où la riche surcharge du baroque le cédera à la décoration d'un rococo souvent gratuit. Des débats passionnés sur l'opéra y fleurirent, animés par des philosophes traitant du genre du livret, mais toujours résolus par des musiciens : au-delà des principes d'éthique et de structures, c'est par leur génie musical que Vivaldi, Haendel et Gluck triomphèrent de formules discutables, et que Rameau comme Mozart devaient donner leurs solutions à tous les problèmes en les asservissant à une conscience musicale et dramatique rigoureuse.
L'opéra italien avant 1750
Il triomphe désormais sans partage à Naples comme à Londres, mais plus encore autour d'un axe, qui, parti de Bologne, passe par Venise, Vienne et Saint-Pétersbourg. C'est à Vienne que résident les poètes d'opéra dits « césariens », et que les meilleurs auteurs et interprètes viennent chercher la consécration. Dans cette internationale d'un genre, il faut renoncer à classer quelques musiciens qui, comme Steffani, Scarlatti, Haendel, Fux ou Caldara, assumèrent des positions clefs à la charnière de deux mondes. Fixé à Munich en 1677, Agostino Steffani (1654-1728) y diffusa un style appris chez Legrenzi (cf. Niobe, reine de Thèbes, 1688) avant de jouer un rôle capital à Hanovre, de Henrico il Leone (1689) à Tassilone (1709) et exerça une influence déterminante sur Haendel. Un autre musicien cosmopolite, Antonio Caldara (1670-1736), propagea à Vienne le style vénitien.
Enfin, c'est à tort qu'on voit parfois en Alessandro Scarlatti (1660-1725) un fondateur de cette insaisissable école napolitaine. Ses premières œuvres créées à Rome (cf. L'Honesta negli amori, 1680), tributaires du vieux style contrapuntique, ne peuvent rivaliser avec les chefs-d'œuvre de Stradella, mais son talent lui permit ensuite d'épouser aussi bien le faste vénitien (Mitridate Eupatore, 1707) que la comédie (Il Trionfo dell'Onore, Naples 1718) ou cet opéra devenu un simple récital de chant, dont il donne de beaux exemples avec Il Tigrane (Naples, 1715) et La Griselda (Rome, 1721).
À Venise
Dans cette ville, où 4 conservatoires le disputent en valeur à ceux de Naples, le castrat n'est pas maître absolu, et l'instrument se joint largement à la voix dans un faste sonore et visuel où l'irrationnel domine encore. L'opéra demeure indifférent à la séparation des genres, à la schématisation des structures, et apparaît encore tributaire du vieux style, ce qu'explique la position géographique de la ville, favorisant en outre les échanges avec le Nord. C'est donc encore l'orchestre, plus que le clavecin, qui soutient le récitatif chez Fr. Gasparini (1668-1727), formé par Corelli à Bologne, puis maître de Benedetto Marcello. La tradition de Legrenzi revit encore chez le très remarquable Antonio Lotti (v. 1666-1740), dont la colorature se fait déjà plus expressive. Et c'est une même « veine mélodique douce », qui fait merveille dans les opéras d'Albinoni, qui ne se soucia guère plus de formes que Vivaldi, lequel, de 1713 à 1739, déploya une intense activité lyrique à Venise et à Vérone.
Chez ce dernier prime la qualité de la musique, et il est significatif que Tito Manlio, où l'on peut discerner une tentative de caractérisation vocale, ne soit qu'un pasticcio d'œuvres antérieures.
Et, si l'on mesure le triomphe sans précédent obtenu par Haendel à Venise avec Agrippina (1709), c'est bien de cette même source que naît le langage de ce musicien allemand, langage forgé à Hambourg auprès de Keiser, puis, avec Steffani, à Rome, à Naples et à Hanovre. Haendel, opérant à Londres pour le compte d'une aristocratie traditionaliste (Rinaldo, 1711), se contenta d'appliquer son formidable génie à un genre déjà agonisant, que seuls les plus fabuleux virtuoses du chant qu'il sut attirer à prix d'or soutinrent de tout leur talent. Malgré son anachronisme, l'opéra haendélien s'impose encore aujourd'hui après une très longue éclipse par sa richesse musicale reposant sur un important effectif instrumental et sur l'inépuisable variété des arias da capo. Son écriture devait ensuite s'accorder davantage à l'oratorio, surtout face au succès réel remporté par son rival napolitain Porpora, tenant du style moderne.
L'opéra napolitain
Le terme « panitalien » convient davantage au genre qui se développe dans toute la péninsule, et dont on peut tenter de relever les principes éthiques et esthétiques communs. L'ouverture de l'immense Teatro di San Carlo, à Naples en 1737, ne modifia pas les lois d'un type d'opéra reposant d'abord sur le charme mélodique. Le castrat et l'aria da capo deviennent les clefs de voûte de l'édifice. Aux longs récitatifs supportant toute l'action s'opposent les différents types d'arias exprimant les affetti, sortes d'abstractions métaphysiques répondant à l'abstraction de la typologie vocale aisément interchangeables d'un opéra à l'autre, et dont la place au sein de l'action pouvait varier, dans la mesure où l'on ménageait au chanteur le mieux payé les arias les mieux situées au cours de ces longues soirées.
Le nouveau type de livret devait se plier à ces exigences. L'Académie des Arcadiens, à Rome, en fixa les normes, récusant les « trivialités » de ses prédécesseurs, exaltant les passions « nobles », dans un style aimablement pastoral. Les premiers disciples de cette « réforme » furent Silvio Stampiglia (1664-1725) et surtout Apostolo Zeno (1668-1750), mais aussi Antonio Salvi (mort en 1742), qui, dès 1702, n'hésite pas à puiser dans l'histoire récente, tirant un livret du Comte d'Essex de Thomas Corneille. Cette éthique sera portée à son plus haut point d'expression par Antonio Trapassi, dit Pietro Metastasio, ou Métastase (1698-1782) ; successeur de Zeno à la cour de Vienne en 1730, il laissa 27 drames en 3 actes (sans compter les poèmes sacrés, les sérénades en 1 acte, les comédies, ariettes, etc.), qui engendrèrent plus de 800 opéras, sans cesse adaptés et remis en musique, parfois par un même compositeur. On dit même avoir dénombré jusqu'à 107 versions de son Artaserse.
Formé à Rome par le poète arcadien Gravina, Métastase avait connu ses premiers succès à Naples, où les leçons de Porpora et sa liaison avec la cantatrice Marianna Benti Bulgarelli achevèrent de l'initier à la pratique du chant et de la composition. Son premier drame, Didone abbandonata, fut mis en musique par Domenico Sarro en 1724 à Naples, d'où l'assimilation possible des notions d'opéra napolitain ou métastasien. Mais cet idéal s'incarne mieux encore chez le Saxon Adolfe Hasse (1699-1783). Il est significatif que l'opéra métastasien (avant sa réforme inéluctable) n'ait lié son nom qu'à des auteurs étrangers, aux grands castrats dont Farinelli, avec qui le poète échangea une intéressante correspondance , et qu'aucun nom de grand musicien italien hormis celui de Pergolèse, dont la disparition prématurée a bien auréolé la légende ne reste attaché à cette époque. Le principal défaut de l'opéra métastasien nous semble de n'être qu'une suite d'arias sans duos, ni ensembles, ni chœurs, éléments qui précisément sont les atouts majeurs de l'opéra face au théâtre parlé.
À Naples, Francesco Mancini (1672-1737) avait, presque seul, assuré la transition entre les deux époques, et il fut, avec Bononcini, le premier auteur italien joué à Londres, en 1710. À sa suite, tous les auteurs « napolitains " s'illustrèrent avec un égal bonheur dans le genre seria, l'intermezzo et l'opera buffa, mais il faut retenir le rôle joué par Sarro (1679-1744), dont le style dénota, dès l'abord, le refus du baroque pour adhérer à une veine lyrico-sentimentale, dont hérita Pergolèse. Sarro fut choisi pour l'inauguration du San Carlo, avec son œuvre Achille in Siro, 1737. Nicola Porpora (1686-1768), qui fut le plus célèbre maître de chant de tous les temps, soigna pourtant la partie instrumentale à l'égal de ce chant. Comme Sarro et Porpora, Leonardo Leo (1694-1744) qui fut le maître de Piccinni et de Jommelli témoigna de cette anticipation de « l'ère de l'Empfindsamkeit », et Leonardo Vinci (1690 ou 1696-1730) avait su imposer dans toute l'Europe, malgré sa trop brève existence, la perfection de ce nouveau style, avant même Hasse. On doit encore citer Fr. Feo (1691-1761), P. Auletta (1698-1771), N. Logroscino (1698 – apr. 1765), et naturellement Pergolèse (1710-1736), dont le charme mélodique, très personnel, convenait peut-être mieux au genre léger qu'à son Olimpiade métastasienne ou à son très intéressant Adriano in Siria (1734). Avec Davide Perez, Domenico Terradellas et Rinaldo da Capua (v. 1705 – v. 1780), qui dénotaient un sens mélodique décidément moderne, semble se clore une première manière de l'opera seria italien, auquel les courants réformistes et la vogue de l'opera buffa allaient imprimer une direction nouvelle.
Intermezzo et opera buffa
Bien que de naissances sensiblement différentes, ces deux formes eurent la mission commune de rendre au public l'élément comique que récusait désormais l'opera seria. Le même but apparaît dans l'opera buffa, dont le catalyseur fut, à Naples, le besoin d'exalter le dialecte par des comédies dont la musique ne fut d'abord qu'un faible complément.
Grâce à des auteurs tels que Leo, Vinci, Hasse, Porpora, ces genres, qui permettaient d'écrire des duos, des trios et surtout les fameux finales concertants, connurent une gloire rapide, et, si l'intermezzo de Pergolèse, La Serva padrona (1733), fut appelé à un grand retentissement, son auteur avait manifesté un talent plus évident dans l'opera buffa en 3 actes Lo Frate'nnamorato, donné en 1732 et comportant un orchestre plus riche et de beaux finales collectifs. Nicola Logroscino devait porter ce finale concertant à une dimension dont se souviendra Mozart, mais c'est à Venise que l'opera buffa évolua rapidement vers la comédie, notamment grâce à Goldoni, qui, après avoir servi, comme simple librettiste, Vivaldi et Gluck (par exemple, Tigrane, 1743), adapta ses œuvres antérieures en livrets et surtout écrivit directement des comédies destinées à être mises en musique. Il avait trouvé en Baldassare Galuppi (1706-1785), claveciniste réputé, le collaborateur idéal pour ses « drames comiques », moins remarquables pour leur langue que pour le choix des thèmes qui s'évadaient de la farce paysanne pour atteindre à la satire dans L'Arcadia in Brenta (1749) et Il Filosofo di campagna (1754), au fantastique aimable dans Il Mondo della luna (1750) que reprendra Haydn, et surtout au sentimental avec La Buona figliuola (1756) de Duni, cependant que ses héros n'étaient plus des valets ni des soubrettes, mais les bourgeois ou les aristocrates du théâtre de Marivaux. On peut estimer que, lorsque en 1760 Piccinni reprit cette Buona figliuola (tirée de la Pamela de Richardson), le genre s'orientait définitivement vers la comédie sentimentale ou « larmoyante » que le musicien servait désormais avec tous les artifices de l'opera seria, ses coloratures et ses castrats, ouvrant ainsi à l'opéra italien une nouvelle ère, tributaire également de l'influence française.
L'opéra en France après 1730
En abordant le genre à cinquante ans, avec sa grande maîtrise de musicien et de théoricien, Rameau (1683-1764) bouleversa immédiatement les traditions. Avec Hippolyte et Aricie (1733), « tragédie en musique » dans laquelle Campra vit « la matière de dix opéras », puis avec l'opéra-ballet les Indes galantes (1735), il avait, malgré l'approfondissement qui le conduira aux étonnantes Boréades (1764, inachevées), déjà dit l'essentiel : leurs difficultés d'exécution empêchèrent d'ailleurs la représentation intégrale de ces deux œuvres après lesquelles Rameau dut se montrer plus prudent, et, par conséquent, moins audacieux. Plus tard, le culte toujours porté à Lully et l'oubli conscient dans lequel Gluck et ses disciples firent tomber l'œuvre de Rameau ont laissé dans l'ombre le rôle joué par cet immense musicien, timidement redécouvert à l'aube du xxe siècle. Pratiquement inchangé depuis Lully, l'opéra avait néanmoins, sous la Régence, inspiré à Mouret un langage plus « gracieux » et cherché de nouveaux thèmes d'inspiration : en témoignent un divertissement allégorique de Clérambault, le Soleil vainqueur des nuages (1721), la Reine des Péris (1725), comédie persane de Jacques Aubert sur un livret de Fuzelier, ainsi qu'une représentation d'intermèdes italiens en 1729, et, la même année, un pastiche de divers auteurs français (le Parnasse). Enfin, le remarquable Jephté (1732) de Montéclair étant demeuré sans lendemain, on n'eut à opposer à Rameau que les dernières œuvres de Colin de Blamont (les Caractères de l'amour, 1738), de Mouret, Rebel et Francœur, ou celles de musiciens de second ordre comme Niel, Duplessis, Royer, Brassac, Mion, etc. Et les incursions au théâtre de Mondonville, de Boismortiers ou même de Jean-Marie Leclair (Scylla et Glaucus, 1746) ne constituèrent aucune prise de position déterminante.
Ce qui, dans l'œuvre de Rameau, dérouta d'instinct le public, dérangé dans sa quiétude, fut le « vacarme sans précédent » de son orchestre, et la subtilité d'harmoniste, qui le fit taxer d'italianisme. On ne put, à leur création, exécuter ni le trio des Parques d'Hippolyte et Aricie, ni le tremblement de terre des Indes galantes. Mais, au-delà de ces apparences immédiates, la réforme ramiste était d'une autre ampleur, en dehors même de la richesse rutilante de son langage, richesse qu'il dispensait avec la même prodigalité dans les scènes tragiques et les plus insignifiantes ariettes de pastourelles, sachant s'accommoder sans démériter de la frivolité ambiante. On peut en dire autant de ses librettistes, Pellegrin, Fuzelier, Marmontel ou Cahuzac, dont les vers avaient peu à envier à ceux de Quinault, justement jugé par Boileau.
En outre, démontrant péremptoirement que « la tragédie conte et l'opéra montre », Pellegrin bâtit son drame comme un négatif de Phèdre de Racine, tirant de trois vers l'acte superbe de la descente aux Enfers, et « visualisant » de la même façon le récit de Théramène. Démentant le titre même de l'opéra, Rameau sut faire de Thésée et de Phèdre deux très grandes figures tragiques de l'histoire de l'opéra, créant pour elles un langage sans commune mesure avec celui de Lully. Ajoutons enfin que Rameau sut démontrer sa disponibilité à un comique musical (Platée, 1745), créer une ouverture thématiquement liée à l'action (Zoroastre, 1749), pour souligner encore que son œuvre contenait déjà tout ce que le xixe siècle croira, de bonne foi, avoir découvert.
La Querelle des bouffons et la naissance de l'opéra-comique
Lorsque, en 1752, la troupe des « bouffons » de Bambini donna à l'Opéra de Paris des intermezzi de da Capua, de Latilla, de Jommelli, et La Serva padrona de Pergolèse, dans une production très soignée, cette dernière œuvre, passée inaperçue six ans plus tôt à la Comédie-Italienne de Paris, fut à l'origine d'une querelle littéraire restée fameuse, mais reposant sur un profond malentendu. Croyant opposer le « naturel » du genre buffa italien à la « science » de l'opéra de Rameau, les pamphlétaires exaltèrent la musique italienne contre la musique française en général, sans prendre garde que le débat n'opposait que le choix des thèmes, et que leurs conclusions auraient été différentes si le hasard avait mis en présence un opera seria italien et un vaudeville chanté français. En fait, Rousseau, humilié dans ses ambitions musicales et jaloux des succès de Rameau (succès artistiques et succès mondains), usa d'arguments qui n'honoraient pas l'expert musical de l'Encyclopédie. Il ne comprit guère qu'un public de bon sens avait d'abord ressenti la perfection du spectacle présenté par les Italiens dans cette même salle de l'Opéra, où régnait habituellement une affligeante médiocrité au niveau de l'exécution musicale. Mais, pour absurde que fût cette querelle, qui permit aux encyclopédistes d'acquérir un regain de faveur dont ils avaient grand besoin, elle n'en permit pas moins de mettre en lumière la nécessité de créer un véritable opéra-comique français de qualité.
Deux hommes devaient coordonner au mieux, en ce domaine, diverses tentatives éparses, le directeur Monnet et Charles Simon Favart (1710-1792). Librettiste, acteur, homme de théâtre complet et époux d'une excellente cantatrice et actrice, ce dernier dut se limiter, jusque vers 1750, au genre très en vogue de la parodie (Rameau se réjouissant du renfort de publicité que lui valait un Hippolyte comique), avant de trouver en Duni un musicien apte à mettre en partitions d'authentiques livrets.
Or, entre-temps, le véritable opéra-comique était né des suites de la Querelle des bouffons. En effet, après avoir écrit « qu'il ne saurait y avoir de musique française, sinon de très mauvaise », Rousseau composa en français un Devin du village (1752), véritable opéra-comique, à cette différence près que, au lieu d'y être parlés, les dialogues de l'action étaient chantés à la façon du récitatif italien. Et l'œuvre fut donnée à Fontainebleau, chantée par les meilleurs interprètes de Rameau. Dès lors, l'Opéra afficha avec succès des pastiches d'operas buffas italiens, et Monnet eut l'idée de présenter à l'Opéra-Comique en 1753 les Troqueurs, faisant passer cette œuvre d'Antoine Dauvergne (1713-1797) futur directeur de l'Opéra pour la traduction d'un opera buffa italien. L'œuvre fut acclamée, et l'on rit de bon cœur une fois la supercherie révélée, donnant ainsi sa place à une véritable musique française, chantée en français ! Mais, d'abord, l'Opéra-Comique afficha une version française de la Servante maîtresse de Pergolèse, que Mme Favart chanta plus de 100 fois en 1754, Favart, lui-même, put y donner Ninette à la cour, puis, en 1757, le Peintre amoureux de son modèle, mis en musique par Egidio Romualdo Duni (1709-1775), auteur de drames joués à Rome et à Florence, puis passé au service de la cour francophone de Parme. Et, seulement alors, des musiciens français se piquèrent au jeu. Philidor (1726-1795) et Monsigny (1729-1817) s'affirmèrent en 1759, le premier avec Blaise le savetier, que suivirent Sancho Pança dans son île (1762), puis le Sorcier (1764), Tom Jones (1765), etc. ; l'autre avec les Aveux indiscrets, puis Rose et Colas (1764).
Et, grâce à la fusion intervenue en 1762 entre l'Opéra-Comique et la Comédie-Italienne (sous cette dernière dénomination), les compositeurs bénéficiaient des meilleurs acteurs et cantatrices des deux troupes, pouvant ainsi écrire pour leurs héroïnes de difficiles arias à coloratures, mais ils purent également s'assurer de la collaboration de Sedaine, qui rédigea pour eux non plus de simples livrets bouffons, mais de véritables pièces de théâtre, tout comme le faisait outre-monts un Goldoni. Lorsqu'en 1769 parut le Déserteur de Sedaine et de Monsigny (l'œuvre fut jouée jusqu'en Amérique), c'en était fait des idylles villageoises prônées par Rousseau, l'opéra-comique n'avait plus rien de comique et tournait au drame larmoyant (ou « pièce à sauvetage ») auquel l'Europe entière allait souscrire. La même année, soit cinq ans après la mort de Rameau, Grétry s'affirmait à Paris, y précédant de peu l'arrivée de Gluck. Un nouveau chapitre de l'opéra français allait alors s'ouvrir.
L'ère des réformes
La réforme de l'opera seria
La révélation de l'opéra français à Parme fut sans doute le catalyseur d'une remise en question de l'esthétique métastasienne, déjà amorcée depuis 1740 par divers compositeurs et critiques italiens.
L'intendant du Tillot avait engagé Duni à la cour française de Parme pour lui confier les livrets de Favart, puis convié Goldoni à adapter Pamela pour ce même musicien. Dès 1757, il fit jouer des opéras de Rebel et Francœur, puis de Rameau, qui suscitèrent des traductions italiennes, puis des adaptations originales conçues dans le même esprit, mais pour lesquelles les livrets dus à Frugoni laissèrent trop à désirer. Or, comme Jommelli quelques années plus tôt, Traetta avait déjà pressenti ce besoin de renouveau, et les œuvres qu'il donna à Parme (Ippolito ed Aricia en 1759, puis en 1760 I Tindaridi, d'après Castor et Pollux de Rameau) correspondaient à une conception mûrement réfléchie ; ces œuvres eurent un retentissement jusqu'à Vienne où Gluck les écouta avec attention.
Outre Traetta (1727-1779) et Jommelli (1714-1774), d'autres musiciens italiens devaient s'engager sur la voie de ce renouveau. On peut citer, avant P. A. Guglielmi, Anfossi, Sacchini et Piccinni, Davide Perez (1710 ou 1711-1778), et, plus encore, Domenico Terradellas (1713-1751), l'un des meilleurs disciples de Pergolèse et qui fut particulièrement attentif au rôle de l'orchestre. On note déjà chez Terradellas le procédé du crescendo dans Bellerofonte (1747). Enfin, Gian Francesco Di Majo (1732-1770), un Napolitain, auteur de musique religieuse et d'opere serie, fut joué jusqu'à Vienne, et son style semble établir un pont entre Gluck et Mozart. D'autres innovations devaient compléter cette réforme de l'opera seria, dont on trouve l'écho chez un Mattia Verazzi, qui fournit des livrets à Jommelli, Traetta, Salieri, et chez Coltellini et quelques autres encore : celles de réintroduire la catastrophe finale toujours récusée par le public, d'instaurer la coupe en 2 actes du dramma seria (v. infra), et surtout de substituer au traditionnel défilé des arias de solistes des duos, trios, ensembles et interventions du chœur, comme on les trouve parfaitement intégrés dans Antigona de Traetta (Saint-Pétersbourg, 1772), qui y traite avec une grande maîtrise le récit dialogué et les arias bipartites ou tripartites.
La « réforme » de Gluck
Allemand formé à Milan, Gluck fut, dès 1741, remarqué par Métastase pour son « feu insolite », mais bientôt condamné pour ses « bruyantes originalités ». Rompu au style italien, mais témoignant aussitôt de son intérêt pour l'orchestre et pour la colorature aiguë, typique du goût allemand, il fut commissionné à Vienne pour y adapter les textes de Favart auxquels il conféra un galbe musical d'une tout autre ampleur que les musiciens d'opéra-comique français. Il y rencontra en 1761 Raniero de'Calzabigi (1714-1795), poète arcadien, qui, à Paris, avait vécu la Querelle des bouffons et publié la Lulliade, satire raillant ce type de joutes littéraires. Auteur, en 1755, de l'essai à la gloire de Métastase (dont, vingt ans plus tard, il ne critiqua que la coupe des vers), chassé de Paris, où il avait fondé avec Casanova une loterie dans des conditions assez douteuses, Calzabigi découvrit à Vienne les courants réformistes grâce aux opéras de Traetta. S'attribuant leur paternité, il reprit mot pour mot dans la fameuse Préface d'Alceste (1768), qu'il fit prudemment signer par Gluck, les préceptes déjà résumés par Algarotti. Calzabigi avait trouvé en Gluck le collaborateur idéal, fortement hostile, comme lui, aux « abus » des chanteurs, et également intéressé par le ballet, le décor et l'importance à réserver au chœur. Leur commun Orfeo ed Euridice (1762) eut pour principal mérite d'exclure de la fable tous les personnages secondaires, et de parvenir, dans la scène des Enfers, à une osmose parfaite entre le chant soliste, le chœur et l'effet visuel.
Dans Alceste (1767), qui ne répondait en rien aux objectifs énoncés a posteriori dans la Préface, Gluck conservait les ritournelles d'introduction et « le disparate entre le récit et l'aria », dont le da capo, sans son ornementation, perdait toute raison d'être. Or, la puissance expressive de la musique masque les erreurs du livret de Calzabigi, sa mythologie anecdotique et désengagée, son dénouement heureux, ses chœurs demeurés témoins et non acteurs, et son absence d'ensembles concertants. Et, si ce livret resserrait l'action, la musique « auxiliaire du poème » lui opposait sa lenteur hiératique. Après un retour aux formules traditionnelles, Gluck se fixa en France, en 1774, y donna des versions assez heureusement remaniées d'Orphée et d'Alceste, réalisa sur le vieux livret de l'Armide de Quinault un pastiche des meilleures pages de ses opéras antérieurs, et fut opposé à Piccinni dans une nouvelle « querelle » qui ne lui fit guère honneur. Il signa enfin avec Iphigénie en Tauride (1779) son chef-d'œuvre, dont la qualité musicale faisait derechef oublier les schémas traditionnels, cependant que l'ouverture était reprise d'un opéra-comique de 1758, et l'air tragique Ô malheureuse Iphigénie d'un opera seria de 1753. En résumé, Gluck s'était, lui aussi, imposé par son génie musical, éclipsant par là ses rivaux italiens, plus engagés que lui dans les courants réformateurs, alors qu'il était revenu aux stéréotypes de l'opéra lullyste, effaçant ainsi l'immense apport dramatique de Rameau.
Dramma giocoso et opera semiseria
On a longtemps attribué le triomphe du genre buffa sur le seria, au xviiie siècle, au « naturel » de ses personnages. Sans doute le nouveau style galant et pathétique convenait-il mieux aux villageois et aux marquis de la comédie qu'aux héros empanachés de la tragédie. Mais c'est plus encore la souplesse et la variété de ses structures qui triomphèrent des formules sclérosées du vieil opera seria. Dès que les arias à coloratures et les castrats eurent acquis droit de cité dans la comédie lyrique, les publics aristocratiques goûtèrent, eux aussi, cette forme, que ses ensembles et ses finales pleins de vie rendaient autrement attrayante. En outre, l'opera buffa défini comme tel avait vécu lorsque, en 1760, Piccinni donna et à Rome ! sa Cecchina (autre titre de La Buona figliuola), une œuvre qui devait autant à la consistance musicale et vocale de l'opera seria qu'à la véracité de l'opera buffa ou du dramma giocoso. Pour sa part, Goldoni attira à Venise le méridional Gaetano Latilla (1711-1788), qui utilisa le dialecte vénitien dans L'Amore artigiano (1761), et établit les lois de cette comédie d'intrigues, sentimentale et lyrique, dont les sept personnages venaient tirer la moralité devant le rideau comme plus tard dans les opéras de Mozart. C'étaient, dans les deux cas, les prémices de ce drame larmoyant qui devait conduire jusqu'au Fidelio de Beethoven, en 1805 ; dès lors, au terme d'opera buffa se substituent le plus souvent ceux de commedia, dramma giocoso, ou, bientôt, semiseria.
C'est à tort que l'on souligne l'antithèse des épithètes « drame » et « joyeux », ce premier terme n'ayant, en italien, aucune implication tragique ; c'est d'abord le livret qui est ainsi défini, soulignant son ambition littéraire ou la classe sociale de ses personnages, et visant à une plus grande dignité que l'opera buffa, encore suspect pour l'aristocratie. C'est toutefois sa structure que l'opéra buffa légua à ses héritiers, avec son récitatif secco et ses ensembles, si bien que, de façon générique, le terme s'appliqua encore longtemps à la comédie, au dramma giocoso et à l'opera semiseria, bien que ce dernier genre parfaitement défini par la Nina de Paisiello, en 1789 impliquât un contexte social particulier. Nicola Piccinni (1728-1800) s'illustra dans ces genres, comme Guglielmi, Anfossi, Sarti, et plus tard Salieri (v. infra).
Mais les meilleurs représentants de ce nouveau style « napolitain » furent Giovanni Paisiello (1740-1816) et Domenico Cimarosa (1749-1801), tous les deux d'origine méridionale, formés à la difficile discipline de l'opera seria et de la musique instrumentale, et tous les deux réclamés à Vienne et à Saint-Pétersbourg. Paisiello, demeuré célèbre pour son Barbier de Séville (Saint-Pétersbourg, 1782) et sa Molinara (1788), offrit, avec Nina pazza per amore, un premier type de scène de folie, souscrivit au découpage en 2 actes de l'opera seria Fedra (1788), donna, avec Elfrida (Naples, 1792), sur un livret de Calzabigi, le premier exemple de drame médiéval à fin tragique, et obtint son meilleur succès dans le genre eroicomico avec son Re Teodoro in Venezia (Vienne, 1784) sur un livret de Casti. Cimarosa, mieux connu aujourd'hui, laissa, comme lui, son nom attaché à ses comédies, dont le Mariage secret (Vienne, 1792), intitulé en fait melodramma (c'est-à-dire opera), et bien proche de ses structures, et Giannina e Bernardone (1781), mais il mania aussi bien le satirique (L'Impresario in angustie, 1786) et le tragique : son opera seria Gli Orazi ed i Curiazi (1796) est tenu pour l'achèvement le plus parfait du genre entre la Clémence de Titus de Mozart et les premiers drames de Rossini.
Mais c'est à Vienne, où vit précisément Mozart, que règne la plus intense activité lyrique et où se retrouvent, s'affrontent et se pillent effrontément les meilleurs poètes et musiciens. On s'y passionne pour le jeu esthétique, pirandellien avant la lettre, du « théâtre dans le théâtre », qui inspire à Mozart, Cimarosa et d'autres maint Impresario, et aboutira en 1814 au sarcastique Turc en Italie de Romani et de Rossini ; Calzabigi avait, en 1769, écrit pour Florian L. Gassmann (1729-1774) L'Opera seria, où le directeur se nomme Faillite, le poète Délire, le castrat Ritournelle, et la prima donna « Qui détonne ». Ce jeu fut cultivé par Coltellini, et par Casti (1724-1803), qui écrit Prima la musica, poi le parole (1786), mis en musique par Antonio Salieri (1750-1825). Salieri, rival heureux de Mozart, auteur d'une œuvre instrumentale de qualité, avait écrit, en 1778, Europa riconosciuta pour l'inauguration de la Scala de Milan, puis succédé à Gluck à Paris, mettant en musique Beaumarchais dans Tarare (1787), puis Shakespeare dans Falstaff (Vienne, 1799) ; il fut aussi l'un des collaborateurs de Da Ponte. Ce dernier, librettiste de Mozart, de Martin y Soler (1754-1806), de Storace, etc., entra en conflit avec Giovanni Bertati (1735-1815), l'un des poètes d'opéra les plus originaux de l'heure, s'appropria la paternité de son Mariage secret et emprunta plus d'une de ses pages, de son Don Giovanni au Convitato di pietra ; ce dernier livret rédigé par Bertati en 1787 pour Giuseppe Gazzaniga (1743-1818).
L'Allemagne et l'Autriche : naissance du singspiel
D'ethnies et de religions différentes, les pays germaniques partageaient une même méfiance de leurs princes envers toute tentative nationale d'un art de langue allemande, ces princes soutenant l'opéra italien. Comme Hasse à Dresde et Graun à Berlin, Ignaz Holzbauer (1711-1783) fut à Stuttgart un excellent auteur italianisant, comme le furent à Vienne Gassmann, Gluck et Wagenseil (1715-1777), auteurs qui influencèrent Sarti et Naumann, dont l'activité se déploya au Danemark, en Suède ou en Russie. Et si l'œuvre lyrique de Haydn nous paraît dominer l'opera seria et semiseria de son époque, de même que les premières tentatives de langue allemande, le cadre des représentations privées auquel il les destina lui refusa le rôle historique qu'il eût pu alors assumer.
Avant que le singspiel (pièce chantée) ne se définisse comme l'équivalent de l'opéra-comique, mais d'une singulière épaisseur orchestrale, ce terme avait recouvert les diverses tentatives d'opéra national héritées de l'opéra baroque et du ballad opera du Nord, où Gottsched, dédaignant la fiction inhérente au genre, vantait l'absolue priorité du texte, et où Johann Adolf Scheibe (1708-1776) baptisa singspiel dès 1749 des œuvres dont il écrivit livret et musique. À Vienne, vers 1750, le terme s'applique aux spectacles du fameux Bernardon, sortes d'équivalents de la commedia dell'arte, Haydn écrit Der Krumme Teufel (v. 1751-1753, perdu), et on joue des comédies lyriques de Josef Starzer, Franz Aspelmeyer, etc. D'autres types d'opéra allemand apparaissent aussi. A. Schweitzer (1735-1787) met en musique l'Alceste de Wieland (1773), adoptant les schémas ramistes, mais en négligeant totalement le chant, selon l'opinion de Mozart, qui vante au contraire Gunther von Schwarzburg (1776) de Holzbauer, influencé par Jommelli. On prise encore la forme du mélodrame (ou mimodram, tanzdrama, etc.), où la musique soutient un texte entièrement parlé, genre qu'illustra parfaitement Benda (v. infra), pour lequel Goethe écrivit Proserpine (1777), et auquel collabora aussi Haydn (Philemon und Baucis, Dido, etc.), puis Neefe, Reichardt, Zumsteeg, ceux-là mêmes que l'on retrouve à la naissance du véritable singspiel et du lied. Retardé à Vienne par la divulgation des œuvres de Favart, ce singspiel naîtra au Nord, dès la fin de la guerre de Sept Ans : dans Der Teufel ist los (1766), Johann Adam Hiller (1728-1804) emprunte encore à divers musiciens, puis compose Die Jagd (1770), où apparaît l'influence de Hasse.
D'autre part, lorsque Reichardt écrit la partition de la Claudine von Villabella de Goethe (1773), créée en 1789, c'est le texte qui prévaut, et la musique devait donner ses lois au genre, grâce à Georg (Jiři) Benda (1722-1795), qui usa de sa très riche orchestration dans der Dorfjahrmarkt (1775), où l'aria da capo se mêle aux couplets sentimentaux, aux airs de bravoure et aux chœurs populaires (dont Weber s'inspirera dans son Freischütz en 1821). Benda fit appel aux sources les plus variées (Julie und Romeo en 1776, der Holzhauer en 1778), et écrivit Medea (1775) et Ariadne auf Naxos (1775) dans la forme du mélodrame. Enfin, Belmont und Constanze de Johann André, donné à Berlin en 1781 sur un texte de Bretzner, servit de modèle à Mozart (l'Enlèvement au sérail, 1782), lorsque Josef II eut ouvert à Vienne un Singspiel Nazional Theater, inauguré en 1778 avec die Bergknappen de Ignaz Umlauf (1746-1796), sur l'œuvre de qui Mozart modèlera ses personnages de singspiel Osmin et Papageno. Comme Mozart, Franz Teyber (1758-1810) et Josef Weigl (1766-1846) écrivirent aussi de difficiles arias à coloratures, afin d'attirer les cantatrices du Théâtre de cour, voué à l'opéra italien et à l'opéra français. Une fois le Théâtre du singspiel fermé pour « subversion », le Kärtnerthortheater, à Vienne, accueillit les singspiels très italianisants de Dittersdorf (1739-1799), alors que, au contraire, pour un public plus populaire, Schikaneder, imprésario de petites salles, mêlait le couplet populaire à la féerie, comme dans Oberon (1789) de Wieland et de Wranitzky (1756-1808) et dans la Flûte enchantée de Mozart (1791). Mais les compositeurs de singspiel durent à nouveau collaborer avec le Théâtre de cour, lorsque, après la mort de Josef II et de Leopold II, les modèles étrangers s'imposèrent à nouveau. Or, c'est sous le règne de Josef II que Mozart avait réussi une synthèse des genres, à laquelle avait également contribué l'influence française.
La France après Rameau
La mort de Rameau, en 1764, avait ramené à l'Opéra Mondonville (dont il faut aussi signaler Daphnis et Alcimaduro, en langue d'oc, en 1754) et les compositeurs d'opéra-comique. Mais Gluck y ayant imposé un style différent, c'est aux compositeurs italiens que l'on demanda de venir perpétuer son action. Piccinni donna avec succès Roland (1778), puis Atys (1780), Iphigénie en Tauride (1781) et une superbe Didon (1783), Jean-Chrétien Bach vint de Londres écrire un Amadis de Gaule (1779) sur le livret de Quinault, Anfossi « renonça à écrire pour les chanteurs français », et Antonio Sacchini (1730-1786) donna Renaud, Chimène et Dardanus (1784), mais mourut sans connaître le succès réservé à Œdipe à Colone (1786), parfaite fusion du génie italien et français. Or, après les Danaïdes (1784), et Tarare (1787) de Salieri, l'arrivée de son rival Cherubini en 1788 allait apporter un sang nouveau à l'opéra français.
L'opéra-comique était, dès 1769, un genre parfaitement adulte, non seulement digne de l'opéra, mais autrement représentatif de la culture française. Grétry (1741-1813), dédaignant justement l'opéra, lui consacra un authentique talent acquis à Rome, et écrivit de véritables arias virtuoses pour les cantatrices de la Comédie-Italienne dans Zemire et Azor (1771) et la Fausse Magie (1775), puis, toujours avec la collaboration de Sedaine, s'orienta vers d'autres sujets (Raoul Barbe-Bleue, 1789) et aborda le thème historique avec Richard Cœur de Lion (1784), Guillaume Tell (1791), ou Pierre le Grand (1790) sur un livret de Bouilly, l'auteur de Léonore. À ces ambitions, Nicolas Dalayrac (1753-1809) opposa la sentimentalité de sa Nina, folle par amour (1786), pièce à sauvetage de Marsollier, que reprendra Paisiello et qui suscitera d'autres adaptations, comme il en fut de son Renaud d'Ast (1787), dont Mozart se souvint dans la Flûte enchantée.
Comme Grétry et Dalayrac, Gossec, Méhul, Lesueur et d'autres sacrifièrent aux sansculottides de la Révolution, puis renouèrent avec la tradition, comme Cherubini, Paër, Henri Berton (1767-1844), auteur de Montano et Stéphanie (1799) et Aline, reine de Golconde (1803), comme Jadin, Catel, Gaveaux et le Maltais Niccolo, dit Isouard (1775-1818), auteur des Rendez-vous bourgeois (1807) et du Billet de loterie (1811). En outre, le genre de l'opéra-comique, contraint à l'alternance du parlé et du chanté par le fait du monopole de l'Opéra, n'en disposait pas moins de plusieurs salles parisiennes et étendait son domaine : la pièce à sauvetage (par exemple, la Léonore de Bouilly, mise en musique par Gaveaux, Paër, Beethoven et Mayr) recourut à l'exotisme (par ex. toutes les Lodoiska), ou céda au mythe avec Médée de Cherubini (1797) sur un livret de Fr. B. Hoffmann, qui s'inspira aussi de l'Arioste (Ariodant, de Méhul, 1798). Mais avec le Normand Boieldieu (1775-1834), qui promena ses héros dans de nombreux pays, on assiste à un retour vers un opéra-comique plus traditionnel, dans une langue soignée. Après trente années de succès, il introduisait le romantisme dans le genre, avec la Dame blanche, inspirée de Walter Scott, qui triompha en 1825, l'année où le Devin du village quittait l'affiche. Son livret, signé Eugène Scribe, appartenait à une nouvelle époque de l'opéra-comique, déjà marqué par les premiers succès d'Auber et d'Hérold.
La synthèse mozartienne
L'opéra de Mozart, s'il domine à nos yeux toute la production de son époque, n'eut pas alors l'impact qu'on suppose, dans la mesure où il ne semblait pas apporter d'innovations formelles. La trop grande complexité de ses livrets ne plaidait guère en sa faveur, tous ses arguments avaient déjà été traités par d'autres musiciens (sauf celui des Noces de Figaro, trop récent) et ses emprunts aux auteurs de singspiels, à Traetta, Salieri, Paisiello, Dalayrac, etc., suivaient la coutume établie. Fidèle à la tradition du lieto fine, à l'emploi du castrat d'opera seria, Mozart semblait même en retrait sur ses prédécesseurs par les structures traditionnelles de ses opere buffe : le récit, rarement accompagné (sauf en des occasions significatives), demeure bien séparé de l'aria, aria avec da capo ornementé, cavatine ou aria tripartite sans participation du chœur. Peut-être aurait-on pu déjà s'inquiéter de la longueur inhabituelle de ses finales, de la présence du fantastique dans la scène du banquet de Don Juan, de la souplesse du discours dans Idoménée (opéra qui connut justement le succès), du surprenant premier finale de la Clémence de Titus, ou du ton grave d'un singspiel comme la Flûte enchantée. Mais c'est de l'intérieur que Mozart, plus subtilement, avait miné l'édifice. Dès l'âge de quatorze ans, il avait osé suggérer le choix d'un livret (il sera, dans sa maturité, le véritable coauteur de ceux-ci), et c'est par la musique qu'il devait résoudre les véritables problèmes, jusque-là objets de vaines querelles d'ordre littéraire, et affirmer une unité de pensée que ses contemporains ne pouvaient déceler.
À la proposition de Gluck de « réduire la musique à sa seule fonction de seconder la poésie », Mozart répondit que « la poésie devait être la fille obéissante de la musique », et réalisa l'osmose entre le verbe et le son, parce que sa musique épousait le tempo intérieur du livret, ce que n'avaient compris ni Gluck ni les Italiens, dont les tentatives de renouveau étaient ainsi vouées à l'échec. Pour réussir, Mozart tâta d'abord de tous les genres, du singspiel à la sérénade, de l'opéra-comique à l'opera seria, du buffa au dramma giocoso et à la comédie, puis réalisa enfin avec Idoménée une première synthèse des structures du seria, par son fréquent usage des ensembles, par la participation des chœurs à l'action, donnant ainsi raison à Traetta contre Gluck. Et, malgré le succès obtenu par Idoménée, son intuition lui dicta de récuser cette mythologie vidée de son contenu pour s'engager sur la voie autrement exigeante d'un « mythe de l'homme contemporain » (cf. M. Beaufils), choisissant précisément pour cela le langage plus accessible du singspiel (« Je me sens pris de fièvre à l'idée de créer l'opéra allemand », avait-il écrit), ou de l'opera buffa, dont il asservit les composantes à l'idée. C'est pour lui un jeu d'insuffler à ces formes « faciles » la densité du genre tragique, d'établir des rapports affectifs entre la tonalité des scènes et des arias, de mettre en situation les coloratures apparemment les plus traditionnelles, ou d'introduire dans un opera buffa des caractères d'opera seria (Donna Anna et Donna Elvira) et quelques rares récitatifs accompagnés d'une étonnante intensité.
Et c'est même en termes musicaux, presque anodins, que Mozart souligne l'univers manichéen de la Flûte enchantée, opposant le parlé au chanté, et situant le Bien et le Mal aux deux pôles inconciliables de la voix humaine, alors que, dans ses drames italiens, l'ambiguïté des diverses facettes du chant souligne les terrifiantes imbrications entre ce Bien et ce Mal, considérés comme les deux faces complémentaires d'un même univers, où « le langage du buffa se présente comme le masque du tragique » (cf. M. Beaufils), où la perfection esthétique voulue de Cosi fan tutte se distancie encore mieux d'une réalité plus tragique que celle de Don Juan. Enfin, héros du Sturm und Drang, engagé dans le combat pour l'émancipation de l'être, Mozart se place au centre d'une œuvre dont il fait une unique et constante confession, en posant, dès l'Enlèvement au sérail, le problème de la revendication des droits de l'individu, qu'après les orages des trois opéras italiens il résout, et, à nouveau, avec la langue allemande dans la sagesse ambiguë de sa Flûte enchantée, en 1791. Notons que, cette même année, avant de disparaître à trente-cinq ans, Mozart parvient aussi avec la Clémence de Titus à faire éclater les vieilles structures de l'opera seria. Et cette étonnante synthèse nous rappelle qu'il appartient en priorité à la musique de triompher des problèmes d'éthique et d'esthétique, fût-ce à l'aide des structures les plus traditionnelles.
L'opéra dans les autres centres européens
Les modèles italiens, français, puis allemands dominent dans toutes les cours, où s'amorce le même processus de traductions, puis de véritables créations autochtones.
La Russie
Pierre le Grand ayant imposé une culture de type franco-allemand, les comédiens français paraissent à Saint-Pétersbourg dès 1729, et c'est d'Allemagne que provient, en 1731, un Italien de la troupe de Hasse, Ristori, qui y présente un de ses opere buffe, La Calandro, cependant que des intermezzos italiens sont bientôt traduits en allemand et en russe. Mais, dès 1735, le Napolitain Francesco Araja (v. 1709 -1770) y élit domicile, fait applaudir d'abord sa Forza dell'amore e dell'odio, puis écrit en 1737 Il Finto Nino, et se consacre à l'opéra métastasien et au ballet français. Bientôt traduites en russe, ses œuvres alternent en 1742 avec de nouveaux spectacles français. En 1755, c'est enfin sur une traduction préalable du livret qu'il écrit directement en russe Céphale et Procris, cependant que G. B. Locatelli produit une nouvelle troupe italienne en 1757, que Raupach donne en 1758 un Alceste en russe, et que les Français, revenus en 1762, conservent toujours les préférences de la cour. Pourtant, les meilleurs musiciens italiens y occuperont désormais sans interruption des charges officielles : Vincenzo Manfredini de 1758 à 1769, Galuppi de 1765 à 1768, Traetta jusqu'en 1775, Paisiello jusqu'en 1783, Cimarosa de 1787 à 1791, Martin y Soler de 1788 à 1794, tandis que Giuseppe Sarti (1729-1802) se fixe à Saint-Pétersbourg en 1784. Formé à Bologne, ayant triomphé à Venise et à Rome, Sarti avait séjourné vingt années à Copenhague, et il sut poser les bases d'un riche enseignement classique, préparant ainsi le terrain au Vénitien Cavos, qui, dès 1797, allait devenir le premier grand compositeur « russe ».
Parallèlement à cette culture aristocratique, on traduit des singspiels, et des opéras-comiques de Philidor, Duni, Grétry, Dalayrac, Dezède, etc. Des chanteurs russes se mêlèrent aussi à la troupe du Français Clairval, l'interprète fameux de Grétry, et, à Moscou, l'Anglais Michael Maddox organise des spectacles dès 1776, fonde en 1780 le théâtre Petrowsky, largement ouvert aux productions russes, cependant que, comme le fait Herder en Allemagne, on recense le vieux fonds païen national. Et, si l'opera buffa s'installe victorieusement à Saint-Pétersbourg, c'est surtout à Moscou et dans l'ancienne Russie que s'amorce un mouvement irréversible : durant une trentaine d'années, des musiciens russes allaient créer des vaudevilles faits de refrains populaires célèbres, parfois mâtinés d'influences étrangères, œuvres souvent composites et sans cesse modifiées et réadaptées. Un mystère plane toujours sur une éventuelle Tanioucha (1756 ?), un vaudeville de Volkov, et on ne peut affirmer non plus quel musicien (Dimitriewski, Pashkevitch ?) composa la partition de Aniouta (Tsarskoïe Selo, 1772), un acte de M. Popov, qui passe pour le premier « opéra » de fonds et d'auteurs russes.
Enfin, alors que le Devin du village de Rousseau fait fureur et suscite les pastiches et imitations de Kerzelli ou Zorine, le premier succès authentique du genre fut un Meunier magicien, écrit par Ablesimov, et les couplets arrangés par Sokolowski, joué à Moscou en 1779, puis aussitôt à Saint-Pétersbourg, et encore repris en 1784 par le très sérieux Fomine. De nombreux autres vaudevilles apparurent, dans les deux capitales, notamment le Bazar de Saint-Pétersbourg (créé en 1782), œuvre en 3 actes de Mikhaïl Matinski (un serf émancipé qui avait étudié en Italie), et, plus tard, Catherine II écrivit des livrets, où alternaient le fonds historique et le thème quotidien, livrets où se mêlaient parfois les musiques de Sarti, Cannobio, Martin y Soler, celles de Matinski et surtout celles de Pashkevitch (v. 1742-1797), qui illustra son premier livret, Fevey, en 1786. Mais, à Saint-Pétersbourg surtout, le goût français reste dominant, et c'est dans cette langue que seront d'abord écrits certains opéras-comiques, dont peut-être l'Avare (Skoupoï, 1782) de Pashkevitch.
C'est toutefois grâce à leur formation acquise à Bologne ou Venise que trois musiciens russes devaient imposer une plus forte personnalité : Maxime Berezowski (1745-1777), qui, après avoir écrit des opéras métastasiens, revint organiser la chapelle impériale ; son successeur Dimitri Bortnianski (1751-1825), qui écrivit 7 opéras, encore bien cosmopolites (le Faucon, en 1786, comme le Fils rival [1787] sont composés sur textes français) ; et enfin Evgueny Fomine (1761-1800), qui, après son retour d'Italie, en 1786, mit aussi en musique les livrets de l'impératrice, adhéra à la formule du mélodrame avec chœur (Orphée et Eurydice, créé 1792), dans une langue qui évoquait Mozart, Salieri et Gluck, puis, avec les Américains (1800) et la Pomme d'or (posth.), un véritable opéra, affirma un réel sentiment national. Et lorsqu'en 1798 Paul Ier interdit l'opéra italien, la relève semblait assurée.
L'Angleterre
Il fallut d'abord y effacer l'héritage national pour imposer d'abord des traductions d'intermezzos, dès 1705, et, peu à peu, le véritable opéra italien, chanté par des troupes italiennes. On applaudit d'abord des ouvrages anciens de Bononcini, de Mancini (Idaspe fedele, 1710), avant les créations originales de Haendel (Rinaldo, 1711) et de Porpora. C'est à cet opéra italien, autant qu'à l'aristocratie londonienne corrompue, que s'en prend en 1728 The Beggar's Opera, une satire assez féroce, arrangée selon la forme du ballad opera, par J. C. Pepusch (1667-1752). Son succès confirma la virtualité d'un opéra anglais, ce dont Haendel tira la leçon, avec ses oratorios, puis Thomas Arne (1710-1778), qui reprit la tradition du mask (Alfred, 1740, contient le fameux Rule Brittania), traduisit Métastase, adoptant toutefois les schémas haendéliens (Artaxerxès, 1762), et appliqua à son Love in a Village (1762) la formule du pasticcio. On peut citer encore les opéras-comiques de Charles Dibdin (1745-1814), de Samuel Arnold (1740-1802), de Michael Arne et de William Shield (1748-1829), l'arrivée à Londres en 1787 de Stephen Storace, ami de Mozart, qui y fit rejouer ses œuvres italiennes, leur adaptant un texte anglais, puis, au xixe siècle, les opéras de H. Bishop, de culture cosmopolite, et de M. Balfe, un épigone de Rossini. Mais la fin du xviiie siècle fut essentiellement dominée à Londres par l'activité menée par Jean-Chrétien Bach (1735-1782), formé à Milan, mentor, puis ami de Mozart, qui écrivit peu en anglais, mais fit régner un opéra italien de grande qualité.
La péninsule Ibérique. Espagne
Dans ce pays, marqué par la présence de Domenico Scarlatti, puis du castrat Farinelli, devenu conseiller politique et fondateur de l'opéra italien, on en vint néanmoins à traduire préalablement les poèmes de Métastase (José Durán, formé à Naples, écrivit Antigono en 1760), et Ramón de la Cruz réécrivit Goldoni pour Pablo Esteve, Manuel Pla, ou Antonio Rodriguez de Hita (1704-1787) : La Buona figliuola devint La Buena hija (Esteve) et Gli Uccellatori devinrent Los Casadores, zarzuelas ou tonadillas escénicas. Hita donna, en 1763, Briseida, zarzuela heroica, et la collaboration de Cruz et Hita produisit encore Las Segadores de Vallecas (1768), tiré de la légende de Ruth, une zarzuela burlesca, comme en 1769 Las Labradoras de Murcia, avec jotas et seguedilles, tambourins et castagnettes, consacrant aussi, comme en Italie, en un genre autonome les intermezzos espagnols, qui, dès 1758 (cf. Los Ciegos, de Luis Míson), furent intercalés dans les opéras italiens, lesquels continuaient sans peine à triompher de ces œuvrettes, modèles des futures espagnolades de l'opéra français.
Portugal
Deux noms y marquèrent principalement l'implantation de l'opéra italien, ceux de l'Italien Davide Perez (1710 ou 1711-1778 ?) et du Portugais Francisco de Almeida. Ce dernier, formé à Rome, revint donner à Lisbonne en 1733 un dramma comico, La Pazienza di Socrate, que suivirent en 1735 La Finta pazza, et, surtout, en 1739 La Spinalba, étonnante anticipation du dramma giocoso. Perez, fort de son expérience acquise à Naples et à Palerme, écrivit dès 1752 des « opérettes » portugaises, et fonda en 1755 l'Opéra de Lisbonne, aussitôt détruit par le tremblement de terre. Parmi de bons musiciens autochtones, citons João de Sousa de Carvalho (1745-1798), qui, formé à Naples, composa en italien (L'Amore industrio, 1769) et prit la succession de Perez, alors que, à l'inverse, Marcos António da Fonseca Portugal écrivit d'abord en 1784 des œuvres d'un comique de qualité en portugais, puis s'en alla faire carrière en Italie sous le nom de Portogallo.
Les pays scandinaves
Danemark
Ce pays avait, de longue date, accueilli les opéras français et joué les opéras baroques de Keiser. Sarti y implanta l'opéra italien de 1753 à 1775, puis le Viennois J. G. Naumann (1741-1801), élève de Martini à Bologne, écrivit en danois des opéras métastasiens. Les thèmes nationaux furent ensuite exploités par T. C. Walter (1749-1788), E. J. G. Hartmann (1726-1793), et F. L. A. Kunzen (1761-1817), auteur de Holger Danske (1789).
Suède
L'opéra italien connut une intense activité sous Gustave III ; le Théâtre de Drottingholm ouvrit en 1754 sous la direction de F. Uttini (1723-1795), qui écrivit d'abord en italien, puis composa en suédois Thetis och Pelee (1773), sur un texte du roi (l'oncle de Frédéric II, lui aussi féru de livrets). Naumann, quittant le Danemark pour la Suède, y écrivit Cora och Alonso en 1782 pour l'inauguration de l'Opéra royal, puis Gustaf Wasa (1786), alors que des auteurs suédois commençaient à s'imposer : Stenborg (1752-1813), avec Konung Adolfs jagt (1777), puis J. M. Kraus (1756-1792), d'origine allemande, qui réalisa la synthèse des divers styles européens avec Proserpine (1781) et Aeneas i Carthago (1790, créé en 1799). L'assassinat du roi, en 1792, interrompit pour quelque temps le développement de l'opéra suédois.
Le xixe siècle
Fait culturel et social, l'opéra fut le reflet du grand mouvement d'idées, dont était issue la Révolution française. Ouvert à un public nouveau, il avait, parfois, déjà modifié ses thèmes, contribuant à l'éveil des consciences nationales. En abolissant les frontières, l'aventure napoléonienne allait faire de l'opéra italien un opéra européen, fécondant et fécondé par ces échanges. En effet, ses formules trop anciennes se sclérosaient alors que les structures instrumentales, nées du siècle de la raison, étaient en plein essor. La disparition du castrat, entraînant la mort du bel canto, art de plaisir fût-ce au sens fort du mot, conduira au drame romantique à forte implantation instrumentale, et le thème antique cédera définitivement au thème historique, conçu non plus comme prétexte anecdotique, mais comme fait politique, exaltant des héros d'un type nouveau. La comédie sentimentale, le drame « héroïque », ou buffa, et l'opéra-comique, tributaires de l'ère de la sensibilité, s'effaceront devant la tragédie, ou bien, perdant leur dignité musicale, céderont à une opérette nationale de qualité. Enfin, la notion d'école, qui avait jusque-là prévalu, fera place à un autre héros romantique, le compositeur, génie solitaire plus que meneur d'hommes.
La France entre deux révolutions
Un certain opéra-comique d'ancien régime s'y maintiendra jusqu'à la veille de 1830. Mais les frontières se faisant moins précises entre les genres, c'est sous toutes les formes et dans tous les pays que la pièce à sauvetage, devenue libertaire et romantique, va envahir l'Europe, où on ne compte plus les Lodoïska, Léonore, Caverne, Porteur d'eau ou Raoul de Créqui. Toutefois, avant que le thème médiéval ne s'impose seul, le Consulat et l'Empire avaient suscité quelques œuvres inspirées par la Gaule ou la Rome impériale. En France, où les Italiens s'étaient implantés avant même la Révolution, Cherubini (1760-1842) avait déjà su épouser la manière française, s'illustrant d'abord dans le genre « héroïque », puis dans le mythe : plus encore qu'Elisa (1794), Médée (1797) est romantique, par ses structures plus ouvertes, par son écriture vocale et chorale, par la justification même du geste meurtrier de l'héroïne ; avec les Abencérages (1813), Cherubini consacrait plutôt le fait historique, dans une tradition gluckiste enrichie, puis il abandonnait la scène lyrique. Auprès de lui, les meilleurs artisans de cet opéra français avaient été Étienne Méhul (1763-1817) et Jean-François Lesueur (1760-1837), grands inspirateurs de Berlioz ; le premier avec Stratonice (1792), le Jeune Henry (1797) [d'une écriture modale très prophétique], l'Irato et surtout Uthal (1806), Joseph (1807), puissants drames avec chœur et orchestre ; le second avec Ossian ou les Bardes (1804), largement déclamé, fourmillant de trouvailles instrumentales.
Mais Gasparo Spontini (1774-1851) avait porté plus haut ces ambitions, offrant avec la Vestale (1807) le prototype de la tragédie lyrique : au chant, très italien, se mêlent une harmonie audacieuse et une orchestration très présente, riche et diversifiée ; ses structures totalement ouvertes, héritées de l'Œdipe à Colone de Sacchini, abolissent toute fragmentation au cours d'un acte, et sont encore autant d'éléments dont se nourriront Berlioz et Wagner. On peut tenir pour négligeable l'apport de Rodolphe Kreutzer (1766-1831) dont la Mort d'Abel (1810) enflamma pourtant un instant Berlioz et celui de Jadin, Gardel, Miller, Candeille, Lefebvre, Porta, Kalkbrenner et même de Steibelt, Winter et Gyrowetz. Paris sut encore attirer Paisiello (Proserpine, 1803) et Ferdinando Paër (1771-1839), qui souscrivit au style Empire (Numa Pompilio, Cleopatra, 1810) et qui prit la direction du Théâtre-Italien. Désormais consacré aux œuvres étrangères, ce théâtre devint le pôle le plus actif de la capitale l'Opéra semblant somnoler au début de la Restauration jusqu'à l'arrivée de Rossini et d'Auber.
L'interrègne italien
Stendhal a justement baptisé ainsi cet apparent no man's land situé entre la mort de Mozart et le retrait de Cimarosa et Paisiello, d'une part, et l'avènement de Rossini en 1810, de l'autre. Quinze années qui voient ses meilleurs musiciens quitter l'Italie. Les quelques compositeurs restés fidèles à la péninsule, réduits aux yeux des historiens au rôle de « précurseurs de Rossini », furent en outre éclipsés par une sorte de quarteron cosmopolite, Cherubini, Spontini, Paër et Mayr, qui se partagèrent, excepté Mayr, entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Paër donna le meilleur de son talent à Vienne (Camilla, 1799), à Dresde, où sa Leonora (1804) apparaît comme un trait d'union entre Mozart et Beethoven, et revint créer Agnese di Fitz-Henry en 1809 à Parme ; son Maître de chapelle (Paris, 1821) n'ajouta plus rien à son talent. En revanche, c'est l'Italie qui retint le Bavarois Mayr (1763-1845), qui y surclassa tous ses rivaux. Pédagogue, musicologue, découvreur de talents (il révéla le poète Romani en 1813), il reprit à son compte les apports de Traetta et de Salieri dans une langue qui évoquait Mozart et Beethoven, et il esquissa certaines formules auxquelles Rossini appliquera son génie : l'ouverture de forme sonate, le récitatif accompagné vocalisé, l'imbrication du récit et de l'aria, etc. Moins fait pour le semiseria que pour le drame, Mayr révéla son talent avec des sujets de type médiéval (Ginevra di Scozia, 1801 ; Adelasia ed Aleramo, 1806 ; La Rosa rossa e la Rosa bianca, 1813), et son nom reste attaché à sa Medea in Corinto (Naples, 1813), qui éclipsa longtemps l'opéra de Cherubini.
C'est seulement dans l'ombre de Mayr que survivent aujourd'hui les noms des très prolixes Tritto (1733-1824), pédagogue renommé à Naples, Trento (1761-1833), Portogallo (1762-1830), Nicolini (1762-1842), Nasolini (1768-1806 ou 1816), Farinelli (1769-1836), Orlandi (1777-1848), des Autrichiens Winter (1754-1825) et Weigl (1766-1846), que dominent toutefois quelques personnalités plus accusées : Guglielmi junior (1763 ?-1817), Giuseppe Mosca (1772-1839) et son frère Luigi (1775-1824), Valentino Fioravanti (1764-1837). C'est un rôle important, mais plutôt négatif que joua Nicola Zingarelli (1752-1837), qui eut la haute main sur l'enseignement à Naples, entendant faire respecter les principes d'avant 1760 : estimant que « Mozart aurait pu bien faire s'il avait persévéré dans l'étude », il se dressa plus tard contre les innovations de Rossini. On décèle déjà certaines de ces innovations chez Stefano Pavesi (1779-1850), dont l'écriture vocale est plus humaine, plus moderne ; chez Carlo Coccia (1782-1873) et Pietro Generali (1783-1832), qui revendiquèrent puérilement « l'invention » du crescendo, ce qui ne doit pas masquer leur talent réel ; et chez Francesco Morlacchi (1784-1841), qui eut la sagesse d'abandonner la place et s'en alla mettre sa veine assez riche au service de l'Opéra italien de Dresde. Enfin, Nicola Manfroce (1791-1813), disparu prématurément, avait démontré dans Ecuba (1812) un génie comparable à celui de Rossini sur le plan de l'écriture vocale et orchestrale.
La place de Rossini
Jamais aucun créateur n'aura pesé autant sur l'évolution de l'opéra. Il en reçoit l'héritage des mains de Cimarosa, et, en moins de vingt années, l'amène aux portes du drame historique romantique. Or, la critique romantique tardive n'a trop longtemps vu en lui qu'un excellent auteur d'opere buffe, sans prendre garde qu'il se détourna à moins de vingt-cinq ans d'un genre qui ne représente que moins du quart de son œuvre. Pur Italien, formé à la dure discipline instrumentale, il écouta, à la différence de ses compatriotes, la leçon venue du Nord et se nourrit de Haydn et de Beethoven, mais surtout de Mozart, alors réputé injouable en Italie. Il fit siennes les meilleures trouvailles de ses « prédécesseurs », les incorporant en un tout cohérent, mais il fut accusé, en son temps, d'écrire une musique trop audacieuse, trop bruyante, et de sacrifier le chant à l'instrument. Fidèle à la pensée de Winckelmann sur la virginité de l'art, il affirma que « la musique ne peut rien exprimer d'autre qu'elle-même », et fut, pour cela, rejeté par les romantiques qu'il avait pourtant annoncés, et seulement réhabilité à l'époque de Stravinski (cf. dans la Poétique musicale).
Comme Mozart, Rossini donna des solutions musicales aux problèmes soulevés par le livret, refusa une union du verbe et du son fondée sur le mot à mot, et, réaffirmant la vieille théorie des affetti (l'aria exprimant un sentiment, dont seul le texte suggère la signification), il put, l'un des derniers après Bach, Haendel, Gluck ou Mozart, transposer une même phrase musicale d'une situation à une autre, qu'elle fût comique ou sérieuse. Témoin de son époque, Rossini avalise dès 1810 la mort du vieil opera buffa. Dans cette forme, il donne désormais la thématique à l'orchestre qu'il traite avec humour et tendresse, reléguant le chant des personnages buffo à une sorte de parlando rythmique, et il donne au couple amoureux une effusion purement lyrique, détachée de tout contexte comique. En 1813, l'Italienne à Alger conclut en feu d'artifice l'histoire de l'opera buffa et la vis comica de l'auteur s'abritera désormais derrière la satire (le Turc en Italie), ou la comédie sentimentale (le Barbier de Séville, Cendrillon), où les caractères comiques et pathétiques sont nettement définis. Dès 1813, aussi, avec Tancrède, d'après Voltaire, il avait confirmé son désir d'émanciper le dramma seria : il en enrichira progressivement l'harmonie (Otello, 1816), élargira considérablement son orchestre (Ermione), ses chœurs (Mosè), et assouplira l'ancien schéma mozartien (récit-aria-cabaletta) par de fréquentes imbrications entre les divers types de récit (récit simple ou largement vocalisé, secco ou dialogué avec l'orchestre), le chœur, et l'aria dont il rajeunit aussi la formule du da capo, dans une rigoureuse unité musicale, tonale et souvent thématique.
De même, Rossini juxtapose des structures fermées, mais très variées, et de vastes architectures « ouvertes » dans lesquelles il insère parfois de brefs arias ou duos (ainsi que de fréquents ensembles a capella) exprimant l'affetto. Alors que Mozart avait insufflé une grandeur tragique à la formule du buffa, c'est au seria que Rossini donne toute la richesse et la liberté des structures de l'opera buffa, avec ses ensembles et finales concertants, audace qui eût été impensable dix ans plus tôt. Agissant également sur le matériau, il utilise une instrumentation souvent insolite et redistribue les emplois, dans un chant où l'expression ne néglige pas une très riche ornementation qu'il fixe en grande partie lui-même ou qu'il modifie pour mieux l'assortir aux qualités de ses interprètes successifs. Embrassant tous les types de sujet antique, médiéval, religieux, historique, fantastique, shakespearien et même romantique (La Donna del Lago, d'après W. Scott), Rossini demeure indifférent au vers, mais s'attache à la construction du livret : l'opéra devient un drame en 2 actes, dont l'action atteint son maximum de complexité dans le finale du premier acte, qui rassemble tous les participants, puis se dénoue en laissant la conclusion (où, plus d'une fois, il essaya d'imposer à un public réticent la fin tragique nécessaire), soit à l'héroïne, soit même à l'orchestre seul.
Fixé en France en 1825, Rossini s'adapta au genre glucko-spontinien, puis instaura, avec Guillaume Tell (1829), d'après Schiller, un nouveau type d'opéra français, drame politique, romantique, orchestral et choral plus que virtuose, peu adapté à sa nature profonde, mais dont la formule allait, avec plus ou moins de bonheur, être reprise par plusieurs générations. Enfin, ayant agi sur le chant avec la même détermination que Beethoven sur la technique du piano, il avait, au contraire de Gluck, Wagner et Debussy, dont les a priori ne convinrent qu'à eux-mêmes, posé les bases d'un langage et de structures parfaitement viables, mais dont la leçon allait être balayée par le vent de la grande tourmente romantique.
Naissance de l'opéra allemand
Le vieux rêve de Mozart s'était réalisé après sa mort, avec le succès de sa Flûte enchantée, succès qui découragea toute imitation, à l'heure précisément où les souverains, effrayés par la Révolution française, soutenaient plus que jamais un opéra hédonistique, et alors que les plus grands compositeurs allemands accordaient tous leurs soins aux formes instrumentales et au lied. Wranitzky, Weigl et Winter plièrent donc le singspiel à la colorature belcantiste, ainsi que Beethoven dans sa malheureuse version initiale de Fidelio (1805), opéra dont il fit en 1814 un autre chef-d'œuvre, l'ayant profondément remanié, mais où, tirant l'anecdote vers le mythe, il n'imposa pas pour autant de formule nouvelle. C'est également au singspiel que souscrivirent Weber (1786-1826) dans ses premières années, ainsi que Schubert : ses 12 opéras écrits de 1813 à 1823 demeurent étrangers à l'esprit du Sturm und Drang, dont ses lieder furent à la fois la plus haute expression et l'idée dont devait surgir le drame wagnérien. Meyerbeer (1791-1864), élève comme eux de Salieri, abandonna vite la langue allemande (la Fille de Jephté, et Abimelech, 1813) pour l'opéra italien ; on ne trouve ni romantisme ni nationalisme chez E. T. A. Hoffmann, qui mit en musique, non ses propres Contes, mais Goethe (Scherz, List und Rache, 1801-1802, perdu) et surtout La Motte Fouqué (Undine, 1816), non plus que chez le violoniste Ludwig Spohr (1784-1859), qui demeura un classique dans der Zweikampf mit der Geliebten (1811), Faust (1816), et même dans Jessonda (1823), un drame de plus larges proportions.
En revanche, avec son Freischütz (1821), Weber avait mieux saisi l'essence d'un véritable « folklore » spirituel national, grâce aux chœurs et danses populaires, aux couplets de singspiel qui s'y mêlent à l'aria tripartite à coloratures et au « diabolisme » facile de quelques scènes, tandis qu'il peut justifier son sous-titre d'opéra romantique par l'utilisation parfaitement inouïe de l'orchestre, dans la scène magique de la Gorge aux loups. Son Euryanthe (1823) apprivoisa à la langue allemande un type de grand opéra de forte implantation franco-italienne, et Oberon (écrit primitivement en anglais) offrit, en 1826, un excellent retour à un singspiel mêlé de féerie, où la colorature voisinait au mieux avec un orchestre aux fins descriptives étonnantes. C'est d'un singspiel beaucoup plus simple que se réclament les opéras d'extrême jeunesse de Mendelssohn (1809-1847), avant l'apparition de cet « opéra-biedermeyer », sorte de singspiel colossal et bourgeois qu'illustrèrent K. Kreutzer, Lortzing et Flotow (v. infra). Une étape décisive vers le véritable opéra romantique fut franchie par Spontini, qui, fixé à Berlin, puisa dans le fonds nationaliste avec Agnes von Hohenstaufen (1829 et 1837), et atteignit, par l'épaisseur et la durée de l'œuvre, à la dimension du « grand opéra », puis par Heinrich Marschner (1795-1861), qui allia le populaire à l'historique dans Henri IV et d'Aubigné, d'après Kleist (1820), dans le Templier et la Juive (1829), dans Hans Heiling (1833), et qui approcha le fantastique dans son chef-d'œuvre, le Vampire (1828), autre trait d'union entre Weber et Wagner.
Les générations de 1830
De 1825 à 1829, Boieldieu avait posé la plume, Weber, Beethoven et Schubert disparaissaient, et Rossini se retirait l'année même où, à Londres, un castrat parut encore sur scène. En 1830 Paris assiste soudain à la bataille d'Hernani, à la révolution de Juillet, et à la création de la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz. La littérature russe naît, réaliste avant l'heure, les nationalismes s'embrasent, et le piano moderne transpose les fureurs orchestrales de Berlioz, tandis que Duprez lance son « ut de poitrine », que le violon de Paganini acquiert une dimension de fantastique, et que la danse sur pointes suggère, au théâtre, un nouvel irréel. On conteste dès lors aux chanteurs une virtuosité « gratuite » qu'on acclame sans réserve chez pianistes et violonistes. Une génération s'éveille dans un monde nouveau, et Chopin, Schumann et Liszt, qui s'apprêtent à bouleverser les lois de l'écriture, ont juste vingt ans, comme, à peu d'années près, Berlioz, Bellini, puis Verdi, Wagner et Dargomyjski, nés en 1813, ainsi que Kierkegaard, Büchner et Claude Bernard. L'esthétique du spectaculaire s'impose à nouveau en France, et, à Paris en 1831, c'est sa mise en scène qui assure le triomphe de Robert le Diable de Meyerbeer plus diabolique que fantastique alors que l'ancien rapport entre le chant et l'orchestre tend à s'inverser, les émules de Duprez devant, en outre, compter avec un nombre croissant d'instruments. Avec son éthique, l'esthétique de l'opéra se modifie, dans la conception de ses structures (où l'acte continu se substitue peu à peu à la formule du pezzo chiuso) ; dans son langage où la théorie des affetti s'effacera peu à peu devant une illustration musicale de l'action épousant le mot à mot du texte ; enfin, dans son genre même qui impose de nouvelles lois au livret.
Alors que l'Europe entière achève de découvrir Shakespeare, les romantismes les plus divers s'entrechoquent : Scott et Byron, Schiller et Goethe pour qui la Grèce n'est plus celle de Winckelmann, mais celle de la révolte de l'Homme contre les dieux et la nature , Lamartine et Leopardi, Hugo enfin, plus accessible à la masse, qui crée l'image du héros romantique, damné de la terre, banni et proscrit par une société injuste ; au lieto fine métastasien succédera la mort violente ou cathartique du héros pur ou de l'héroïne virginale. Le thème historique sera définitivement engagé dans une historicité de type hégélien, et la déraison ou, à un niveau plus élevé, la négation schopenhauerienne du vouloir-vivre imposera à ces thèmes nouveaux une langue nouvelle, où le mot sera sonorité autant que véhicule d'idée. Au néoclassicisme sublimé du poète Romani succédera la langue échevelée du livret de cape et d'épée de Cammarano, et aux grâces de Pixérécourt l'octosyllabe héroïque et ampoulé de Scribe, cependant que Wagner rédigera lui-même des poèmes d'opéra d'une langue hermétique, où le verbe est incantation plus que facteur d'action. Enfin naîtra la notion de répertoire : Mozart, Gluck et Rossini ne quitteront plus l'affiche, et, en 1832, Fétis fait jouer l'Orfeo de Monteverdi, première en date de toutes les « exhumations » à venir ; et cet aspect d'un conservatisme louable tendra à éloigner peu à peu certains publics du créateur, lui aussi héros et titan : en 1835, on compte encore plus de 100 créations lyriques, mais, en 1860, ce chiffre tombera à moins de 30. Dans cette époque aux nationalismes exacerbés, chaque pays devait apporter sa ou ses solutions propres.
L'Italie aux temps romantiques
Malgré tout leur talent, on peut tenir pour nul le rôle joué par les épigones de Rossini : Carafa (1787-1872), qui vécut dans son ombre, Michele Costa (1808-1884), fixé en Angleterre, l'excellent Carlo Coccia (1782-1873), déjà nommé, qui chercha à se renouveler, et même Nicola Vaccai (1790-1848), dont la Giulietta e Romeo (1825) rivalisa longtemps avec les Capuleti e Montecchi de Bellini. Plus original, un autre intime de Rossini, Giovanni Pacini (1796-1867), usa d'un langage assez neuf, mais s'en tint à des thèmes passés de mode (la Vestale, 1823 ; Saffo, 1840 ; Médée, 1843), tandis que Saverio Mercadante (1795-1870) marquait d'une personnalité plus forte ses sujets, mieux adaptés aux temps nouveaux : Il Giuramento (1837), d'après Hugo, Il Bravo (1839), qui exploite le thème du proscrit, Il Reggente (1843) annoncent plus nettement Verdi que les œuvres d'un romantisme plus aristocratique de Bellini (1801-1835) et de Donizetti (1797-1848).
Ces deux musiciens avaient, avant même 1830, compris quel langage il fallait désormais prêter à ces héros poursuivis par une inexorable fatalité : Bellini, disparu en 1835 sans avoir donné sa pleine mesure, sut réaliser un équilibre idéal entre le monde de la poésie désespérée de Leopardi et l'univers sonore de Chopin. Romantique de vocation, original dès la première note, il opta naturellement pour l'architecture continue de l'acte et chercha un type de chant incantatoire (Norma et Sonnambula, en 1831), incantation renforcée par l'usage du leitmotiv et dont l'entière liberté rythmique rappelait l'antique sprezzatura de Caccini et de Monteverdi, et qui influença Chopin. Décantant avec grand soin son harmonie, Bellini confia à ce chant, plus tendu vers l'aigu que celui de Rossini, l'essentiel du message affectif. Et cette osmose entre le vocal et le contenu dramatique lui permit de tracer des portraits terriblement humanisés de ses héroïnes languides ou vengeresses, de ses héros, consumés, comme lui, par le mal du siècle, témoins ceux des Puritains (1835), un chef-d'œuvre « lunaire » avec scène de déraison, malheureusement compromis par un banal dénouement heureux. Excepté ce dernier cas, Bellini avait marié son chant au vers noble du poète Felice Romani (1788-1865), lié à l'esthétique néoclassique italienne.
Mais, cette même année 1835, Donizetti, qui avait, jusque-là, collaboré avec lui, se détourna de cette théorie du sublime, et, en écrivant Lucia di Lammermoor, d'après Walter Scott, souscrivait à l'esthétique du nouveau livret, dont Cammarano (1801-1852) donnait là l'archétype absolu, avec le « rêve clef », avec amours impossibles, scènes de folie et morts violentes. Il avait longtemps subi l'influence de Rossini, jusque dans l'Élixir d'amour (1832), dernier chef-d'œuvre du semiseria, et souvent démarqué Bellini, comme dans Anna Bolena (1830) ; ayant dégagé une personnalité plus marquée avec Lucrèce Borgia, d'après Hugo (1833), il réussit à assurer ce difficile équilibre entre l'ancien bel canto et un type de chant plus immédiat, délimitant mieux les caractères, instituant une sorte de manichéisme élémentaire des schémas vocaux dans cet antagonisme entre un ténor, incarnation du bien, et un baryton « vilain » ; antagonisme auquel souscrira l'opéra européen du xixe siècle. Mais, à l'heure ou Donizetti tentait avec Don Pasquale (1843) l'impossible résurrection du vieil opera buffa, il appartenait déjà à la puissante personnalité de Verdi d'opposer, en plein Risorgimento, une violence toute plébéienne à l'art aristocratique de ses prédécesseurs.
Éclipsant sans peine les Rastrelli, Marliani, Gordigiani, Lauro Rossi, Persiani, Coppola, Saldari, Nini, Speranza, Buzzi, Cagnoni, Foroni, Raimondi, etc., pourvoyeurs habituels des scènes italiennes, Verdi s'attache plus aux « situations fortes » qu'à la qualité du vers, traite la voix sans ménagement, truffe ses drames historiques d'allusions à peine voilées à la lutte contre l'Autriche (Nabucco, 1842 ; Attila, 1846), se réclame de Hugo (Ernani, Rigoletto), de Schiller (I Masnadieri, Luisa Miller, plus tard Don Carlos en 1867), et, dès 1847, de Shakespeare (Macbeth). Moins soucieux de structures que d'efficacité, il se contente d'enchaîner habilement les scènes et les airs, mais asservit la forme à chaque situation particulière. À partir de 1850, il délaisse le politique pour le social, ou l'humain (Rigoletto en 1851, Traviata en 1853), et s'attache à de nouveaux thèmes, ceux de l'amitié ou de la solitude du pouvoir, notamment avec Simon Boccanegra, Un bal masqué (1859), puis Don Carlos, 3 opéras qui témoignent aussi de recherches nouvelles sur le plan de l'écriture, et contiennent de grands ensembles vocaux d'une profonde efficacité psychologique, dans un théâtre où le chant n'est plus la raison d'être du drame. Sentant la situation lui échapper, il triomphe aisément de ses jeunes rivaux avec Aida (1871), où la trame fait la place belle au spectaculaire et au chant, puis, presque octogénaire, il renouera avec Shakespeare, à l'aide des livrets plus élaborés mais moins fonctionnels de Boito, ce transfuge de la jeune scapigliatura : Otello (1887), un drame lyrique, et Falstaff (1893), une comédie ironique, ne seront plus que des chefs-d'œuvre hautainement solitaires, inscrits hors des aspirations des classes nouvelles. Cette glorieuse suprématie exercée pendant un demi-siècle avait, de ce fait, rejeté dans l'ombre le comique de qualité de Crispino e la comare (1850) de Federico et Luigi Ricci, et quelques talents plus souples qu'originaux : ceux d'Errico Petrella (1813-1877), auteur de Jone (1858) et des Promessi sposi (1869), d'après Manzoni, et de Filippo Marchetti (1831-1902), dont le triomphe de Ruy Blas (1869) demeura sans lendemain. Plus tard seulement, le véritable « après-Verdi » sera amorcé par Boito, Ponchielli et Catalani, avant l'éclosion du vérisme musical.
L'Allemagne
Un divorce s'accentue bientôt entre un art moribond entretenu dans les cours, et celui, trop difficile, de Wagner. La parenté avec l'opéra-comique français est indéniable chez Konradin Kreutzer (1780-1849), auteur du Veilleur de nuit de Grenade (1834), une solide « opérette » bourgeoise, et chez Friedrich von Flotow (1812-1883), qui, formé à Paris, s'essaie à l'opéra romantique (Alessandro Stradella, 1844) et assure son succès dans le monde entier avec l'aimable et habile Martha (1847) ; l'influence de Mendelssohn est notable, d'autre part, chez Albert Lortzing (1801-1851), auteur fécond et inspiré de Tzar et Charpentier (1837), l'Armurier, et de Undine (1845), où il aborde le fantastique, et plus encore chez Otto Nicolaï (1810-1849), auteur des brillantes Joyeuses Commères de Windsor (1849). Après 1850, c'est l'influence de Liszt et de Wagner qui se fera aussi sentir chez Peter Cornelius (1824-1874), dont le Barbier de Bagdad (1858) fit scandale à sa création, puis celle de Brahms chez Max Bruch.
Pourtant, auprès de ces professionnels de l'opéra-biedermeyer, on ne peut que mentionner l'effort isolé de Schumann. Sa Genoveva (1850) manque d'une rigueur dramatique qui fût à la hauteur de son inspiration musicale ; elle se situe plutôt dans la lignée de ses opéras de concert tels que Faust, ou le Paradis et la Peri, chefs-d'œuvre appartenant plus à la musique « pure ». Wagner (1813-1883), lui, possédait à fond ce professionnalisme : aussitôt joué, adulé ou haï, il rédige ses propres livrets, dès ses opéras de jeunesse inspirés par Auber, Weber, Spontini, puis Meyerbeer. Malgré le triomphe de Rienzi (1842) écrit dans le style de ce dernier, il renonce, comme Mozart après Idoménée, au succès facile, fondé sur des structures périmées, et préfère suivre une voie différente en donnant, par son œuvre, une réponse aux problèmes métaphysiques de l'heure. Dès 1843, le Vaisseau fantôme refuse toute concession à l'anecdote et fait du surnaturel la substance même d'un langage où l'orchestre est le protagoniste absolu, ne concédant aux chanteurs symboles plus que personnages d'opéra que des airs et ariosos parfaitement intégrés à la continuité du discours musical, dont le leitmotiv est à la fois la clef et un signal incantatoire. En outre, comme Mozart, Wagner se présente sous les traits du héros ici, le Hollandais en quête de rédemption portant à la dimension du mythe l'héritage de la vieille pièce à sauvetage.
Mesurant l'échec de conceptions aussi hardies, Wagner plaquera ce surnaturel sur un fonds historique (et nationaliste) dans Tannhäuser (1845) et Lohengrin (créé en 1850), retournant au découpage en airs, scènes et cortèges, et laissant ainsi l'auditeur mieux satisfait et libre de s'intéresser ou non au message rédempteur. Et c'est parce qu'il n'en escompte même pas la représentation scénique qu'il peut se livrer à la pure spéculation philosophique de Tristan et Isolde (créé en 1865), dont le thème même (l'essence profonde de l'amour, plus que la contingence sociale, le rend irréalisable) engendre un langage particulier aux modulations infinies, au discours sans solution de continuité, où le leitmotiv est plus explicite que le mot, simple prétexte à une effusion lyrique incantatoire, une solution quasi idéale au problème de l'androgynie originelle du verbe et du son. Wagner, qui n'avait pas cherché à créer un système, mais avait usé du seul langage qui convînt ici, retrouve néanmoins quelques-uns de ces postulats en composant les 4 longs drames qui constituent l'Anneau du Nibelung (1849-1874, créé en 1876), épopée et critique sociale, où la mythologie, redevenue mythe, ne sert que de toile de fond à une remise en question de l'humanité, sauvée de la volonté de puissance par le geste rédempteur de « l'héroïne ».
En outre, Wotan, le dieu des dieux, c'est encore Wagner lui-même, qui, en se peignant sous les traits d'un « voyageur », souligne par là cette affinité profonde avec Schubert, dont le lied, par ses thèmes mais aussi par sa technique, avait été la source véritable de son inspiration. Le piano, qui, avec Schubert, était acteur et témoin du drame, est ici porté à la dimension d'un orchestre multiforme, reflet du cosmos, pour cela écartelé de l'extrême grave à l'extrême aigu, et fonction incantatoire permanente. Reprenant instinctivement les options de Rameau, Wagner insère dans ce discours apparemment continu de véritables monologues d'action ou de réflexion, mêle récit et aria dans la formule presque unique de l'arioso, mais, par ailleurs, se prive des ensembles vocaux, raison d'être de l'opéra, à moins de n'en faire que des éléments du « décor » orchestral (cf. les Filles du Rhin). Sa colossale comédie pangermaniste les Maîtres chanteurs, puis l'ultime message de Parsifal (1882) n'apportaient désormais plus de renouvellement au langage de l'opéra, qui avait déjà pris d'autres directions. Mais, au-delà d'un possible « système », maintes fois dénoncé et maladroitement imité par des cohortes de médiocres, l'œuvre demeure davantage par sa remise en question de l'éthique même de l'opéra, et plus encore par l'originalité du langage musical, qui, sur le plan de l'écriture, avait définitivement rendu caduc tout retour au passé.
La France
Réservé à l'aristocratie et à la grande bourgeoisie, l'opéra ne peut alors s'y prêter à la revendication politique, viser au sacral, ni appeler au même consensus populaire que Verdi et Wagner. En outre, le Français, méfiant envers la fiction opéristique, fermé au surnaturel et peu soucieux d'exploiter son propre fonds merveilleux, ne désire ni surhomme, ni héros, mais un théâtre accessible, où Faust soit un homme de 1859. Le Paris de 1830, s'il attire les artistes du monde entier, n'est plus un foyer de création, mais un gigantesque lieu de consommation, où l'on célèbre le grand opéra, l'opéra-comique, l'opéra bouffe, l'opéra italien, l'opérette, la musique symphonique et la musique de chambre, chacun en un lieu bien précis, et pour des publics réservés, quasi incompatibles une situation presque inchangée de nos jours. Et c'est pourquoi les meilleurs musiciens du règne de Louis-Philippe ne tentèrent pas l'aventure lyrique Boëly et Alkan , s'y frottèrent à peine, ou en vain, comme Onslow et Berlioz. Le clivage de principe se poursuivra jusqu'à l'absurde entre opéra et opéra-comique, lorsque cette dernière forme aura renoncé aux dialogues parlés et repris à son compte la véritable tragédie humaine.
Plus tard, comme Carmen (1875), c'est à son public et non à celui, hautainement traditionnel, de l'Opéra que seront offerts Werther puis Pelléas et Mélisande. Car, avec sa formule, l'opéra-comique avait servi les audaces des encyclopédistes, celles de Méhul et de Cherubini ; plus tard, de véritables novateurs comme Gounod et Bizet s'en accommoderont, et, plus encore, Offenbach dont l'œuvre parodique, mais d'une exceptionnelle qualité théâtrale et musicale, triomphera sans peine des productions rétrogrades de l'opéra officiel. Le vieil individualisme français condamnera aussi bientôt la spécialisation du compositeur, telle qu'elle avait été pratiquée de tout temps. Sans lien d'école, l'opéra français sera alors défendu soit par quelques fidèles au talent trop modeste, soit par les plus grands compositeurs, mais qui ne lui accorderont qu'une parcelle de leur talent, sans se pencher sur ses problèmes spécifiques. Aussi bien le panorama qui suit ne peut-il que tenter d'ordonner quelques tendances, sans s'attarder sur la personnalité de chaque auteur.
L'opéra-comique
Le meilleur des successeurs de Boieldieu, Louis Ferdinand Hérold (1791-1833), admiré par Schubert, disparaît jeune à l'aube du règne de Louis-Philippe ; la place sera dominée pendant un demi-siècle par D. F. E. Auber (1782-1871), qui, après le succès du Maçon (1825), tenta de se démarquer de l'influence italienne, notamment avec Fra Diavolo (1830) ; collaborateur attitré de Scribe, il sut soigner son écriture vocale, approfondit les structures de ses opéras-comiques (que rien ne distingue de ses opéras), mais demeura indifférent à toute évolution de l'harmonie. Adolphe Adam (1803-1856) fut plus sensible à un discret romantisme, de même que le très traditionnel Ambroise Thomas (1811-1896), successeur d'Auber à la direction du Conservatoire en 1871, et, qui, malgré sa prolixité, attendit longtemps le succès que lui apportèrent le Caïd (1849) et surtout l'anachronique Mignon (1866). Et, s'il faut mentionner le talent original d'Hippolyte Monpou (1804-1841), les œuvres françaises de l'Anglais Balfe, de l'Allemand Flotow et de l'Italien Donizetti (la Fille du régiment, 1840), on peut dire que la pauvreté musicale de leurs rivaux et successeurs explique qu'une opérette de qualité, l'opéra bouffe d'Offenbach, et les œuvres plus audacieuses qu'accueillera Carvalho sur la scène du Théâtre-Lyrique aient pris le relais d'un genre moribond qu'entretinrent A. L. Clapisson (1808-1866), Albert Grisar (1808-1869), François Bazin (1816-1878), Louis Aimé Maillart (1817-1871), Victor Massé (1822-1884), Ferdinand Poise (1828-1892), Fr. A. Gevaert (1828-1908) jusqu'à Benjamin Godard (1849-1895), qui, à la veille de l'éclosion naturaliste, pouvait encore écrire un Jocelyn (1888), dont la musique semble se référer à l'époque du poème de Lamartine.
L'opéra
En raison de leur trop faible audience, les chefs-d'œuvre de Berlioz (1803-1869) demeurèrent en marge de toute évolution : c'est essentiellement sa difficulté d'exécution qui fit échouer Benvenuto Cellini (1838), qui sublimait sans peine le genre, et c'est au public de concert que le musicien préféra offrir sa Damnation de Faust (1846), seule authentique expression du romantisme musical français, dont les maladresses de l'écriture vocale comptent moins que la richesse de l'orchestration et du poème, dû également à Berlioz. Les Troyens (composés en 1856-1858) qui ne furent même pas joués alors intégralement, malgré un lyrisme bouleversant ne constituaient plus qu'un hommage superbe au néoclassicisme de type glucko-spontinien, en dehors des courants nouveaux. Quant au « grand opéra », il apparaît surtout comme un domaine réservé au spectaculaire, à la danse, et aux livrets d'Eugène Scribe (1791-1861), dramaturge habile à brosser de grands tableaux et des situations fortes à l'aide d'alexandrins et d'octosyllabes sonnant admirablement, malgré leur syntaxe souvent défectueuse : on a surnommé « opéra Franconi » (du nom du fameux directeur de cirque) ce genre pompeux, pour lequel les Auber et Adam n'avaient guère les épaules assez larges, mais auquel satisfirent les productions de Meyerbeer, savamment écrites pour la voix, bien orchestrées : élagués d'inutiles effets extérieurs, les Huguenots (1836) et le Prophète (1849) sont beaucoup mieux que des témoignages d'époque, cependant que l'Africaine (1865, posth.) démontrait une grande capacité de renouvellement.
Meilleur musicien, J. F. Halévy (1799-1862), le maître de Bizet, laissa, avec la Juive (1835), le chef-d'œuvre de ce genre auquel souscrivirent encore Donizetti (la Favorite, 1840 ; Dom Sebastien de Portugal, 1843, etc.) et Verdi (les Vêpres siciliennes, 1855), mais aussi Louis Niedermeyer (1802-1861) et Félicien David (1810-1876), égarés dans un monde peu accordé à leur nature sensible, et plus tard Gounod, Saint-Saëns et Massenet, qui ne livreront pas là non plus le meilleur d'eux-mêmes. La formule survécut davantage avec A. Thomas, dont Hamlet (1868) offre un effort de renouvellement, puis avec les obscurs Auguste Mermet (1810-1889), auteur de Roland à Roncevaux (1864) et Labarre, Duprato, Joncières, Eugène Diaz, Paladilhe (Patrie, 1887), mais surtout avec Ernest Reyer (1823-1909), qui, dans Sigurd et Salammbô, sut encore, au-delà de 1870, combiner avec talent l'héritage de Berlioz et de Meyerbeer.
Le renouveau et l'opéra lyrique
Léon Carvalho, après avoir ouvert la salle du Théâtre-Lyrique aux chefs-d'œuvre étrangers du passé, sut y accueillir David et Berlioz, puis Saint-Saëns, Delibes, Bizet (v. infra), mais surtout Charles Gounod (1818-1893). Ayant su écouter la leçon venue d'Allemagne, cet authentique musicien avait dérouté les spectateurs de l'Opéra (Sapho, 1851), mais révéla sur cette scène une veine intime plus heureuse avec le Médecin malgré lui, Faust (1859, écrit avec dialogues parlés, et sans ballet), Mireille (1864) et Roméo et Juliette (1867), ouvrages dont le chant tout en demi-teintes, allié au type de livret « petit-bourgeois », délimitait parfaitement un opéra lyrique de demi-caractère, authentiquement français, justement exalté par Debussy, et dont, après 1870, Massenet offrira une image rassurante.
L'éveil des nationalismes
En Italie, en Allemagne et même en France, l'opéra fut, à sa manière, « national ». Mais les nationalismes qui s'éveillèrent ailleurs, liés à l'émancipation de nouvelles ethnies, devaient naturellement être édifiés sur un folklore épique ou musical, limitant ainsi une expérience à laquelle seule la Russie saura donner une portée universelle.
L'Espagne
La tonadilla avait survécu avec Laserna, Moral et Manuel García (l'interprète de Rossini), plus tard avec F. Sors, et Gomis, cependant que J. C. de Arriaga, mort à vingt ans, donnait à Bilbao en 1820 des Esclavos felices, qui évoquaient plutôt Schubert. Dès 1830, le vieux processus du xviiie siècle se reproduisit : on traduisit les opéras italiens, puis des Italiens vinrent écrire en espagnol, alors que, au contraire, Tomas Genovès (1806-1861) donnait el Rapto (1832), puis se fixait en Italie. Les poèmes de Métastase, traduits, furent mis en « zarzuelas » par Baltasar Saldoni (1807-1889), Ramón Carnicer (1789-1855) et Don Hilarion Eslava y Elizondo (1807-1878), auteur de las Treguas de Ptolemeida (1842). Ce genre composite se perpétuera avec Francisco Gomès, Ignacio Ovejero, puis Cuyas, Rovira, Gironella, Grassi, Sariols, et Joaquin Espin Guillén (Padilla o el asedio de Medina, 1845), lorsqu'en 1856 s'ouvrit à Madrid le Teatro de la zarzuela, réservé au théâtre espagnol authentique, comique ou sérieux.
À l'origine, la zarzuela grande était en fait un opéra en 3 actes, plus proche de celui d'Auber ou de Donizetti que de l'ancienne tonadilla, comme en témoigne Jugar con fuego (1851) de Francisco Asenjo, dit Barbieri (1823-1894). De même, Emilio Arrieta (1823-1894) obtint plus de succès en transformant sa Marina en grand opéra (1871) ce que Gounod venait de réaliser avec Faust , dont le style évoquait plus Verdi que celui des véritables auteurs nationaux. C'est dans la zarzuela authentique qu'excella un Joaquin Gaztambide (1822-1870), auquel succédèrent les auteurs de zarzuelas pequeñas Ruperto, Chapi, Giménez, et Tomas Breton (1850-1923). Ce dernier écrira même un opéra de trempe vériste (la Dolorès, 1895), au moment où Albéniz, Granados et De Falla s'essayent au contraire à la zarzuela populaire avant d'élargir leurs horizons. Face à la toute-puissance de l'opéra italien, il faudra longtemps pour imposer un véritable opéra national. Felipe Pedrell (1841-1922), qui fut avec Asenjo-Barbieri le père de la musicologie espagnole, écrivit en catalan le Dernier Abencérage (1874) et les Pyrénées (1902), qu'on créa à Barcelone… en italien.
La Pologne
Des vaudevilles y avaient paru dès le xviiie siècle, mais la Misère rendue heureuse (1778) de Kamiensky (1734-1821), le Miracle supposé (1794) de Jan Stefani, les œuvres de Jan Holland, puis de Josef Elsner (1769-1854), le maître de Chopin, se référaient plus au style galant de Mannheim qu'au fonds national. Celui-ci se dégagera grâce à Stanislas Moniuszko (1819-1872), qui fit de Halka (1847) la première œuvre autochtone véritable, puis utilisa largement le chœur dans Hrabina (1860) et dans Straszny Dwor (1865), sans toutefois faire école.
La Hongrie
Il est aisé de comprendre qu'un opéra magyar ne pouvait naître avant longtemps, et, encore au xixe siècle, c'est à l'étranger que Liszt, Goldmark, Heller, Remenyi, Kalmán, Lehar, etc., recherchèrent le succès. Parmi les plus anciennes tentatives nationales on retient, en 1793, Pikko Herceg et Jutka Perzsi de Josef Chudy, puis Béla Futása (la Fuite de Béla) de Ignác Ruzitska en 1822, avant l'affirmation d'une véritable école, née avec Ferenc Erkel (1810-1893), qui donna Báthory Mária en 1840, et surtout Hunyadi Laszlo (1844) et Bánk Bán (1861). Grâce à son action, Mihaly Mosonyi (1815-1870) put renoncer à écrire en allemand, et tira de l'épopée nationale Szép Ilon (1861) et Almos (1862, créé en 1934), où il eut recours au folklore verbunkos et aux chœurs populaires.
La Tchécoslovaquie
Avant que des frontières ne puissent aussi y définir une école, les musiciens originaires de Bohême avaient déployé une vaste activité autour de l'école de Mannheim : Benda, Kohut, Vorišek, Vranicky (devenu Wranitzky à Vienne), Tomašek écrivirent en allemand, ou en italien comme Myslivecek (1737-1781), que sut apprécier Mozart. Si les premiers essais en langue nationale remontaient à 1737, le chemin fut long avant la traduction en tchèque d'un opéra de cour viennois (la Famille suisse, de Weigl, en 1823) et l'ouverture de l'Opéra national, en 1826, avec Dráténík de František Škroup (1801-1862). La langue allemande y alterna longtemps avec le tchèque, et si Smetana choisit d'emblée l'épopée nationale (les Brandebourgeois en Bohême, 1866) et s'illustra dans la tragédie comme dans la comédie (la Fiancée vendue, 1866), il n'aborda guère plus les problèmes de la langue que Dvořák, dont Alfred (1870) fut écrit en allemand, et qui ne changea en rien son style dans Rousalka (1900) et Armide (1902), alors que Fibich, Foerster et déjà Janáček (v. infra) avaient virtuellement résolu la question.
L'opéra russe
À la mort de Fomine, on se souciait encore peu que l'opéra fût ou non l'expression profonde de la langue, mais Boieldieu devait pourtant être, de 1803 à 1811, le dernier hôte étranger qui l'ignorât. Parmi de nombreux Italiens venus encore tenter l'aventure, Catterino Cavos (1776-1840), après avoir abordé d'une même plume l'opéra-comique français et l'opérette russe, s'inspira dès 1803 du véritable fonds merveilleux slave, avec le Prince invisible, Ilya le bogatyr, l'Oiseau de feu et même Ivan Soussanine (1815), faisant preuve d'une science que ne pouvaient posséder les Alabiev, Titov, Varlamov et autres auteurs de romances à la mode. Si l'excellent Degtiariov (1766-1813) réserve au genre oratorio de véritables épopées populaires, et qu'Alexis Lwov (1799-1870), auteur de l'hymne russe, continue jusqu'à sa mort à écrire en italien et en allemand, Alexis Vierstowsky (1799-1862), dans un romantisme un peu naïf, dépasse largement les données du vieux vaudeville, et pose avec son Tombeau d'Askold (1835), demeuré longtemps à l'affiche, les bases mêmes des structures de l'opéra national.
C'est grâce à sa naissance aristocratique que Glinka (1804-1857) put acquérir une vaste culture cosmopolite, puis se faire ouvrir toutes les portes : sa Vie pour le Tsar (1836), qui reprend le sujet de Soussanine traité par Cavos et exalte un thème patriotique par excellence (la fondation de la dynastie des Romanov), ne s'en coule pas moins malgré ses nombreux chœurs assez originaux dans les moules franco-italiens, assortis d'un discret emprunt aux échelles modales slaves. Ces audaces, plus évidentes dans Rousslan et Lioudmila, d'après Pouchkine (1842), firent condamner l'œuvre par l'aristocratie pétersbourgeoise, qui la jugea trop slave ; pourtant, Glinka qui s'était contenté d'adapter a posteriori des paroles à sa musique n'avait pas même songé aux problèmes de la phonétique. Dargomyjski (1813-1869) les résoudra magistralement avec sa Rousalka (1855) et surtout son Convive de pierre (inachevé), mis en musique sur le texte même de Pouchkine, sans l'intermédiaire d'un livret (→ LITTERATÜR-OPER). Mais si elles épousent toutes les inflexions du langage, ces deux œuvres se dégagent encore mal des structures fermées traditionnelles ; c'est pourtant avec un réalisme sans précédent (le réalisme étant, depuis deux siècles, l'apanage du genre comique) qu'il traduit dans sa Rousalka la folie d'un meunier, par une déclamation haletante et non plus au moyen des coloratures italiennes.
Cette même « quête de vérité », Moussorgski (1839-1881) lui donna d'emblée toute sa force dans son acte unique le Mariage (1868), d'après le texte de Gogol, réalisant ainsi l'union absolue du vers et de la musique tant chantée qu'instrumentale dans un langage absolument « inou, où la conversation musicale n'est brisée par aucune césure et ne contient aucune aria. Le génie de l'auteur, l'un des plus étonnants précurseurs qui fût jamais, n'explique pas tout : la Russie, nation neuve, n'avait eu à surmonter ni héritage classique, ni romantisme, ce courant s'avérant lettre morte pour la nature réaliste de Moussorgski, qui fonde sa sémantique sur la rythmique de la langue, sur les modes et les accords de la vieille liturgie, procédés « barbares » qui deviendront la base des langages de Ravel, Bartók et Stravinski. Moussorgski magnifia aussitôt ses découvertes dans Boris Godounov (1869 et 1872), opéra fait de courts tableaux en structures ouvertes, riche en chœurs d'une puissante originalité, où les rares citations du folklore s'incorporent sans hiatus à la langue générale, langue sans équivalent dans toute l'Europe, et où la peinture des caractères et l'emploi du leitmotiv sont poussés beaucoup plus loin que chez Verdi et Wagner qu'il se targuait d'ignorer. Et c'est pour marquer davantage son désengagement vis-à-vis de la tradition qu'il baptise ensuite sa Khovanchtchina « drame musical populaire ».
Son message demeura pourtant lettre morte (sauf pour Debussy qui en eut connaissance), ses œuvres ayant été divulguées longtemps plus tard dans les arrangements très occidentalisés de Rimski-Korsakov (1844-1908). Ce dernier, compagnon d'armes des premières années de Moussorgski, avait d'abord conçu une puissante Pskovitaine (1873) dans un esprit assez proche de Boris, avant de retourner aux schémas traditionnels dans un merveilleux assez naïf, réussissant enfin une meilleure synthèse du langage et de la forme dans Mlada (1892), Sadko (1898), et plus encore dans Katschei l'immortel (1899) et le Coq d'or (1907), deux œuvres qui annoncent respectivement Debussy et Stravinski et qui représentent certainement ce que l'opéra européen pouvait offrir de plus avancé sur le plan de l'écriture musicale. S'il faut aussi saluer dans le Prince Igor de Borodine une intéressante opposition entre folklores russe et oriental, mais dans un cadre dépassé, on peut oublier les opéras de César Cui, moins russe que français (cf. Angelo, d'après Hugo, 1876), cependant que l'influence allemande laissait des traces dans Doubrowsky (1895) de Napravnik (1839-1916), et même chez Anton Rubinstein (1829-1894), dont le Démon (1875) et le Marchand Kalashnikov (1880) contiennent néanmoins quelques beaux exemples de réalisme. Et, malgré sa prédilection pour Wagner, dont il traduisit et divulgua l'œuvre, A. Serov (1820-1871) s'était parfois rapproché de l'idéal réaliste, dans Judith et Holopherne (1863) et Rogneda (1865), œuvres demeurées en deçà de leurs ambitions. Tchaïkovski (1840-1893), enfin, sans chercher à briser les moules traditionnels, s'inspira de Gounod et de Schumann, mais n'en donna pas moins de très émouvants portraits de la bourgeoisie russe dans le slavisme authentique d'Eugene Oneguine, d'après Pouchkine (1879), où l'introspection psychologique débouche sur un lyrisme pathétique que l'on retrouve dans la Dame de pique (1890) et jusque dans l'épopée (Mazeppa, 1884).
Le tournant du siècle
L'abolition du servage en Russie (1861), la fin des luttes intestines en Italie et en Allemagne, le désastre de Sedan et les conséquences de l'industrialisation avaient bouleversé l'échiquier social européen. De nouvelles classes aspiraient à un théâtre qui ne fût plus celui de l'aristocratie, avec ses opéras-fleuves, son cortège de dieux, héros casqués et empereurs moyenâgeux. Récusant le romantisme, la littérature éclatait vers les deux pôles opposés du symbolisme élitaire, d'une part, du naturalisme et du vérisme, de l'autre. Ces derniers thèmes, plus aisément accessibles à la scène lyrique que les courants symbolistes, devaient trouver un écho immédiat auprès d'un public largement populaire, mais il est intéressant de noter que, au même instant, la peinture impressionniste devait jouer un rôle d'intermédiaire en nappant d'irréel les thèmes les plus « quotidiens ». Daudet, Zola, Verga, Rodin, Monet, Cézanne ont quarante ans en 1880, comme Moussorgski et Chabrier.
L'Italie. La suprématie de Verdi avait voué à l'échec tout effort de renouvellement. Comme Petrella et Marchetti (v. supra), Carlo Pedrotti (1817-1893) et Giovanni Bottesini (1821-1889) tentèrent sans illusion l'aventure, et c'est en vain que Bologne, foyer progressiste et « wagnérien », fit aux Goti (1873) de Stefano Gobatti (1852-1913) un triomphe qui resta sans lendemain. C'est avec un talent plus docile que se faufilèrent dans l'ombre du géant le Brésilien A. C. Gomèz (1836-1896), qui fut acclamé à Milan dès 1870, et surtout Amilcare Ponchielli (1834-1886), qui, avec un sens dramatique certain, sut dénouer les ficelles hugoliennes de Gioconda (1876) et de Marion Delorme (1885). Mais le mérite en revenait peut-être à Arrigo Boito (1842-1918), un scapigliato, librettiste et compositeur d'un Mefistofele inégal, mais fascinant (1868 et 1875), mais plus encore agitateur culturel, émule de Victor Hugo, tour à tour disciple et ennemi de Wagner, contempteur, puis collaborateur de Verdi, librettiste aussi de Ponchielli, de Faccio, et de Catalani. Alfredo Catalani (1854-1893), un trop éphémère génie écartelé entre le romantisme germanique et le renouveau naturaliste, qu'il rassembla dans le climat de violence vocale et orchestrale de la Wally (1892), s'étant montré par ailleurs capable des plus tendres inflexions belcantistes dans Loreley (1890). À sa suite, le wagnérien Antonio Smareglia (1854-1929) put, en pleine carrière, s'inspirer des courants nouveaux pour y inscrire ses intuitives Nozze istriane (1895) : le vérisme musical avait, en effet, éclaté en 1890 avec le triomphe réservé à Rome à Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni (1863-1945), que suivit à Milan en 1892 celui de Paillasse de Leoncavallo (1857-1919).
C'est qu'au lendemain du succès élitaire de Verdi, qui, avec Otello, avait en 1887 pris congé de son ancien public, il fallait d'autres thèmes à une génération nouvelle, coupée de toute racine, amère et déçue par le virage à droite de la jeune Italie, si durement bâtie. Dépassant les objectifs de la scapigliatura milanaise, encore teintée d'un relent de romantisme (et dont devaient toutefois sortir tous les librettistes de la jeune école), Giovanni Verga, un romancier sicilien mâtiné de Daudet et de Zola, avait triomphé avec Cavalleria rusticana (un épisode de son recueil la Vie des champs, 1880) porté à la scène pour la Duse, qui, jouant sans maquillage, avait encore renforcé l'immédiateté de cette « tranche de vie » paysanne, témoin des aspirations de tout un public. Or, le transfert de ce sujet sur une scène lyrique apparaît comme un triple calcul si l'on comprend qu'il fallait à la nouvelle capitale un succès digne de ceux de la Scala de Milan, à l'éditeur Sanzogno des noms à opposer à celui de Verdi, exploité par son rival Ricordi, et une bannière au parti socialiste italien qui se structura précisément en 1890 et 1892. Ce qui explique mieux le peu d'intérêt porté à la branche napolitaine du vérisme, où l'on utilisa les beaux drames de Di Giacomo, et l'oubli réservé ensuite aux véristes mineurs tels que Fara-Musio, Cusinati, Tasca, Coronaro, Spinelli, Florida, Samara, Bucceri, Collini, Brunetti et Bimboni. Avec Mascagni et Leoncavallo, c'est donc Giordano (1867-1948) qui compléta la triade initiale du vérisme, grâce à sa Mala vita donnée aussi en 1892.
Ces trois musiciens avaient su oublier leur wagnérisme et leurs ambitions de jeunesse pour souscrire à une mode payante. Dès qu'ils eurent à nouveau affiné leur art, produisant des chefs-d'œuvre plus accomplis, ils ne retrouvèrent plus la même faveur populaire et « déçurent leur gauche, sans pour autant conquérir leur droite », sauf Giordano dont André Chénier, en 1896, connut le succès sans emprunter exactement son thème à l'esthétique du « coup de couteau » et du fait divers d'actualité, esthétique qu'il retrouvera avec un certain génie dans Fedora (1898). En réalité, les composantes initiales du vérisme la fameuse tranche de vie paysanne, sa violence orchestrale et sa vocalité sommaire refusant toute complaisance belcantiste disparurent peu à peu lorsque les sujets furent puisés soit dans un monde paysan sans violence (l'Ami Fritz de Mascagni, 1891), soit dans le xviiie siècle, la Renaissance, le Moyen Âge ou la mythologie, dans l'exotisme, le mythe rédempteur, le symbolisme (Iris, de Mascagni, 1898) et jusqu'au d'annunzianisme décadent ! En outre, il serait difficile de réduire à un même dénominateur l'art délicat, voire naïf de Francesco Cilea (1866-1950) et la violence savante d'un Franchetti. Et pourtant, ce courant cahotique produisit ses chefs-d'œuvre dans un même souci de sincérité et d'exaltation du « mot », porteur de vérité. Et c'est cette erreur fondamentale (la priorité trop absolue accordée au texte) qui conduisit les véristes à ces maladresses d'écriture vocale, qui autorisèrent les chanteurs des générations suivantes à déformer singulièrement leur message (→ CHANT).
Il appartint à Puccini (1858-1924) de coiffer vite l'éphémère expérience vériste : musicien d'église, puis attiré par le renouveau symphonique, romantique dès ses premières œuvres, il n'emprunta au vérisme que quelques formules, quelques personnages, imposant partout un génie dramatique et musical plus universel, se préoccupant de maintenir un chant pur dans le savoureux mélange d'un lyrisme classique (cf. la Bohème, 1896) et d'une écriture harmonique et orchestrale très largement en pointe sur son époque (par ex., Tosca en 1900, La Fanciulla del West, créée à New York en 1910), tout en demeurant attaché à l'esthétique de l'opéra sentimental de la bourgeoisie de culture française. Par l'impressionnisme du Tabarro, l'humour de Gianni Schichi et les audaces de son ultime Turandot, inachevé, Puccini avait déjà largement dépassé ses « successeurs » les plus doués, Alfano et Zandonai, qui ne cachèrent plus le wagnérisme inavoué de leurs pairs, l'assortissant de l'influence ravélienne, et Montemezzi (1875-1952), qui dans l'Amour des trois rois (1913) démarqua Tristan sans détours. Mais à cette époque, le mouvement néoclassique était déjà apparu, et, dès le début du siècle, un Wolf Ferrari l'avait compris en retournant avec esprit à Goldoni.
En France
Les courants les plus divergents s'y affrontent, et Massenet (1842-1912) s'y impose, parlant un langage accessible aux publics bourgeois et populaire, qui applaudissent une même veine lyrique et sentimentale mise au service du grand opéra, du drame historique, du fantastique, de l'opéra-comique, du vérisme ou du mystère médiéval. Alors qu'il aurait pu asseoir son succès sur les chefs-d'œuvre bien français que sont Manon (1884) et Werther (1887, créé à Vienne en 1892), où l'admiration pour Wagner se fait aussi sentir, il sut perpétuellement se renouveler, et recourut même, dans son ultime Don Quichotte (1910), à la déclamation debussyste. Pourtant, ces genres mixtes, tenant de l'opéra et de l'opéra-comique et joués indifféremment dans l'une ou l'autre salle, n'en appartenaient pas moins au passé. Moins, d'ailleurs, que le « grand opéra », sorte de vaste épopée, où, comme pour venger Sedan, on fit enfin appel à l'épopée nationale, d'ailleurs teintée de la notion wagnérienne de rédemption. Au-delà de l'impossible Jeanne d'Arc de Mermet (1876) et des efforts plus méritoires de Paladilhe et surtout de Reyer, et alors que Carmen et Boris étaient déjà parus, ce « drame lyrique » d'essence symphonique, sans caractérisation vocale ni dramatique, conjugua étrangement la densité de l'opéra allemand et le chant vériste. Voulant trop tard introduire en France le romantisme absent jusque-là des scènes lyriques, il se condamna à l'échec, même s'il se donna des allures d'avant-garde auprès d'un public encore inaverti de Beethoven.
Certes, les meilleurs musiciens d'alors évitèrent ces pièges : Saint-Saëns (1835-1921), qui, dans Samson et Dalila (1877), le mieux venu d'une douzaine d'opéras, sut tempérer son admiration pour Tannhäuser par sa redécouverte de Rameau, le symphoniste Édouard Lalo (1823-1892), dont le Roi d'Ys fut accueilli par l'Opéra-Comique (1888), Chabrier (1841-1894), dont Gwendoline (1886) semble une oasis d'originalité dans une formule trop souvent mal défendue, et essentiellement annexée par les élèves de César Franck, lui-même auteur peu habile de deux drames meyerbeeriens, Hulda et Ghisèle (écrits de 1882 à 1890). Mais aucun de ces auteurs ne possédant le sens dramatique d'un Reyer, on devrait plutôt qualifier d'opéras de concert ces drames sans action, reflets isolés du génie de chaque compositeur : Chausson (1855-1899), qui, dans le Roi Arthus (1899), avoue son admiration pour Tristan et Isolde ; d'Indy, qui démarque Parsifal dans Fervaal (créé en 1897), puis écrit l'Étranger (1903) ; Rabaud (1873-1949) [la Fille de Roland, 1904], Ropartz (1864-1955) [le Pays, 1912], etc. On doit réserver une place à part à Albéric Magnard (1865-1914), qui, ayant déjà sublimé le genre avec Guercœur (1900, créé en 1931), s'inspira avec dignité de Racine (Bérénice, 1909), et à Max d'Ollone (1875-1959), qui déclara « vouloir enlever au drame lyrique ses abstractions et lui rendre ses airs et duos », et y réussit notamment dans le Retour (1909), une heureuse synthèse du drame, du symbolisme et du naturalisme, éléments contradictoires qui se retrouvent mêlés autour de livrets parfois grandiloquents dans le Miracle de Georges Hue (1910), dans les œuvres de Bachelet, Mariotte, Le Flem, Busser, etc., jusqu'au Vercingétorix de Canteloube (1933).
C'est dans un esprit totalement différent, au-delà d'une sage tradition qui avait encore valu l'opéra fantastique d'Offenbach les Contes d'Hoffmann (1881, posth.) et la fine mais désuète Lakmé de Léo Delibes (1883), qu'avait commencé le véritable renouveau. Les premiers opéras de Georges Bizet (1838-1875) ne pouvaient laisser pressentir l'originalité de Carmen (1875), qui, rejeté par la critique officielle, fut apprécié des musiciens, du public, et triomphalement accueilli hors de France. Il fut souvent méjugé par la suite, en raison même de sa large popularité, de ses dialogues parlés qui le confinaient à un genre « moins noble », et de ce meurtre sur scène, véritable révolution dans le monde de l'opéra-comique, geste qui le fit passer pour l'ancêtre du vérisme, alors que ce drame véritable retrouvait précisément l'antique fusion de tous les éléments. Moderne par son écriture, son orchestre impressionniste, sa finalité tragique et la très remarquable introspection de ses caractères, non moins lyrique pour cela, Carmen, « seule antidote au philtre wagnérien » (cf. Nietzsche), influença Chabrier et Debussy. Chabrier (1841-1894), un véritable Moussorgski français, cachant ses audaces sous la sensibilité, l'humour et la finesse de son orchestre, donna ses lettres de noblesse au genre bouffe avec l'Étoile (1877), Une éducation manquée (1879) et avec le Roi malgré lui (1887), que Ravel tenait pour le chef-d'œuvre du xixe siècle, cependant que Debussy se déclarait inapte à terminer le très impressionniste Briséis.
Or, Moussorgski et Chabrier se retrouvent au berceau de Pelléas et Mélisande de Debussy (1902), un « drame lyrique », dont on ne sait encore s'il lui appartint de renouveler la forme de l'opéra ou s'il projeta seulement sur scène le rêve intérieur de son auteur, qui avait trouvé dans la pièce de Maeterlinck (dont il utilise le texte original) cet irréel et ces personnages « sans lieu ni époque », transparents comme l'harmonie de son orchestre, par ailleurs très présent. Mais Debussy n'en rejoint pas moins encore Wagner, en confiant à cet orchestre un jeu de leitmotive plus explicite que le langage des acteurs du drame, auxquels il prête un récit dont la déclamation rythmique se veut calquée sur la parole « naturelle », entendant par là renouer avec Rameau, qu'il opposait à Gluck, justement responsable à ses yeux de la convention du drame meyerbeerien.
Le naturalisme
Les créateurs de Pelléas, et jusqu'à son décorateur Jusseaume, se mirent au service des auteurs naturalistes, dont les ambitions recoupaient souvent celles de Debussy, et qui, pourtant, surent rarement donner à leurs personnages ce langage aussi « naturel ». Or, ce courant naturaliste n'eut pas en France un Puccini qui sût en dépasser les données initiales. Comme en Italie, il fit d'abord souche chez un musicien de forte implantation romantique, Alfred Bruneau (1857-1934), dont Kerim (1887) ne pouvait laisser prévoir sa rencontre avec Zola, dont il met en musique le Rêve (1891) et l'Attaque du moulin, en 1893, une des nouvelles des Soirées de Médan (et donc la contemporaine de Cavalleria rusticana de Verga). Il commit néanmoins l'erreur de passer par le truchement d'un livret aux alexandrins prétentieux, avant de collaborer directement avec Zola pour Messidor, l'Ouragan, etc., ouvrages dont les attaches naturalistes se résument à une écriture vocale maladroite, mais qui comportent encore des scènes allégoriques ou symbolistes comme Iris de Mascagni. Massenet (1842-1912), malgré des livrets trop élégants, avait peut-être mieux compris l'essence de ce naturalisme dans la Navarraise (1894) et dans Sapho (1897), mais Gustave Charpentier (1860-1956), refusant précisément ce type de livret, réalisa, avec un autre talent, une fusion totale des composantes du réalisme dans son roman musical Louise (1900, l'année de Tosca), modèle absolu d'une école qui témoigna dès lors d'une écriture plus recherchée que celle des véristes italiens, mais à laquelle fit défaut cette présence instinctive des tenants de « l'esthétique du coup de couteau ».
Un grand nombre d'œuvres témoignent du talent d'auteurs qui surent allier la tragédie à une sentimentalité populiste : le Juif polonais (1900), de Camille Erlanger (1863-1919), le Chemineau (1907), de Xavier Leroux (1863-1919), dont l'écriture évoque aussi Fauré et fait appel au folklore, comme celle de Bruneau, cependant que les alexandrins sentencieux et faussement argotiques de Jean Richepin conviennent mal à l'humanité des personnages. Citons encore la très remarquable Habanera (1908) et la Jota (1911) de Raoul Laparra (1876-1943) ; Monna Vanna, d'après Maeterlinck (1909), et Gismonda (1919) d'Henry Février (1875-1957) ; la Lépreuse (écrit en 1902) de Silvio Lazzari (1857-1944), un élève de Franck ; enfin, le Cœur du moulin (1909), œuvre plus tendre du Languedocien Déodat de Séverac (1873-1921), semble réconcilier d'Indy et Debussy, loin du chromatisme wagnérien qui influença toute l'école naturaliste.
C'est en dehors de toute école qu'il faut laisser Ariane et Barbe-Bleue (1907) de Paul Dukas (1865-1935), une des plus belles pages de la musique française de tous les temps, mais l'œuvre d'un musicien hostile aux exigences du théâtre lyrique auquel elle n'apporte pas plus de solution que Pelléas, dont elle découle, et que Pénélope (1913), chef-d'œuvre solitaire où Fauré (1845-1924) adopte la formule du grand opéra dans un langage délicat qui en est l'antithèse, rompant totalement avec Wagner. Cette même langue, André Messager (1853-1929) la manie avec un métier consommé dans un opéra-comique de qualité (la Basoche en 1890, Fortunio en 1907), voire légèrement grivois (Véronique, 1898), avant de s'adonner à la comédie musicale (l'Amour masqué, de Sacha Guitry, 1923). Enfin, tenant aussi de l'opéra-comique et de l'opérette, la très fine Ciboulette de Reynaldo Hahn en 1923 et Moineau de Louis Beydts (1895-1953), en 1931, appartenaient encore, par leur esthétique, au xixe siècle aristocratique.
L'Allemagne et l'Autriche
Plus qu'ailleurs, il convenait d'assumer ou de refuser l'héritage wagnérien. Le problème ne se posa pas encore à Max Bruch (1838-1920), auteur de 3 opéras romantiques, dont Loreley (1863), ni au Hongrois Carl Goldmark (1830-1915), auteur d'une Reine de Saba (1875) très réussie, qui renoua avec le singspiel dans le Grillon du foyer (1896). Fr. von Suppé et Johann Strauss reçurent l'héritage de Lortzing, puis créèrent, après 1870, la grande opérette, cependant que Kienzl (1857-1941) optait pour la comédie lyrique avec l'Évangéliste (1895). Engelbert Humperdinck (1854-1921), comme eux, donna de très vastes proportions au singspiel Hansel und Gretel (1893), où se joint le fantastique, puis esquisse le sprechgesang dans la version de 1910 de ses Enfants de roi. Ce mélange de féerie et de comédie se retrouve chez Cyrill Kistler, Julius Bittner, Albert Ritter, Ludwig Thuile, Hans Sommer, Anton Urspruch, et, enfin, chez E. N. Reznicek (1860-1945), dont l'agréable Dona Diana (1894) est restée au répertoire plus facilement que le Corregidor (1896), comédie de mœurs convenant assez mal au romantisme tourmenté de Hugo Wolf.
Presque tous ces musiciens avaient également sacrifié au « système » wagnérien, dont chacun crut déceler un aspect essentiel. Son thème mythologique ou rédempteur, sa densité orchestrale, sa démesure vocale, son abus du leitmotiv, du chromatisme, etc. Rien ne pouvait naître de ces imitations maladroites : Siegfried Wagner (1869-1930) semble s'inspirer de Mendelssohn plus que de son père dans Bärenhäuter (1899), Der Kobold (1904), etc., et de trop grandes ambitions sont évidentes dans Gudrune (1884) et Herrat (1892) de Felix Draeseke (1835-1913), dans une tétralogie sur l'Odyssée d'Ulysse (1896-1903) d'August Bungert (1845-1915), dans une Genèse (1892) et la trilogie Oreste (1902) du chef d'orchestre Felix von Weingartner (1863-1942), etc. On décèle, en revanche, un sens dramatique plus sûr chez Eugène d'Albert (1864-1932), ce brillant pianiste, élève de Liszt, et auteur d'une vingtaine d'opéras, dont 3 survécurent, et notamment Tiefland (1903), drame vériste de la rédemption tiré d'une pièce catalane (Terra baixos), qui s'est imposé au répertoire international. Se voulant étranger à toute influence, Hans Pfitzner (1869-1949) ignora superbement Wagner et aborda tous les genres, du singspiel au drame (Das Herz, 1931), s'imposant dans son excellent Palestrina (1917), symbole de sa résistance aux courants nouveaux, mais œuvre séduisante par son romantisme contenu, ses austères monologues d'une durée inusitée et le contrapuntisme audacieux des scènes d'ensemble.
Au carrefour de ces tendances, rappelons encore Max von Schillings (1868-1933), auteur de Mona Lisa (1915) et du curieux mimodrame Das Exenlied ; Franz Schmidt (1874-1939), qui se rattache au romantisme tardif dans sa Notre-Dame, d'après Hugo (1914) ; et surtout Erich Korngold (1897-1957) pour le Voile d'Heliane (1927) et l'étonnante Ville morte (1920), où il sut mêler symbolisme et fantastique dans l'heureuse influence de Puccini et de Richard Strauss. En fait, Richard Strauss (1864-1949) fut le seul des véritables successeurs de Wagner (avec Mahler, Reger et Wolf), qui révélât une vocation théâtrale, encore que tardive. Après deux tentatives hésitantes, il poussa, jusqu'à la limite du possible, dans Salomé (1905) et Elektra (1909) un chromatisme sensuel et exacerbé, ramassant l'action en un acte unique, où la démesure vocale et orchestrale, la tension du langage avaient atteint, à ses yeux, leur point extrême. C'est pourquoi le regard qu'il porte ensuite vers le passé, avec le poète « décadent » Hofmannsthal (1874-1929), débouche dès lors sur un prodigieux néobaroquisme, embrassant tous les horizons, depuis la colossale comédie viennoise du Chevalier à la rose (1910) au fantastique de la Femme sans ombre (1919), jusqu'à la réflexion esthétique de Capriccio (1942) où Clemens Krauss reprend, dans son livret, les thèmes du Prima la musica, poi le parole de Casti. Malgré les intéressantes innovations de ces chefs-d'œuvre tardifs, Strauss avait, au-delà de 1910, laissé le flambeau de la recherche aux représentants de l'expressionnisme.
Le renouveau tchèque
Influencé par Wagner, Zdenek Fibich (1850-1900) avait déjà abordé ces problèmes du langage, que devait résoudre, dès sa Jenufa (1901), Leos Janáček (1854-1928), contemporain de Fauré et de Puccini. À l'instar de Moussorgski, la phonétique pure l'intéresse moins que la sémantique d'une langue qui lui fournit un vocabulaire harmonique et rythmique fait de brèves cellules non répétitives. Dans Jenufa, c'est encore la musique qui, par sa richesse, sublime un thème vériste à fin rédemptrice. Affrontant ensuite tous les thèmes, du satirique au fantastique (l'Affaire Makropoulos, 1926) et au tragique (Katia Kabanova en 1921, De la maison des morts, en 1928), Janáček, par son écriture moderne et son lyrisme indéfectible, sut jeter un pont entre deux générations, et influença à son tour son cadet Vitezslav Novak (1870-1949).
En Espagne
L'opéra demeura assez marginal dans la production de la jeune école nationale. Manuel de Falla (1876-1946) s'essaie à la zarzuela populaire, qu'il élargit ensuite au tragique dans la Vie brève (1905), une réplique andalouse de Cavalleria rusticana mâtinée d'impressionnisme. L'œuvre fut créée en France, où le musicien espagnol subit l'influence de Stravinski dans les Tréteaux de maître Pierre (1923), une âpre tentative de néoclassicisme, avant le renoncement sublime de son grand drame épique inachevé, Atlantida. Albéniz (1860-1909) glissa insensiblement de la zarzuela grande Pepita Giménez (1896) au véritable opéra-comique (Merlín, 1906), cependant que Granados (1867-1916) évolua sagement de sa Maria del Carmen (1898) jusqu'à ses Goyescas, créées à New York en 1916, où les éléments de la tonadilla se mêlent à sa sève romantique franco-germanique. Enfin, Joaquín Turina (1882-1949), élève de D'Indy, écrivit Margot (1914) et Jardín de Oriente (1923), également tributaires de la tradition du xixe siècle.
Les perspectives du xxe siècle
Il est encore difficile de dresser le bilan de ce siècle, né seulement avec la Première Guerre mondiale. Le divorce s'avère irrémédiable entre le public d'opéra et l'artiste créateur, dont il est malaisé de mesurer l'impact, faute d'une audience suffisante. Les auteurs y sont rares à savoir conserver, tels Poulenc ou Britten, un langage lyrique perceptible sans pour autant renier leur époque, plus rares encore à se consacrer exclusivement à l'art lyrique, comme Menotti. Chaque compositeur écrit pour le théâtre dans la langue qui lui est propre, sans infléchir les lois du genre, et les chefs-d'œuvre les plus significatifs, de Wozzeck aux Diables de Loudun, doivent surtout à leur valeur musicale. Ce n'est pas un des moindres paradoxes de ce siècle de constater qu'un théâtre qui aspire à la réflexion plus qu'au plaisir fasse appel à de grands auteurs passés ou présents (Bélazs, D'Annunzio, Cocteau, Claudel, Gertrud Stein, mais aussi Poe, Pouchkine, Gogol, Shakespeare et Euripide) pour en rendre finalement le texte imperceptible soit par maladresse d'écriture, soit par indifférence envers l'interprétation, trop fréquemment confiée en France notamment à de médiocres chanteurs, ou à des réalisateurs (chefs d'orchestre, metteurs en scène) peu familiarisés avec le théâtre lyrique.
On peut, néanmoins, tenter de dégager quelques tendances communes à ce demi-siècle : un souci de qualité du texte, par le biais du litteratür-oper (souvent peu fonctionnel) et de la tendance des compositeurs à rédiger eux-mêmes leurs textes ; une attention privilégiée accordée à l'orchestre plus qu'à la voix, à moins qu'un travail en profondeur ne soit entrepris en ce domaine (témoins les songs de Weill, ou la décantation du mot, opération néobaroque fréquente après 1950) ; un « retour » au sacral, un retour aux structures fermées opérations liées au néoclassicisme autant qu'au rejet des opéras-fleuves du romantisme ; un retour enfin aux valeurs musicales pures et objectives, par réaction contre le subjectivisme romantique. Et on ne peut omettre ici les conséquences d'un affairisme hostile à la création, managers, interprètes et publics se satisfaisant plus aisément d'un répertoire parfois bicentenaire que d'un langage neuf, fût-il aussi aisément accessible que ceux de Janáček, Berg, Weill, Milhaud, Dallapiccola ou Prokofiev.
En France
Ce théâtre très accessible sera longtemps entretenu par Rabaud (Marouf, 1914, jusqu'à Martine, posthume), Louis Aubert, A. Wolff, Fl. Schmitt, Roussel (Padmâvati allie le drame lyrique et la chorégraphie), Hahn (le Marchand de Venise, 1935), Ibert et Honegger (l'Aiglon, 1937), Sauguet (la Chartreuse de Parme, 1939), Jean Rivier, Henri Tomasi (l'Atlantide, 1953 ; Miguel de Manara, 1952 ; Sampiero Corso, 1956), Bondeville, Barraud, etc., et Poulenc qui réussit en 1956, créé en 1957 à la Scala de Milan, un chef-d'œuvre de lisibilité en reprenant le texte de Bernanos pour ses Dialogues des carmélites. D'autre part, l'héritage de Chabrier se retrouve dans l'« opérette des musiciens » (comme l'a surnommée José Bruyr) de Ravel, Roussel, Rosenthal, Ibert, Thiriet, Roland-Manuel, Delvincourt, Claude Arrieu, plus tard Damase et Semenoff, rares joyaux parmi lesquels brillent les Mamelles de Tirésias d'Apollinaire auxquelles Poulenc, en 1945 (création en 1947), sut donner un humour particulier. C'est d'une esthétique plus exigeante que se réclamèrent, d'autre part, dès 1910, Milhaud, puis Honegger, qui, par leur phonétique et leur appareil instrumental, refusèrent la tradition, collaborant, entre autres, avec Claudel et Cocteau.
Auteur essentiellement lyrique, Milhaud (1892-1974) fit d'abord appel à Francis Jammes, demanda à Claudel une nouvelle mise en forme de l'Orestie (1913-1922), défendit un naturalisme redimensionné au mythe (les Malheurs d'Orphée en 1924, créé en 1926 ; le Pauvre Matelot, 1926), aborda l'épopée avec Christophe Colomb (1928), Maximilien (1930), le bouleversant et multiforme Bolivar (1943, créé en 1950), et plus tard David, pour rejoindre, au terme d'un périple d'un demi-siècle, Beaumarchais dans la Mère coupable (1966). Attiré par le sacral, Honegger tendit également à l'incantation lyrique dès sa difficile Antigone, d'après Cocteau (1927), de même que dans ses oratorios scéniques Judith, puis Jeanne d'Arc au bûcher, avec Claudel (1935, créé en 1938), tandis que son disciple Marcel Landowski (né en 1915) atteint au mythe moderne et utilise toutes les techniques nouvelles dans le Fou (1940-1956), et qu'à l'inverse Gilbert Bécaud tente avec l'Opéra d'Aran (1963) une expérience de naturalisme, à la façon de Britten et Menotti, sans toutefois maîtriser suffisamment son écriture orchestrale.
L'électroacoustique : la musique de l'avenir
À propos de l'opéra les Trois Sœurs (1998), d'après Tchekhov, Peter Eötvös déclare : « Je suis persuadé que le futur de la musique est l'électroacoustique […], depuis soixante ans, le progrès est électronique. La direction de la musique dans l'espace n'est plus tributaire de l'aller-retour de l'archet, de l'inspiration-expiration des vents, de la frappe des percussions. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, avec l'électronique, nous disposons d'une énergie permanente et continue. Je ferai un parallèle avec l'éclairage du théâtre. Après la bougie, nous eûmes de gros projecteurs assez grossiers. Aujourd'hui, nous atteignons des miracles de beauté avec des centaines de petits faisceaux. Rien n'empêche d'équiper les salles de concerts, les Opéras, avec des centaines de petits haut-parleurs d'intensités, de couleurs, de tonalités variables, dont on jouerait comme d'un orchestre. »
(« Tchekhov à l'Opéra », in Télérama, 4 mars 1998.)
Allemagne et Autriche
C'est en marge de l'expressionnisme viennois et berlinois, dont l'écrivain Franz Wedekind (1864-1918), héritier de Büchner, fut le catalyseur, qu'il faut situer l'expérience isolée de Ferruccio Busoni (1866-1924), sarcastique et philosophique dans Arlecchino (Zurich, 1917) et Doktor Faust (posthume, Dresde 1925). Cependant, le romantisme exacerbé de Franz Schrecker (1878-1934) son Ferne Klang (1912) influença le Wozzeck de Berg et celui d'A. von Zemlinsky (1872-1942) avaient déjà conduit Arnold Schönberg (1874-1951) sur la voie de l'expressionnisme et de l'atonalisme dès son bref monodrame Erwartung (1909, créé en 1924 à Prague), dont le sujet vériste est traduit dans un éparpillement sonore, et un climat de violence inconcevable même chez un Strauss. Ses travaux sur les diverses expressions de la voix, chantée ou parlée, se retrouveront dans Moïse et Aaron (1931, inachevé, représenté sur scène à Zurich en 1957), sans proposer pourtant de solution d'avenir. Plus foncièrement lyrique, Alban Berg réunit dans Wozzeck (1921, créé à Berlin en 1925), écrit sur le texte prophétique du poète maudit Büchner (1813-1837), toutes les composantes du chant, celles du théâtre lyrique et des structures instrumentales du passé et du présent. Sublimant, lui aussi, un sordide fait divers en un puissant mythe d'une immédiate séduction lyrique, il signa là une partition considérée comme le chef-d'œuvre le plus caractéristique du demi-siècle. L'œuvre fut jouée avec succès à Berlin, où Hindemith avait fait un instant scandale (Assassin, espoir des femmes en 1921 ; Das Nusch-Nuschi, 1921), avant de se tourner vers le néoclassicisme austère de Cardillac (1926) et de Mathis le peintre (1938).
Dans cette ville, toujours, la police doit intervenir lorsque la critique politique éclate, sans équivoque cette fois, dans l'œuvre de Kurt Weill (1900-1950), qui, pour mieux servir les textes explosifs de Brecht, renie le sérialisme élitaire de ses débuts, et bâtit son Opéra de quat'sous (1928) à l'aide de songs écrits dans le style du cinéma expressionniste berlinois, insérés dans une partition de haute valeur musicale. Il porte ces procédés à la dimension du grand opéra dans son féroce Mahagonny (1929), un authentique chef-d'œuvre, mais retourne à son style austère dans la Caution (1932). Brecht inspira encore Hanns Eisler (1898-1962) et Paul Dessau (1894-1980), qui donna en 1951 le Procès de Lucullus. À tous ces auteurs, écartés par le nazisme, Carl Orff (1895-1982) avait opposé un comique rassurant, avec Der Mond (1939) et Die Kluge (1943) ; il évoqua avec sensibilité le Moyen Âge dans ses Trionfi (1937-1943) qui contiennent les fameux Carmina Burana où il a recours à l'incantation et à la percussion, qui deviennent la base du langage de Antigone et Œdipe roi (1949-1959), un essai de reconstitution de la technique du drame grec.
On peut situer au carrefour de ces diverses tendances les œuvres d'Ernst Krenek (né en 1900), un élève de Schrecker, au langage plus dur, marqué par l'expressionnisme dans Orpheus und Eurydike (1926), par le jazz dans son original Jonny spielt auf (1927), et qui rechercha la réunion des langages de Berg et de Hindemith en même temps que des procédés inhabituels de présentation scénique dans son colossal Charles Quint (1933), où un postromantisme latent le dispute à un strict sérialisme ; à cette dernière technique souscriront aussi Boris Blacher (1903-1975), Karl A. Hartmann (1905-1963), et, plus tard, H. W. Henze (né en 1926), qui embourgeoisera le système sériel, avant que Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) ne réalise une synthèse plus audacieuse de toutes ces tendances dans les Soldats (1960), un opéra qui marque aussi l'un des retours les plus significatifs de notre époque à la colorature féminine suraiguë. À citer aussi Staatstheater (1967-1971) de Mauricio Kagel. Enfin, quelques compositeurs avaient su mettre une science indéniable au service d'un langage plus largement ouvert au public : ainsi Werner Egk (né en 1901) dans Peer Gynt (1938) et le Revizor (1957), Wolfgang Fortner (né en 1907) dans Noces de sang (1957) et surtout Gottfried von Einem (né en 1918), dont la Mort de Danton (1947), d'après Büchner, et le Procès (1953), d'après Kafka, s'imposèrent sans peine.
En Italie
Dépasser l'expérience vériste sans combattre non plus Puccini sur son terrain fut la préoccupation des nouvelles générations, qui devancèrent les ultimes interrogations de Turandot (1926), de l'austère Néron de Boito (1924, posthume), et ne se virent opposer que cet autre dérisoire Néron (1935) de Mascagni, qui voulut son œuvre « résolument antimoderne ». Wolf Ferrari (1876-1948) avait, dès 1903, trouvé une ingénieuse solution en mettant son talent subtil au service des comédies de Goldoni, première manifestation du siècle à un retour vers un comique de qualité (Le Donne curiose, 1903 ; I Quattro rusteghi, 1906 ; Il Segreto di Susanna, 1909, etc., jusqu'au Campiello, 1936) ; Respighi (1879-1936) en proposa d'autres, faisant rutiler une palette orchestrale héritée de Rimski-Korsakov dans le climat vériste et fantastique de Belfagor (1923) et de La Fiamma (1934), souscrivant au dépouillement néoclassique dans Marie l'Égyptienne (1932). Mais c'est plus à une sorte de néogrégorien qu'allait aspirer la « génération de quatre-vingt » : Pizzetti (1880-1968) rechercha un nouveau recitar cantando dans ses puissants drames, de Phèdre (1915, d'après D'Annunzio) à Meurtre dans la cathédrale (1958) ; G. F. Malipiero (1882-1973) joua de langages divers à l'ombre du plain-chant, dans ses « opéras à panneaux », étrangement lyrique dans La Favola del figlio cambiato (1933), presque extroverti dans Giulio Cesare (1936).
Enfin, Alfredo Casella (1883-1947), marqué par ses contacts avec la France et avec Stravinski, rejeta tout romantisme dans La Donna serpente comme dans La Favola d'Orfeo (1932). Citons encore Arrigo Pedrollo (1878-1964), Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) et surtout G. F. Ghedini (1892-1965), qui signa son dernier chef-d'œuvre en 1956 (Lord Inferno), ayant su faire éclater la matière sonore sans jamais négliger les prérogatives du théâtre, alors qu'une plus jeune génération démarquait encore tranquillement Puccini : Menotti, émigré aux États-Unis, et Renzo Rossellini (1908-1982), qui appuyait un sens théâtral aigu sur les excellents sujets du Vortice (le Tourbillon, 1958), de Vu du pont (1961) et de l'Annonce faite à Marie (1970). Autrement exigeant, Gioffredo Petrassi (né en 1904) demeurait, lui aussi, profondément lyrique dans Il Cordovano (1949), tout en adoptant le sérialisme ; cette technique inspira encore à Dallapiccola (1904-1975) des chefs-d'œuvre tels que Vol de nuit (1940), le très intense Prisonnier (1950), Ulysse, etc. Cette même opposition se retrouve entre Nino Rota (1911-1979), qui mit son talent multiforme au service de savoureux pastiches appréciés de tous les publics, et le langage difficile mais aussi immédiat de Berio (né en 1925), de Luigi Nono (né en 1924), auteur notamment de Intollerenza (1961) et de Al gran sole carica d'amore (1975), de Vlad (né en 1919), de Bussotti (né en 1931), de Maderna (1920-1973) et de Luciano Chailly (né en 1920), auteur très lyrique du Manteau, de l'Idiot, Procédure pénale, etc.
En Russie
Située à l'avant-garde à la fin du xixe siècle, l'école russe marqua un temps de réflexion. Le folklore épique ou merveilleux fut encore exploité, mais d'autres thèmes apparurent avec Raphaël (1894) d'Arensky (1861-1906), avec la très belle Orestie (1895) du docte Serge Taneev (1856-1915), ou se modifièrent, comme dans Dobrynia Nikititch (1903) de l'aimable Gretchaninov (1864-1956). L'influence française se fit sentir chez Rebikov (Dans la tempête, 1894) et Nicolas Tcherepnine, tandis que les particularismes locaux se reflétaient chez Ippolitov Ivanov (1859-1935), auteur de Ruth (1887) et Atya (1900), chez Vassilenko, Korostchenko, Lissenko, Soloviev, et chez le Géorgien Paliashvily (Absalon et Eteri, 1919). Tchaïkovski influença davantage Kalinnikov (Tsar Boris, 1897) et Serge Rachmaninov (1873-1943), dont Aleko (1892) fut suivi de drames plus audacieux, le Chevalier avare (1899-1904) et Francesca da Rimini (1906). Mais c'est en marge de tous ces courants que se développe le génie multiforme et plus cosmopolite de Stravinski et de Prokofiev. Le premier se réfère partiellement à Rimski-Korsakov dans le Rossignol (Paris, 1914), allie Glinka à Dargomyjski dans sa farce Mavra (1922), son œuvre favorite, puis fait créer en anglais à Venise, en 1951, son Rake's Progress, savoureux pastiche de tous les langages du passé. Prokofiev (1891-1953), quittant la Russie révolutionnaire après avoir écrit le Joueur, donne en français à Chicago son satirique et cocasse Amour des trois oranges (1921) d'après Gozzi, et termine en 1927 le dramatique Ange de feu, donné bien plus tard en Italie et en France. Rentré en Union soviétique, il y glorifie l'homme du peuple dans Simeon Kotko (1939), retourne à l'humour des Fiançailles au couvent (1940), et révèle son talent épique dans Guerre et Paix (1941-1952), fidèle durant quarante ans à une même veine mélodique naturelle, doublée d'une très riche palette orchestrale qui fit de lui l'un des grands classiques du xxe siècle, auprès de Puccini, Janáček et Strauss.
Mais la Russie soviétique, privée dès sa naissance de ses plus authentiques musiciens, ne pouvait compter sur le docile mais trop anachronique R. Glière (1875-1956). Elle dut donc se forger une génération nouvelle, aussitôt dominée par le génie sans concession de Chostakovitch (1906-1975), auquel, en 1928, le Nez, de Gogol, inspire une partition satirique, d'une audace inouïe à l'échelon européen. Staline ayant plus tard condamné Lady Macbeth (1934), chef-d'œuvre d'une grande intensité lyrique, Chostakovitch dut remanier sa partition (Katerina Ismailova, 1959), se retourna vers l'opérette humoristique, puis renonça à achever son Joueur. En fait, les directives officielles ne donnèrent ni n'enlevèrent de talent à quiconque, et la meilleure œuvre inspirée par le nouveau régime demeura Pauline Goebel (1925) de Youri Shaporine (1889-1966), antérieure aux consignes draconiennes de démocratisation, et rebaptisée les Décembristes en 1938, comme on le fit pour maintes œuvres du passé, des Huguenots à Tosca !
Cependant que Pachtchenko, Triodine, Gladkowski et Prussak souscrivaient à cette esthétique du « naïf », aussitôt caduque, une tentative de dépayser les thèmes d'inspiration réussit mieux, avec les opéras de Shishov, Potoski, Krein, Vassilenko, et surtout avec le Vent du Nord (1930) de Lev Knipper (1898-1974), mais un académisme de rigueur édulcorait le très officiel Don paisible (1935) de Dzerjinski, le Potemkine (1937) de Shishko, la Mère (1939) de Jelobinski, et même Dans l'orage (1939) du solide Tikhon Khrennikov (né en 1913). Après que Colas Breugnon de Dimitri Kabalevski (1938) eut encore mieux affirmé ce folklore sentimental, le retour à la musique instrumentale devait, pendant la guerre, permettre aux meilleurs musiciens d'esquiver les normes imposées aux livrets, avant qu'une très relative libéralisation du langage ne permît à la nouvelle génération une timide émancipation.
L'Europe centrale
Hongrie
Béla Bartók, dans son Château de Barbe-Bleue (1911), écrit sur le texte même de Bélazs, recourt, comme Debussy dans son Pelléas (dont il fut la réplique nationale), à de brefs commentaires symphoniques reliant les scènes isolées de cet acte unique, mais exalte une phonétique plus riche, témoignant d'une intensité lyrique plus efficace. On peut ne voir qu'un aimable singspiel national dans Harry Janos (1926) de Zoltán Kodály (1882-1967), son succès éclipsant tous ses autres opéras. Quant à Ernö Dohnanyi (1877-1960), son Voile de Pierrette (1910) n'était guère qu'une pantomime de style berlinois. C'est seulement après 1960 que naîtra une école moderne véritable, sur laquelle pèse la double influence de Bartók et de Laszlo Lajtha (1892-1963), moins pour l'unique opéra bouffe de ce dernier (le Chapeau bleu, 1948) que pour ses liens étroits avec la France. À cette école se rattachent notamment Emil Petrovics, Sandor Szokolaï et Sandor Balassa.
Tchécoslovaquie et Roumanie
De peu le cadet de Novák, Otakar Ostrčil (1879-1935) était resté fidèle à une esthétique romantique (la Mort de Vlasta, 1904) ; après les Balatka, Chubna, Polascek, Suda et Zelinka, Alois Habá (1893-1973) apporta sa personnalité de chercheur infatigable, utilisant le quart de ton dans la Mère (1931), œuvre dont l'intensité tragique approche celle de Wozzeck, et le sixième de ton dans Que ton règne arrive (1940-1942). À la même époque, l'école de Paris regroupa, au côté du Hongrois Tibor Harsanyi et du Polonais Al. Tansmann, le Tchèque Bohuslav Martinů (1890-1959), qui écrivit en français Juliette ou la Clef des songes (1938), intéressante tentative de surréalisme, puis la Passion grecque (1958). L'œuvre lyrique du Roumain Marcel Mihalovici (né en 1898) appartient également au répertoire français, mais l'opéra roumain reste dominé par la personnalité de George Enesco (1881-1955), dont l'audacieux Œdipe, opéra atonal utilisant aussi le quart de ton, commencé en 1914, fut créé à Paris en 1936.
Pologne
Elle sortit de l'ombre grâce à Karol Szymanowsky (1882-1937), qui, dans le Roi Roger (1926), sut allier un langage chanté très accessible à une écriture influencée par Berg, Bartók et Janáček. C'est de lui, et non de Lutoslawski, que se réclamera la jeune école dont sortirent le sérialiste Taddeusz Baird (1928-1981), auteur d'un drame lyrique Demain (1966), à la vocalité très décantée, et le pointilliste Penderecki (né en 1933), qui, avec ses Diables de Loudun (1969), donna au théâtre lyrique une œuvre fascinante, aux nombreux tableaux habilement enchaînés, dont l'avant-gardisme sembla représenter le meilleur effort de renouvellement depuis Wozzeck et qui connut aussitôt une audience internationale.
En Angleterre
Malgré le triomphe de l'opéra italien aux xviiie et xixe siècles, l'adulation portée ensuite à Grieg et à Tchaïkovski, la création lyrique tenait bon, entretenue par Henry Bishop (1786-1855), J. Barnett, Ed. Loder et par Michael Balfe (1808-1870), qui écrivit enfin en anglais sa célèbre Bohemian Girl (1843), cependant que l'ambitieux Julius Benedict (1804-1885) et Arthur Sullivan (1842-1900) n'aspiraient pas toujours aux genres les plus nobles. La fin de l'ère victorienne vit renaître une école véritable, mais n'inspira à Elgar aucun opéra. On note, en revanche, ceux d'Ethel Smith (1858-1944), de Frederick Delius (1862-1934), qui vécut en France où il écrivit en 1907 A Village Romeo and Juliet, et ceux de Ralph Vaughan Williams (1872-1958), dont Sir John in love (1929) renouait avec le vieil opera ballad folklorique ; Gustav Holst (1874-1934) souscrivit aussi à cette forme, puis s'en démarqua dans son spirituel Perfect Fool (1923) ; et c'est d'une très digne tradition que se réclama Arthur Benjamin (1893-1960) dans Prima Donna, et A Tale of Two Cities (1950), tandis que l'opéra n'intéressait que tardivement Arthur Bliss et William Walton (Troilus and Cressida, 1954), deux romantiques invétérés.
La création de l'opéra anglais moderne revient à Benjamin Britten (1913-1976), qui, dès 1945, réalise une grande épopée de la mer dans son puissant Peter Grimes, puis rassemble en 1947 l'English Opera Group, dont les effectifs réduits s'adaptaient autant à l'éthique qu'aux possibilités pratiques du théâtre contemporain. Cachant une écriture savante sous les dehors d'un chant lyrique dont il connaît tous les secrets, apprécié de tous les publics, Britten aborde alors la comédie, le drame et même le grand opéra (Gloriana, 1953), apporte sa fine introspection au monde de l'enfance (le Tour d'écrou, Curlew River), utilise la voix de falsettiste dans le Songe d'une nuit d'été (1960), écrit pour Alfred Deller, et révèle enfin, dans Mort à Venise (1973), son souci d'un langage plus moderne ; souci dont témoignent encore Lennox Berkeley et Michael Tippett (né en 1905) avec son parodique Midsummer Marriage (1955) et son solennel King Priam (1962), puis avec The Knot Garden (1970), The Ice Break (1977) et New Year (1989).
Aux États-Unis
Les premières tentatives lyriques y remontent à 1735, où fleurissent à Charleston et à Philadelphie des opera ballads, véritables ancêtres de la comédie musicale (témoin The Disappointment, de Andrew Barton, 1767). Le fonds indien fut exploité dès 1794 avec Tammany de l'Anglais J. Hewitt (1770-1827), non sans arrière-pensée politique, dans The Archers (1796) de Benjamin Carr (1769-1831), un très authentique musicien également de naissance anglaise, puis, en 1808, dans The Indian Princess de John Bray. La divulgation de l'opéra italien et français en 1825, puis celle de l'opéra wagnérien cinquante ans plus tard devaient se refléter d'une part dans Leonora (1845-1858) de W. H. Fry, un intime de Berlioz, de l'autre dans Azara, de Paine (1901).
Des influences de Wagner et d'Elgar sont encore perceptibles chez quelques élèves de Chadwick : Converse, qui réussit à se faire jouer au Metropolitan Opera (The Pipe of Desire, 1909) et même Horatio Parker (Mona en 1912, Fairyland en 1915). Mais on s'étonne surtout que l'opéra soit pratiquement absent des préoccupations de la jeune école américaine, et que les grandes influences qui pesèrent sur celle-ci (Dvořák, l'enseignement de Nadia Boulanger, le néoclassicisme) n'aient pas eu grand écho à la scène. C'est en fait presque par hasard que naissent Madeleine, de Victor Herbert (1914), des opéras de Cadman, et surtout, en 1933, Emperor Jones de Louis Gruenberg (1884-1964), demeuré au répertoire. Virgil Thomson fit montre d'audace en destinant à des noirs Quatre Saints en trois actes (1934), puis en écrivant un opéra féministe Notre Mère à tous, d'après Gertrud Stein (1947). Mais, déjà, le dramatique Porgy and Bess (1935) de Gershwin (1898-1937) avait ouvert des voies autrement authentiques qui, après le Diable et Daniel Webster (1938) de Douglas Moore, conduisirent au savant opéra-jazz de Marc Blitzstein Regina (1949) et au West Side Story (1957) de Leonard Bernstein. On ne peut naturellement relier à aucun courant national l'œuvre de Giancarlo Menotti (né en 1911), l'auteur lyrique le plus célèbre de son époque, en qui le librettiste et le metteur en scène éclipsent parfois le compositeur, disciple avoué mais tardif de Puccini, habile dans le comique, dans le drame (la Sainte de Bleecker Street, 1958), mais surtout dans un vérisme affirmé, dont le Medium (1946) et le Consul (1950) sont encore de remarquables fruits. Mais les vrais classiques de l'opéra américain du siècle demeurent plutôt le très lyrique Vanessa (1958) et le solennel Antoine et Cléopâtre (1966, revu en 1980) de Samuel Barber (1910-1980), mieux que The Second Hurricane (1947) et The Tender Land (1954) du populaire Aaron Copland (né en 1900). Il est d'ailleurs significatif que Roger Sessions (né en 1896), après avoir donné le Procès de Lucullus en 1947, ait dû aller présenter son opéra sériel Montezuma (entrepris en 1955) à Berlin, en 1964.

























































































