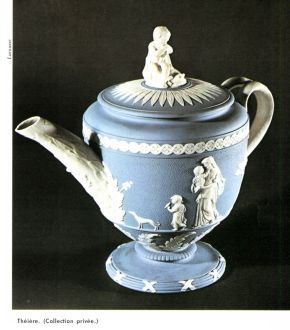Nom donné de 1935 à 1945 à l’ensemble des forces armées du IIIe Reich allemand. (Ce mot allemand signifie « force de défense ».)
Employé par Hitler dans Mein Kampf comme par le général Wilhelm Groener (1867-1939) dans un ordre du jour de janvier 1930 mettant l’armée en garde contre les nazis, le terme de Wehrmacht correspond au vieux concept germanique du peuple en armes (v. armée). Héritière de la Reichswehr, qui avait désigné les forces allemandes constituées dans les limites fixées en 1919 par le traité de Versailles, la Wehrmacht disparaît en 1945 avec la capitulation sans condition signée au nom de l’Allemagne par ses deux chefs, le maréchal Keitel et le général Jodl.
De la Reichswehr à la Wehrmacht (1933-1935)
« Ce dont je suis peut-être le plus fier, déclare Hitler à Munich le 8 novembre 1936, [...] c’est non seulement de ne pas avoir détruit la Reichswehr, mais d’en avoir fait en moins de quatre ans le cadre d’une nouvelle armée populaire allemande [...]. » La Wehrmacht se présente comme une synthèse des deux forces parallèles et souvent opposées de l’Allemagne moderne : le courant hérité de la Prusse, incarné par le grand état-major de Moltke* et prolongé grâce au général Hans von Seeckt (1866-1936) par la Reichswehr, « rocher sur lequel l’État repose », et la composante populaire de la grande Allemagne et du pangermanisme. Cette dernière idée avait été reprise après la défaite de 1918 par les corps francs et transmise avec la caution de Ludendorff* aux SA, les fameuses milices brunes du parti nazi, dont le capitaine Röhm était devenu en 1933 le tout-puissant chef d’état-major.
Cette synthèse, Hitler ne l’a pas réalisée sans mal : il sait qu’il doit son entrée à la chancellerie du Reich à la Reichswehr, qui, d’abord très hostile avec Groener, son ministre de 1928 à 1932, a, au contraire, composé avec Kurt von Schleicher (1882-1934), le général politique par excellence, qui s’est cru capable de diviser, puis de disloquer de l’intérieur le parti nazi. Mais l’armée représente une telle force politique en Allemagne qu’après avoir pris le pouvoir le 30 janvier 1933 Hitler doit, à son tour, composer avec celle qui est l’alliée respectée et exigeante du nouveau régime. Les cadres, qu’animent une conscience professionnelle éprouvée, un certain mépris de la politique et une répugnance a priori pour l’« agitateur bavarois », sont tous pénétrés de la volonté d’effacer la défaite de 1918. Grâce à l’habileté de l’état-major et notamment à l’aide fournie par l’U. R. S. S., les fondements d’une renaissance militaire sont déjà posés tant en ce qui concerne l’étude et l’expérimentation des armements que la préparation d’une mobilisation industrielle. Aussi le haut commandement accueille-t-il avec faveur le nouveau chancelier, qui, dès le 3 février 1933, lui fait connaître sa décision de s’affranchir de toutes les entraves du Diktat de Versailles et de rétablir par le service militaire obligatoire une grande armée allemande. Le 21 mars suivant, en présence du nouveau ministre de la Reichswehr, le général von Blomberg, et devant le tombeau de Frédéric II à Potsdam, le salut respectueux de Hitler au vieux maréchal Hindenburg*, président du Reich, cherche à sceller en une nouvelle légitimité le lien entre la grande tradition prussienne et la révolution nazie.
Avant de s’engager plus loin, l’état-major, qu’incarnent aux côtés de Blomberg les généraux von Fritsch et Beck, commandant en chef et chef d’état-major de l’armée, entend obtenir de Hitler l’élimination du pouvoir exorbitant de Röhm et de son armée de SA, dont l’effectif atteint 3 millions d’hommes au début de 1934. C’est contre la promesse formelle de sa liquidation (opérée par les SS de Himmler dans la nuit sanglante du 30 juin 1934) que l’armée conclura définitivement avec le parti une alliance qui se transformera peu à peu en vassalisation. Le 1er mai 1934, les militaires acceptent d’arborer la croix gammée sur leur uniforme, et, au lendemain de la mort de Hindenburg (août), le haut commandement cautionne la réunion, entre les mains de Hitler, des fonctions de chancelier et de chef de l’État : Blomberg, Fritsch et l’amiral Raeder prêtent serment au Führer en tant que chef suprême et unique des forces armées allemandes.